Accueil > 03 - Livre Trois : HISTOIRE > 4ème chapitre : Révolutions prolétariennes jusqu’à la deuxième guerre mondiale > Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, (...)
Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?
mercredi 19 février 2014, par
« On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels et des banquiers ! »
Anatole France

Rendus aveugles par les gaz sur le front...
... et même des médailles militaires pour les soldats "sénégalais", en fait africains, amputés parce qu’on les a laissés au front sans de bonnes chaussures se geler les pieds !

Des millions de soldats enterrés vivants !

Ceux qui refusent sont collés au peloton d’exécution

Les populations civiles ne sont pas épargnées

« Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir la guerre entre les peuples, c’est abolir la guerre économique, le désordre de la société présente... »
Jean Jaurès
« Prolétaires, l’ennemi principal est dans votre propre pays ! »
Karl Liebknecht



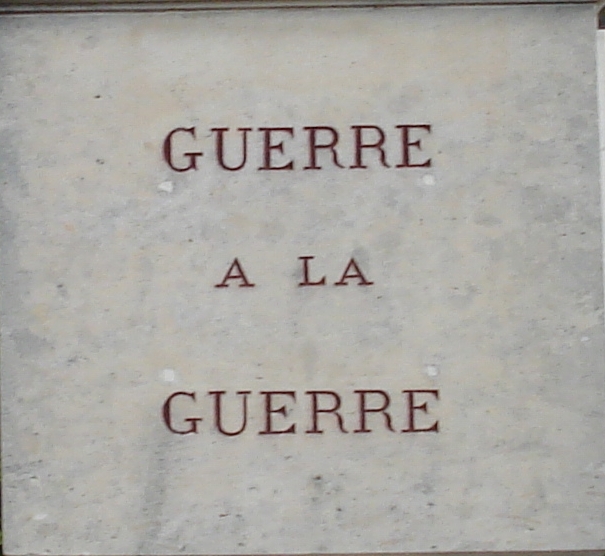
Alors qu’une nouvelle chute du capitalisme nous prépare de nouveaux lendemains guerriers, les cent ans de la première guerre mondiale méritent qu’on se penche sur cette période…
Bien des historiens se contentent de rapporter l’enchaînement des faits qui ont mené à l’entrée en guerre ce qui laisse entendre que les classes dirigeantes ont été prises par le déroulement comme par une fatalité dont ils n’auraient pas pu sortir sans jamais avoir l’intention d’entrer dans la guerre mondiale. Ils auraient été piégés par les alliances contractées auparavant. Ensuite les mêmes historiens rapportent en détail les faits de guerre sans jamais s’interroger sur les raisons profondes d’une telle boucherie mondiale. Ils ne s’interrogeront pas davantage sur ce qui va l’arrêter. Cela n’a rien d’étonnant. En effet, la raison de son démarrage provient de la révolution et sa fin est due à la révolution… Les classes dirigeantes européennes ont choisi la guerre mondiale pour échapper à une menace des travailleurs et des peuples, menace révolutionnaire liée à la crise économique passée dont ils n’étaient pas sortis et à la crise nouvelle qui venait. Ils ont ainsi détourné une révolution sociale et l’ont retardée mais elle est revenue en boomerang et les a obligés à arrêter la guerre. Ils ont failli y perdre le pouvoir. La vitalité sociale et politique des classes bourgeoises était tellement affaiblie que sans les dirigeants du mouvement ouvrier réformiste, ils ne s’en seraient pas sortis ! Ils ont d’ailleurs fait appel à eux dès le début de la guerre et plus encore à sa sortie pour écraser la révolution prolétarienne. La guerre n’est pas seulement la continuatrice de la guerre économique mais aussi de la lutte des classes...




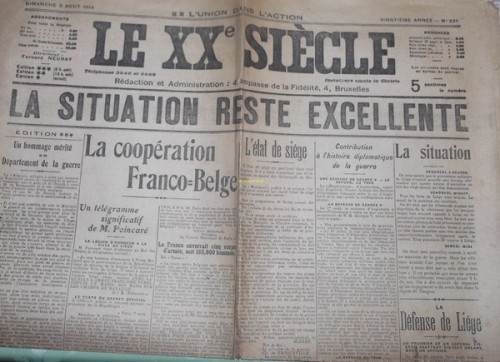
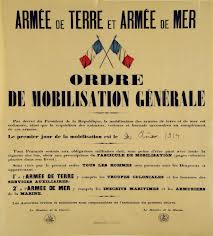
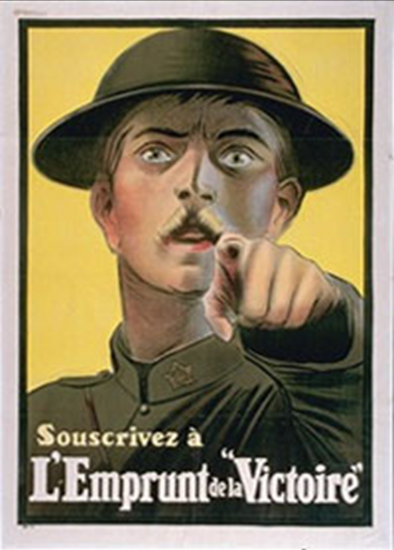


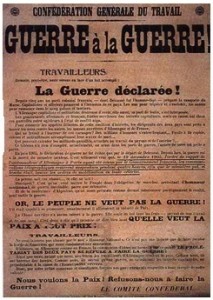
Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?
Curieusement, lors de l’entrée en guerre, on n’a pas eu de diffusion d’explications sur les buts de guerre ni même sur les causes autres que des insultes aux peuples des pays ennemis. Le dernier poilu français vivant Lazare Ponticelli déclarait : « Tous ces jeunes tués, on ne peut pas les oublier. Je tire sur toi, je ne te connais pas. Si seulement tu m’avais fait du mal… Cette guerre, on ne savait pas pourquoi on la faisait. On se battait contre des gens comme nous." Les gouvernements ne parlent pas, dans la première phase de la guerre, des buts de guerre que de manière générale, en parlant d’honneur, de gloire, de patrie, et cela jusqu’en 1917 ; ils se consacrent plus volontiers à rallier l’opinion publique à l’idée de victoire. Les buts de guerre détaillés sont secondaires, seul le caractère héroïque de la guerre compte. De toutes manières, les buts de guerre ne sont pas exactement identiques aux causes de celle-ci comme on va le voir ensuite.
« L’histoire dira un jour, en toute vérité, que la France, qui avait depuis quarante-quatre ans les meilleures, les plus puissantes, les plus légitimes raisons de faire la guerre, a refoulé dans son cœur les sentiments qui devaient l’y pousser et n’a reculé devant aucun sacrifice, si ce n’est celui de son honneur, pour assurer le maintien de la paix. » disait un journal patriotard (La Chronique de la Quinzaine) mais il ne développait nullement les puissantes et meilleures (!) raisons en question ni n’expliquait pourquoi avoir attendu 44 ans et pas plus d’années ou moins...
Des motifs officiels de l’entrée en guerre, des justifications développées par la suite, la première guerre mondiale en a eu de multiples et qui sont parfois contradictoires ou même absurdes (de la pure propagande) :
– les opinions publiques auraient été chauffées par de nombreux incidents rappelant des situations cuisantes pour le patriotisme national. Mais les classes dirigeantes n’ont jamais suivi les opinions publiques : elles les ont plutôt fabriqué à leur convenance. L’ennemi héréditaire anglais s’était transformé en allemand par exemple...
– l’assassinat de l’Archiduc d’Autriche à Sarajevo mais l’assassin n’appartient à aucune nation importante qui sera engagée dans le conflit... L’attaque de la Serbie par l’Autriche n’est nullement justifiée par un attentat d’un terroriste nationaliste serbe qui n’est pas commandité par le pouvoir. L’entrée en scène des autres puissances n’était nullement fatale, s’il n’y avait d’autres raisons plus générales aux impérialismes et plus fondamentales que les alliances des grandes puissances, les unes avec l’Autriche et les autres avec la Serbie.
– la reconquête par la France de l’Alsace-Lorraine, contestée depuis le dernier conflit européen de 1870. Mais justement, cela faisait 44 ans que la situation perdurait et on ne voit pas pourquoi le conflit reprendrait justement en 1914, sans aucun événement local l’expliquant...
– les revendications italiennes sur des territoires de l’empire austro-hongrois mais, justement, l’Italie tarde à se décider d’entrer dans la première guerre mondiale et ne va pas suivre immédiatement la France et l’Angleterre qu’elle ne rejoindra sur les champs de bataille qu’en mai 1915...
– certains auteurs mettent en avant le dynamisme démographique de l’Allemagne face au manque de dynamisme démographique de la France qui pousserait cette dernière à ne pas attendre un changement défavorable du rapport des forces.
– des facteurs psychologiques sont soulignés comme l’influence des officiers prussiens, côté allemand, ou les tendances politiques revanchardes des partis politiques français.
– le bellicisme allemand, disent certains auteurs français, et, bien entendu, le bellicisme français, disent certains auteurs allemands. Chacun rejette la faute sur l’autre pour l’entrée en guerre et donc affirme que la guerre est absurde tout en disant que, de son côté, la guerre est juste et patriotique mais les peuples ne voient pas ces contradictions. "La catastrophe de 1914 est d’origine allemande. Il n’y a qu’un menteur professionnel pour le nier" affirme Georges Clemenceau, dans "Grandeurs et misères d’une victoire". L’Allemagne a bie entendu le discours exactement symétrique. On est souvent à la limite de la dispute de cour de récréation : c’est lui qui a commencé alors qu’en réalité, depuis des années, les deux pays se préparaient ouvertement à la guerre. Ce n’est donc pas un incident de frontière ou un mauvais geste involontaire.
- la question des différends coloniaux est déjà plus sérieuse mais elle justifierait aussi bien (et même mieux) un conflit entre la France et l’Angleterre (à cause de l’Egypte, du Soudan par exemple) ou entre la France et l’Italie (à cause de la Tunisie) mais il est vrai que le capitalisme allemand dynamique lorgne sur les colonies de ses voisins impérialistes… La France, l’Angleterre et la Belgique se partagent l’Afrique. L’Asie aussi est sous la coupe européenne. L’Allemagne, sauf en de rares endroits comme au Cameroun, Namibie, Tanzanie et Togo ne peut obtenir de zones d’influence dans les colonies. L’Allemagne lorgne notamment sur le Maroc… Et les crises diplomatiques de 1905 et 1911 l’ont montré. Cela suffit-il à justifier une grande guerre européenne plutôt que des tractations au sommet et des jeux diplomatiques ?
Des nations impérialistes concurrentes ont nécessairement et en permanence des motifs graves de discorde mais elles n’entrent pas en guerre souvent. Elles ne le font que si des motifs généraux au capitalisme les y pousse et pas seulement des motifs de concurrence…
– les appétits territoriaux des uns et des autres sont souvent mis en avant comme cause de guerre. On a déjà cité l’Alsace-Lorraine pour la France et les colonies pour l’Allemagne. Dans l’empire austro-hongrois, où pas moins de quarante peuples cohabitent, les velléités séparatistes sont nombreuses, liées à l’éveil des minorités nationales (Bohême, Croatie, Slavonie, Galicie, etc.) qui se manifestent depuis 1848. L’Empire ottoman, déjà très affaibli, est ébranlé par la révolution des Jeunes-Turcs en 1908. L’Autriche-Hongrie en profite pour mettre la main sur la Bosnie-Herzégovine voisine et désire continuer son expansion dans la vallée du Danube, jusqu’à la mer Noire, ou, du moins, maintenir le statu quo hérité du traité de San Stefano et du traité de Berlin. En Serbie, le nouveau roi, Pierre Ier envisage la formation d’une grande Yougoslavie, regroupant les nations qui appartiennent à l’empire austro-hongrois. Dans les Balkans, la Russie trouve un allié de poids en la Serbie, qui a l’ambition d’unifier les Slaves du sud. Le nationalisme serbe se teinte donc d’une volonté impérialiste, le panserbisme et rejoint le panslavisme russe, récoltant l’appui du tsar à ces mêmes Slaves du sud. Les Balkans, soustraits de l’Empire ottoman, sont en effet l’objet de rivalités entre les grandes puissances européennes. Depuis longtemps, la Russie nourrit des appétits face à l’Empire ottoman : posséder un accès à une mer chaude (mer Méditerranée). Cette politique passe par le contrôle des détroits. Dans cet Empire russe, les Polonais sont privés d’État souverain et se trouvent partagés entre les empires russe, allemand et austro-hongrois. En Allemagne et en Angleterre, dès le début du XXe siècle, l’essor industriel et la remilitarisation se sont accentués et l’Allemagne a des intérêts dans l’Empire ottoman. L’Italie désire s’étendre en Dalmatie, liée historiquement à l’Italie et où l’on parle aussi italien, et contrôler la mer Adriatique, à l’instar de ce qu’a fait la République de Venise, et ce d’autant plus que ses tentatives de conquête d’un empire colonial africain ont échoué après la débâcle d’Adoua en Abyssinie en 1896.
– les appétits concurrents ne suffisent pas à expliquer la guerre mondiale. D’autres annexions n’avaient pas entraîné de guerre mondiale. Par exemple, le 5 octobre 1908, l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie a été obtenue après l’accord de l’Allemagne et l’acceptation de la Russie (conseillant à la Serbie de céder) en échange de concessions dans les détroits. L’accord est accepté par l’Empire Ottoman le 26 février 1909 en échange du sandjak de Novi-Bazar.
Des guerres locales n’ont pas systématiquement entraîné des guerres générales. Par exemple, le 29 septembre 1911, l’Italie déclare la guerre à l’Empire ottoman. Un corps expéditionnaire de 100 000 hommes est constitué. L’Italie entre en guerre en Tripolitaine mais sans entraîner avec elle d’autres puissances européennes. Elle va, suite à des victoires militaires, occuper militairement Tripolitaine, Dodécanèse et Cyrénaïque.
Les crises de concurrence pour les territoires coloniaux mènent généralement à des négociations, comme la « Convention franco-allemande » réglant la seconde crise marocaine, les Allemands obtenant pour leur retrait du Maroc une compensation au Congo, les Français récupèrent le Bec de Canard au Tchad.
- il y avait également les circonstances politiques. En France, toutes les équipes gouvernementales s’étaient archi usées au pouvoir et il devenait impossible de ne pas faire appel à celui qui apparaissait comme un véritable homme d’Etat : Jean Jaurès, sauf qu’on ne savait pas ce qu’il ferait en cas de guerre… Le parti socialiste s’exprimait toujours contre la guerre mais tout le monde savait que, si la guerre était déclarée, il s’alignerait sur la position patriotique et donc sur la défense des intérêts de sa propre bourgeoisie. En Allemagne, également, la bourgeoisie ne peut se contenter de voir le parti social-démocrate gagner en influence politique comme il vient de le faire le 12 janvier 1912 en raflant 34,8 % des suffrages, et 110 sièges au Reichstag où il devient le plus grand parti d’Allemagne. Là aussi, la marche à la guerre assure, au moins momentanément, que la direction du parti social-démocrate bascule vers la défense nationale et s’aligne immédiatement sur les intérêts de la bourgeoisie allemande.
– à côté des causes réelles de la guerre, il y a aussi les buts de guerre. Le 9 septembre 1914, le chancelier Bethmann Hollweg définit avec Kurt Riezler les buts de guerre allemands dans son Septemberprogramm. Depuis la fondation de l’Empire, l’Allemagne veut assurer sa puissance et faire valoir ses revendications d’une politique mondiale. Le programme de septembre est alors axé sur une sécurisation de l’Empire à l’ouest comme à l’est, sécurisation qui passe par l’affaiblissement de la France ; celle-ci doit ainsi perdre son statut de grande puissance et devenir dépendante économiquement de l’Allemagne. La France doit entre autres céder le bassin de Briey ainsi qu’une partie de la côte allant de Dunkerque à Boulogne-sur-Mer. Pour la Belgique, le chancelier prévoit également un large programme d’annexions, Liège et Verviers doivent être annexées à la Prusse et le pays entier doit devenir un État vassal et une province économique allemande. Le Luxembourg et les Pays-Bas doivent également être annexés à l’Allemagne. Pour l’Allemagne, la Russie doit elle aussi être affaiblie, notamment en ce qui concerne l’influence qu’elle exerce sur les pays frontaliers. La puissance allemande en Europe doit également passer par la création d’une union douanière14 regroupant la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l’Autriche-Hongrie, la Pologne et éventuellement l’Italie, la Suède et la Norvège.
Lénine expliquait dans la préface de "L’impérialisme, stade suprême du capitalisme" :
"La guerre de 1914-1918 a été de part et d’autre une guerre impérialiste (c’est-à-dire une guerre de conquête, de pillage, de brigandage), une guerre pour le partage du monde, pour la distribution et la redistribution des colonies, des "zones d’influence" du capital financier, etc.
Car la preuve du véritable caractère social ou, plus exactement, du véritable caractère de classe de la guerre, ne réside évidemment pas dans l’histoire diplomatique de celle-ci, mais dans l’analyse de la situation objective des classes dirigeantes de toutes les puissances belligérantes. Pour montrer cette situation objective, il faut prendre non pas des exemples, des données isolées (l’extrême complexité des phénomènes de la vie sociale permet toujours de trouver autant d’exemples ou de données isolées qu’on voudra à l’appui de n’importe quelle thèse), mais tout l’ensemble des données sur les fondements de la vie économique de toutes les puissances belligérantes et du monde entier."
– les motifs qui sont souvent invoqués également dans la première guerre mondiale ont trait au rapport des forces entre impérialismes. Ainsi, on souligne que les Allemands auraient intérêt à lancer la guerre avant que la Russie ne se renforce au point d’être capable de les contrer. Les Français et les Anglais, de leur côté, auraient intérêt à la lancer avant que l’Allemagne ne soit trop puissante économiquement et militairement. Etc, etc…On présente ainsi la guerre comme l’aboutissement de la course aux armements. Mais, là aussi, cela ne suffit pas à motiver une guerre mondiale avec tous les risques que cela entraîne, les dépenses et les menaces éventuelles. Ces risques, on va les voir se dessiner chez toutes les puissances vaincues et aussi dans tous les empires où les forces nationales centrifuges se serviront de la guerre pour renverser l’oppression nationale. Mais les risques des questions nationales non réglées vont se catapulter avec les risques révolutionnaires du prolétariat. La guerre mondiale va se transformer à sa fin en guerre civile révolutionnaire, renversant les rois et les bourgeoisies. Les classes dirigeantes ne pouvaient prendre ce risque que si elles estimaient, du fait de l’ampleur de la crise, que le risque révolutionnaire prolétarien était déjà présent et que l’entrée en guerre était une manière de l’éradiquer momentanément en contraignant le mouvement ouvrier au silence à sa base et à l’alignement à son sommet.
Les motifs généraux de guerre mondiale, ce sont donc les limites et les contradictions du système capitaliste. Ce sont les effondrements dus au fonctionnement économique et les risques qu’ils engendrent dans la lutte des classes… Ces risques amènent les classes dirigeantes à se précipiter dans la guerre plutôt que dans la révolution sociale.
Par exemple, la Russie s’est jetée dans la guerre avant toute concertation avec l’Etat français alors que cette concertation faisait partie de son alliance avec la France. Or, la Russie de 1914 est un pays où monte la révolution prolétarienne. Eh oui ! Pas seulement en 1917 mais déjà en 1914... Et déjà, en 1914, pour la première fois en Russie, les bolchéviks sont devenus majoritaires dans la classe ouvrière !
Ce n’est pas seulement la Russie qui était menacée par la montée révolutionnaire mais tous les empires, l’empire austro-hongrois et l’empire ottoman. Les nationalités opprimées et les classes ouvrières menaçaient de s’unir contre cette oppression impériale. La menace plane sur les empires : en 1911, la révolution a renversé déjà la dynastie des Qing en Chine. Le 23 janvier 1913, la révolution contre l’empire Ottoman a lieu. Les « Jeunes-Turcs » prennent le pouvoir par un coup d’État mené par le triumvirat formé par Enver Pacha, Talaat Pacha et Djemal Pacha.
Partout en Europe de l’Est comme dans l’Empire Ottoman ou en Russie, la révolte des nationalités rejoint celle de la classe ouvrière et des paysans pauvres. C’était également le cas des Juifs et de la classe ouvrière des pays d’Europe de l’Est comme la Pologne et la Hongrie. En mars-avril 1907, c’est une révolution paysanne qui a été écrasée dans le sang en Roumanie. En mai 1912 la grève générale et les émeutes ouvrières à Budapest organisées par les sociaux-démocrates en Hongrie ont été violemment réprimées.
Le 14 avril 1913, grève générale en Belgique. L’hiver 1913, il y a à la fois la crise économique catastrophique en Allemagne, des grèves ouvrières violentes au Royaume Uni, des grèves massives en Russie (1,75 million de grévistes de juin 1913 à juillet 1914).
L’Europe ouvrière menace la bourgeoisie. La réplique sera l’entrée en guerre…
La guerre mondiale, ce n’est pas seulement une guerre contre d’autres puissances : c’est une guerre contre les classes ouvrières et les peuples !
La guerre était le résultat d’une aggravation des contradictions du système mondial :
« L’Europe, après la guerre est tombée dans une situation plus pénible qu’avant 1914. Mais la guerre n’a pas été un phénomène fortuit. Ça a été le soulèvement aveugle des forces de production contre les formes capitalistes, y compris celles de l’Etat national. Les forces de production, créées par le capitalisme, ne pouvaient plus tenir dans le cadre des formes sociales du capitalisme, y compris le cadre des Etats nationaux. De là, la guerre. Quel a été le résultat de la guerre pour l’Europe ? Une aggravation considérable de la situation. Nous avons maintenant les mêmes formes sociales capitalistes, mais plus réactionnaires ; les mêmes barrières douanières, mais plus hérissées d’obstacles ; les mêmes frontières, mais plus étroites ; les mêmes armées, mais plus nombreuses ; une dette accrue, un marché restreint. Telle est la situation générale de l’Europe. Si, aujourd’hui, l’Angleterre se relève quelque peu, c’est au détriment de l’Allemagne ; demain, ce sera l’Allemagne qui se relèvera au détriment de l’Angleterre. Si la balance commerciale d’un pays accuse un excédent, la balance d’un autre pays accuse un passif correspondant » (Trotsky, 1926).
Crise économique et première guerre mondiale
La première guerre mondiale est, d’abord et avant tout, un sous-produit de la crise du système capitaliste mondial. Comme la crise de 1929 est la cause directe de la seconde guerre mondiale, la crise de 1907 est la cause directe de la première guerre mondiale…
Quand les classes dirigeantes perçoivent que la dernière crise les a durablement déstabilisés, ils savent que la prochaine sera dangereuse socialement, face à la classe ouvrière… Ils préparent alors la guerre mondiale et développent à la fois leurs armements et leurs armes sociales et idéologiques pour entraîner les peuples dans la boucherie…
La Panique bancaire américaine de 1907, aussi nommée Panique des banquiers, est une crise financière qui eut lieu aux États-Unis lorsque le marché boursier s’effondra brusquement, perdant près de 50 % de la valeur maximale atteinte l’année précédente. Cette panique se produisit au milieu d’une période de récession, marquée par d’innombrables retraits de fonds des banques de détail et d’investissement. La panique de 1907 se propagea à tout le pays, de nombreuses banques et entreprises étant acculées à la faillite. Parmi les premières causes de la crise, on peut citer le retrait de liquidités des banques de New York, la perte de confiance des dépositaires et l’absence d’un fonds de garantie des dépôts.
La crise éclata en octobre après une tentative ratée de corner sur les actions de la compagnie United Copper. Les banques qui avaient prêté de l’argent pour réaliser le corner furent victimes de retraits massifs, qui se propagèrent aux établissements affiliés, causant en l’espace d’une semaine la chute de la société fiduciaire Knickerbocker Trust Company, troisième établissement en importance de ce genre à New York. Cette chute causa une vague de paniques parmi les établissements financiers de la ville lorsque les banques régionales commencèrent à retirer des fonds de New York. La panique gagna bientôt le pays tout entier et les particuliers se ruèrent sur les banques pour retirer leurs dépôts.
La panique se serait accrue si le financier J. P. Morgan n’était pas intervenu en engageant ses fonds propres et en persuadant d’autres banquiers de l’imiter pour soutenir le système bancaire américain. À cette époque, il n’existait pas de banque centrale américaine pour réinjecter des liquidités sur le marché. En novembre, la crise était pratiquement terminée, quand elle repartit de plus belle lorsqu’une firme de courtiers fit un emprunt massif gagé sur les actions de la Tennessee Coal, Iron and Railroad Company (TC&I). La chute des actions de cette compagnie fut évitée par une prise de participation d’urgence de la U.S. Steel effectuée avec l’aval du président Theodore Roosevelt, pourtant farouche opposant des monopoles. L’année suivante, le sénateur Nelson W. Aldrich réunit une commission qu’il présida lui-même pour enquêter sur la crise et préconiser des solutions. Le processus allait aboutir le 22 décembre 1913 à la création de la Réserve fédérale des États-Unis.
La panique de 1907 se produisit lors d’une période de récession prolongée entre mai 1907 et juin 1908. L’interaction entre la récession, la panique bancaire et la crise boursière provoquèrent un déséquilibre économique de taille. Robert Bruner et Sean Carr citent de nombreuses statistiques qui donnent une idée de l’ampleur des dégâts dans The Panic of 1907 : Lessons Learned from the Market’s Perfect Storm. La production industrielle chuta à un niveau sans précédent après une telle crise, et le nombre de faillites en 1907 se classa au second rang des plus hauts jamais enregistrés. La production chuta de 11 %, les importations de 26 %, et le chômage, qui était à moins de 3 %, atteignit 8 %.
Au début de 1907, le banquier Jacob Schiff de Kuhn, Loeb & Co. avait prononcé un discours devant la chambre de commerce de New York qui contenait cet avertissement : « Si nous n’avons pas de banque centrale disposant d’un contrôle suffisant des ressources nécessaires au crédit, ce pays se retrouvera face à la crise financière la plus brutale et la plus grave de son histoire ».
En novembre 1910, Aldrich convoqua une conférence qui fut tenue secrète et rassembla les plus éminents financiers américains ; elle se tint au club de Jekyll Island, au large de la côte de Géorgie ; à l’ordre du jour figuraient les politiques monétaires et le système bancaire. Aldrich et A. P. Andrews (vice-secrétaire du département du Trésor), Paul Warburg (représentant de Kuhn, Loeb & Co.), Frank A. Vanderlip (qui avait succédé à James Stillman comme directeur de la National City Bank of New York), Henry P. Davison (associé principal de la compagnie J.P. Morgan & Co.), Charles D. Norton (directeur de la First National Bank of New York inféodée à Morgan) et Benjamin Strong (représentant J.P. Morgan), élaborèrent le projet d’une banque de réserves nationale (National Reserve Bank).
Morgan apparut d’abord comme un héros, mais bien vite cette image se ternit avec les craintes de voir émerger une ploutocratie et la concentration des richesses entre les mains d’une minorité. La banque de Morgan avait résisté, mais les sociétés fiduciaires qui concurrençaient le système bancaire traditionnel ne pouvaient en dire autant. Certains experts pensèrent que la crise avait été fabriquée de toutes pièces pour ébranler la confiance dans les sociétés fiduciaires au bénéfice des banques. D’autres pensèrent que Morgan avait profité de la crise pour réussir la fusion entre U.S. Steel et TC&I.
En décembre 1907, la crise américaine atteint de plein fouet l’Allemagne. La crise y est due à la croissance excessive de l’économie et amplifiée par la crise américaine. Le chômage grimpe en flèche.
Voici un extrait du journal économique « La Tribune » du 8 novembre 2013 :
« En 1907, une crise financière majeure née aux États-Unis a affecté le reste du monde et démontré la fragilité du système financier international.
Les suites du crash de 1907 ont poussé la puissance hégémonique de l’époque, la Grande-Bretagne, à réfléchir à la façon de mettre sa puissance financière au service de sa capacité stratégique sur la scène internationale. Telle est la conclusion d’un livre important sorti récemment, Planning Armageddon, de Nicholas Lambert, qui étudie la relation entre l’économie britannique et la Première Guerre mondiale. Il y montre comment, dans le cadre d’un jeu stratégique de grande ampleur, la Grande-Bretagne a combiné sur la scène internationale sa prédominance militaire, notamment sur les mers, avec son leadership financier.
Entre 1905 et 1908, l’amirauté britannique avait esquissé le plan d’une guérilla financière et économique contre la puissance montante en Europe, l’Allemagne. La guérilla économique, si elle avait été menée à fond, aurait coulé le système financier de l’Allemagne et l’aurait empêché de s’engager dans un conflit militaire, quel qu’il soit. Quand les visionnaires de l’amirauté britannique ont été confrontés à un rival sous la forme de l’Allemagne du Kaiser, ils ont compris comment le pouvoir pouvait prospérer sur la fragilité financière.
Pour les rivaux de la Grande-Bretagne, la panique financière de 1907 montrait la nécessité de mobiliser les puissances financières elles-mêmes. Les États-Unis, de leur côté, reconnaissaient qu’il leur fallait une banque centrale analogue à la Banque d’Angleterre. Les financiers américains étaient persuadés que New York devait développer son propre système d’échanges commerciaux pour traiter les lettres de change de la même manière que le marché de Londres, et assurer leur monétisation (ou acceptation).
Un personnage central a joué un rôle essentiel pour parvenir au développement d’un marché américain des acceptations bancaires. Il s’agit d’un immigré, Paul Warburg, frère cadet de Max Warburg, un banquier renommé de Hambourg qui était le conseiller personnel du Kaiser Guillaume II d’Allemagne.
Les frères Warburg, Max et Paul, constituaient un tandem transatlantique qui poussait énergiquement à la création d’institutions germano-américaines comme alternative au monopole industriel et financier de la Grande-Bretagne. Ils étaient convaincus que l’Allemagne et les États-Unis étaient des puissances montantes, tandis que la Grande-Bretagne était sur le déclin.
On voit réapparaître aujourd’hui certaines caractéristiques de la situation financière d’avant 1914. Après la crise financière de 2008, les institutions financières semblaient être à la fois des armes de destruction massive sur le plan économique et les instruments potentiels de la mise en oeuvre de la puissance nationale.
En 1907, après une crise financière marquante qui a failli entraîner un effondrement complet du système, plusieurs pays ont commencé à penser la finance avant tout comme un instrument du pouvoir brut qui peut et doit être mis au service de l’intérêt national. Ce genre d’idée a conduit à la guerre de 1914. Un siècle plus tard, en 2007-2008, le monde a subi un choc financier encore plus important qui a enflammé les passions nationalistes. Les stratégies destructrices ne sont peut-être pas loin derrière. »
1914 : Quand les grandes puissances provoquent des guerres pour éviter la faillite…
Bien que ce soit l’un des secrets les mieux gardés de la guerre 1914-18, le Trésor et les finances de l’Empire britannique étaient déjà en faillite au moment où la guerre était déclarée entre la Grande-Bretagne et le Reich allemand.
Si l’on examine la réalité des relations financières des principales parties entrées en guerre, on découvre un arrière-fond extraordinaire de crédits secrets, de plans pour partager les matières premières et la richesse physique du monde entier d’alors, sur la base de crédits par tranches. A ce moment-là, il fut décidé que New York devait être le banquier de l’entreprise !
En effet, la Première Guerre mondiale fut déclenchée quand on s’aperçut que les réserves d’or des pays belligérants ne pouvaient pas financer les hostilités ni garantir la valeur des émissions de monnaie fiduciaire des Banques centrales. Comme la production ne pouvait pas suivre le rythme de ces émissions, il s’ensuivit une dégradation constante de la valeur des monnaies et l’instauration de leur cours forcé, souvent accompagné d’un moratoire. Comme les échanges internationaux se réglaient en or, tout fut mis en œuvre afin d’exiger que les réserves d’or des pays belligérants soient envoyées vers les pays créanciers. Ainsi se déplaçait le centre de pouvoir de l’Europe vers les Etats-Unis ! Bien évidemment, l’ampleur de ces mouvements de capitaux déstabilisa les marchés des changes et freina le commerce international.
Transfert des réserves d’or
A en croire les livres d’histoire populaire, c’est un assassinat serbe qui déclencha les hostilités en tuant à Sarajevo, le 28 juin 1914, l’héritier du trône d’Autriche, l’archiduc François-Ferdinand.. Après un mois de négociations frénétiques, l’Autriche déclara la guerre au petit Etat de Serbie, tenu pour responsable du meurtre. Elle avait été assurée de l’appui de l’Allemagne, au cas où la Russie soutiendrait la Serbie. Le lendemain, le 29 juillet, la Russie donna des ordres de mobilisation à son armée, en préparation de la guerre. Puis le même jour, à la réception d’un télégramme de l’empereur allemand le suppliant de ne pas mobiliser, le tsar Nicolas II annula ses ordres. Le 30 juillet, le haut Commandement russe persuada le faible tsar de reprendre la mobilisation. Le 31 juillet, l’ambassadeur allemand à Saint Pétersbourg remit au tsar une déclaration de guerre. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclara la guerre à la France et les troupes allemandes envahirent la Belgique. Le 4 août, l’Angleterre déclara la guerre à l’Allemagne en invoquant ses engagements envers la protection de la neutralité belge. Répétons-le encore, la décision britannique d’entrer en guerre pour protéger son voisin belge sur le continent intervenait au moment où le Trésor britannique et le Système de la Livre Sterling étaient de fait en faillite. C’est d’autant plus étonnant à la lecture d’une série de mémorandums internes du Trésor britannique, connus désormais des historiens.
En janvier 1914, six mois avant le casus belli de Sarajevo, le chancelier britannique avait demandé à Sir George Paish, haut fonctionnaire du Trésor, de mener une étude exhaustive sur les réserves-or britanniques. Depuis les années 70, la Livre Sterling et la City de Londres représentaient le pivot du système financier et monétaire mondial, de la même façon que New York et le dollar représentent ce pivot depuis 1945 sous le système de Bretton Woods. Le mémorandum confidentiel de Sir George est révélateur de la pensée officielle à Londres à l’époque. Dans son étude, Paish parlait de la sophistication progressive des grandes banques commerciales allemandes depuis les crises des Balkans en 1911-12, ce qui les conduisit à renforcer considérablement leur réserve-or. Paish avertit Lloyd George que tout retrait soudain de fonds hors de Londres pourrait sérieusement entraver la capacité de la nation à collecter l’argent nécessaire pour mener une grande guerre. C’était, rappelons-le, six mois avant Sarajevo. Les paiements en espèces -or et argent- furent suspendus en même temps que l’Acte bancaire de 1844, ce qui mit à la disposition de la Banque d’Angleterre une grande quantité d’or pour faire face aux paiements de nourriture et de matériels militaires. Les Britanniques reçurent à la place des billets de la Banque d’Angleterre comme cours légal, pendant la durée de l’état d’urgence, soit jusqu’en 1925.
Les fondations de la domination britannique instaurée après 1815 pourrissaient déjà à l’époque depuis une cinquantaine d’années. Dans les années 50 du XIX° siècle, la Grande-Bretagne avait été la première puissance industrielle du monde. Mais, notamment à partir de la panique de 1857, les élites britanniques commencèrent à piller systématiquement leur propre économie industrielle ainsi que celle du reste du monde[1]. Après 1857, la politique officielle adoptée par la Banque d’Angleterre consistait à réguler la quantité de réserves-or mondiales, alors basées à Londres, en élevant ou abaissant les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre, plutôt qu’en traitant les causes sous-jacentes de la stagnation technologique domestique. Donc, à la suite de ce changement politique fondamental, alors que l’or quittait l’Angleterre et mettait en danger les réserves de crédit du pays, la Banque d’Angleterre réagit en haussant ses taux, à commencer par son taux d’escompte bancaire. L’or se mit alors à affluer vers Londres, depuis d’autres centres tels que Paris et New York. Bien sûr, l’investissement dans l’industrie nationale s’effondra et les exploitations agricoles périclitèrent en Angleterre. Mais jusqu’à la fin des années 1890, la Grande-Bretagne tenta de compenser cette dévastation en saignant ses colonies, surtout l’Inde, contrôlant les termes d’échanges à l’avantage du pouvoir financier de la City de Londres. La famine, la dépression industrielle et des conséquences semblables de par le monde étaient le fait de ces cercles qui forgeaient les politiques monétaires comme les Barings, les Rothschild[2], les Hambros. Toutefois, jusqu’en 1914, ces manipulations se révélèrent inefficaces[3].
Dès les années 1890, du point de vue du développement technologique et agricole, l’industrie britannique s’était fait amplement dépasser par le reste du monde. Deux nations venaient en tête : l’Amérique et l’Allemagne. Dans les années 1870, 1′Allemagne avait commencé à bâtir sa propre structure bancaire indépendante pour libérer son commerce extérieur de la finance londonienne. En 1893,1′Allemagne répondit à une panique bancaire provoquée à Berlin en convoquant une commission nationale. Composée de dirigeants de l’industrie, de l’agriculture, du gouvernement et de la banque, elle était représentative de tous les groupes d’intérêt économiques de la nation. Il en résulta des lois strictes imposées aux autres nations industrielles, limitant, voire interdisant le commerce à terme et d’autres formes de spéculation en bourse. Le crédit fut alors orienté vers l’investissement, l’agriculture et l’industrie. On développa rapidement la flotte allemande de manière à donner au pays un plus grand contrôle sur son propre commerce, brisant le monopole britannique sur les transports marchands. Les machines allemandes, de qualité supérieure, commencèrent à pénétrer les marchés anglais et même américains. La domination de l’Empire britannique était menacée. Mais l’Establishment britannique refusa de se rendre à l’évidence en changeant de cap après cinquante années d’une politique industrielle de désinvestissement monétariste[4]. A la place, il se prépara à la guerre pour réorganiser les conditions de fonctionnement de l’économie mondiale[5]. Au lieu de moderniser l’industrie britannique, l’Angleterre se tourna vers ses amis dans la communauté bancaire internationale de New York, et négocia « un très gros prêt ». Londres joua bientôt son va-tout. Son marché à l’investissement le plus important depuis les années 1870 était les Etats-Unis…
[1] C’est encore la même chose aujourd’hui avec les Etats-Unis…
[2] Les Rothschild sont la plus puissante des dynasties de la Banque depuis le XIXème siècle.
[3] C’est précisément ce qui arrive aujourd’hui aux Etats-Unis : malgré les manipulations des statistiques, des taux d’intérêt et des marchés de matières premières, les effets recherchés par les familles bancaires sont de plus en plus réduits dans le temps !
[4] Que s’est-il passé aux Etats-Unis ces trente dernières années ? La même politique de désindustrialisation fut appliquée par la Haute finance… comme s’il était prévu d’engager les Etats-Unis vers une voie sans retour.
[5] En 2007, que s’apprêtent à faire les dirigeants américains pour l’ensemble du Moyen-Orient
Extraits de l’ouvrage de Jacques Delacroix : 1929-2007 des parallèles stupéfiants – Le Pouvoir occulte met Wall Street dans son ligne de mire. - Liesi
Les fusillés pour l’exemple


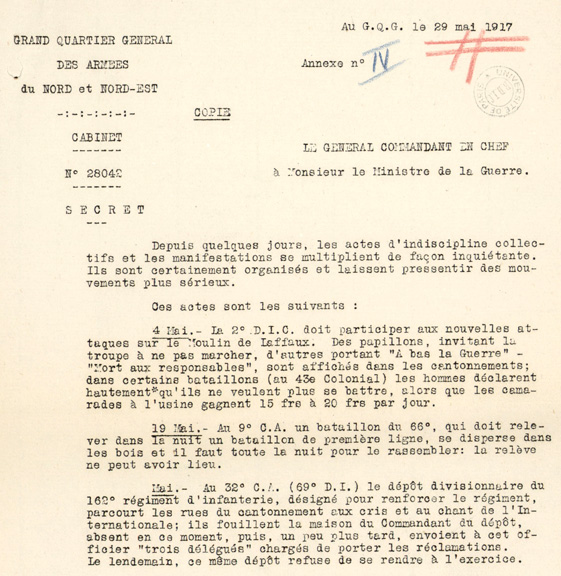
L’invasion allemande de la Belgique :
Comme nous le rappellent nos lecteurs, les civils ont été parmi les nombreuses victimes...
Il convient de ne pas l’oublier à l’heure où on glorifie un peu partout la première des horreurs mondiales du capitalisme !

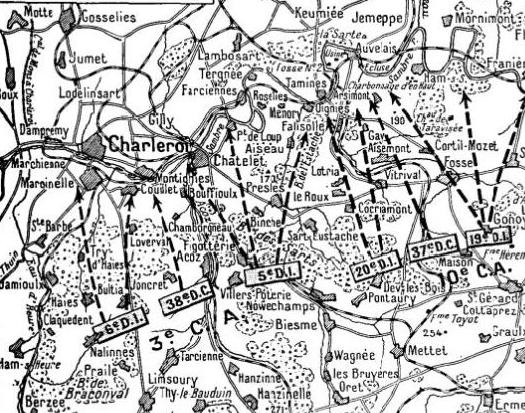

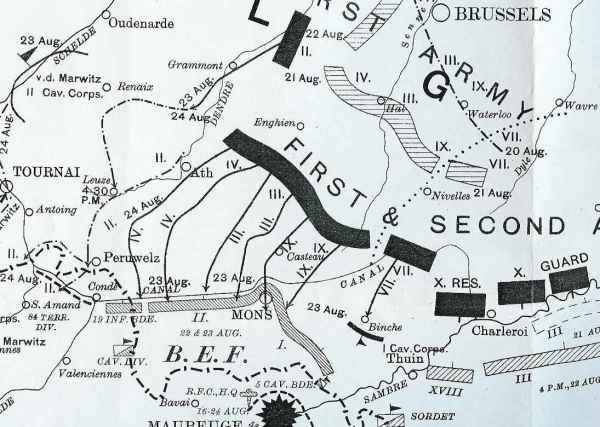
Les populations ont été prises entre deux ou trois feux et accusées par les troupes allemandes d’avoir pris parti contre elles. Elles ont été traitées en ennemies et violemment frappées, souvent mortellement.
La « Bataille de Mons » (23-24 août 1914), eut lieu en milieu urbain, causant de nombreuses destructions dans des agglomérations surpeuplées et semant la misère dans les cités ouvrières.
On remarquera qu’il y a une immense majorité de monuments aux troupes combattantes pour un nombre infime de monuments aux victimes civiles...
Pour lire "Au-dessus de la mêlée" de Romain Rolland : cliquer ici



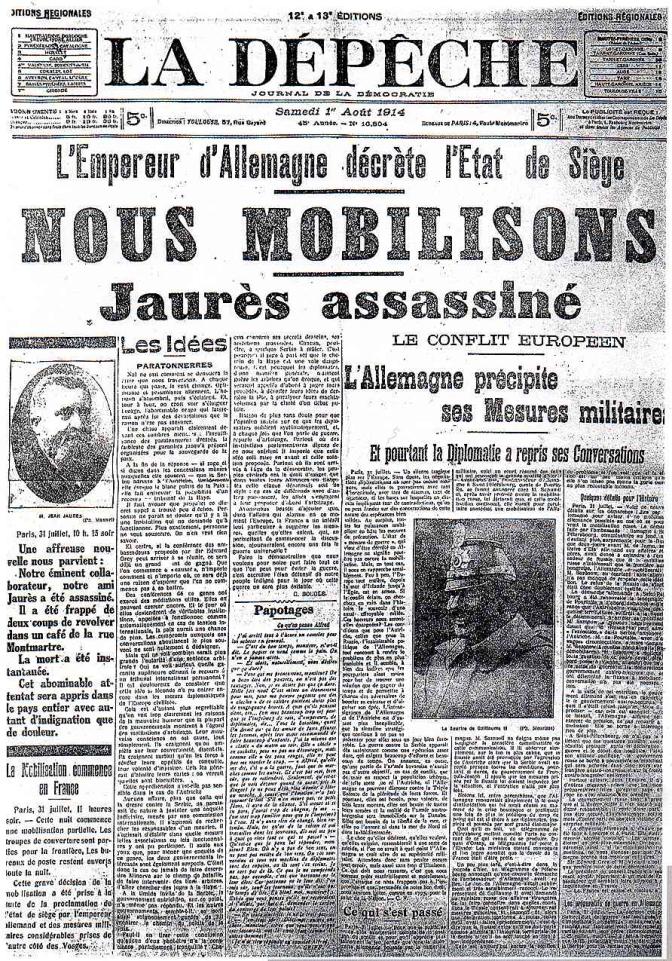
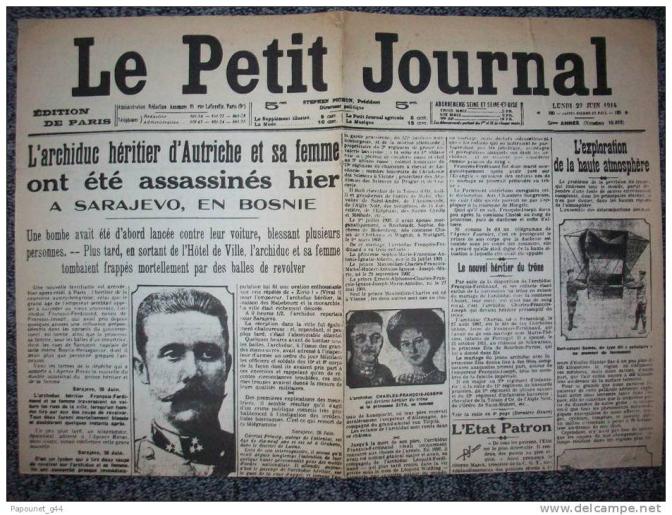



Messages
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 21:11
Lettre de dénonciation d’un défaitiste
« Calan, 21 mai 1915 Monsieur le Préfet,
Je trouve qu’il est de mon devoir d’institutrice française de vous faire part des conversations qui me reviennent de plusieurs sources en relatant les récits d’un jeune zouave, Le Cren, Pierre, hospitalisé depuis mars et arrivé au pays depuis quelques jours, les récits fait par ce jeune homme ont du crédit car il est plus instruit que la majorité des hommes du pays. Je ne cherche pas à lui nuire, Mr le Préfet, je n’ai jamais eu que de bonne relations avec les siens mais je sens qu’inconsciemment ou par vantardise il va influencer l’esprit de nos pauvres bretons qui juste commençaient à avoir confiance en la France.
Hier il disait que les belges avec lesquels il était préfèreraient tous voir le triomphe de l’Allemagne, que le gouvernement belge veut également que notre adversaire ait le dessus ; que les belges préfèreraient les soldats allemands aux français ; que les allemands étaient très polis où ils passaient que nos soldats dévastaient leurs fermes etc. etc. Il serait bon qu’il reçoive un petit avertissement car il va faire bien du mal ; nous avons eu tant à combattre, tant à nous dépenser pour essayer de faire naitre la confiance chez nos bretons méfiants même de leur pays ! Les paroles du jeune zouave sont bues et se distilleront dans tout le pays. Du reste il est de la classe 14, de celle dont tous les jeunes gens sont partis la mort au cœur, grâce à quelques imbéciles revenus en convalescence. Mon père, un vieux brave de 70 avait réussi à se faire aimer de la petite classe 15 il les a encouragés, il a réussi à en faire de vrais patriotes qui sont partis gais et qui écrivent d’une façon très encourageante à leurs parents et cependant parmi ceux-là il en est un qui a avoué à mon père qu’il s’était abîmé la jambe pour ne pas être accepté au conseil de révision parce qu’un soldat revenu du front l’avait effrayé. Ce petit de la classe 15 est le plus content de tous maintenant . Alors il ne faudrait pas que notre zouave mette son mois de convalescence à détruire ce que nous avons eu tant de peine à édifier.
Veuillez m’excuser, Monsieur le Préfet, et croire à mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Louise Beller
née Le Béhérec »
Archives du Mobihan
2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 21:14
Sur les causes de la guerre franco-allemande de 1870, Jean Jaurès écrivait dans "Histoire socialiste" :
QUI EST RESPONSABLE DE LA GUERRE ?
Dans le conflit qui a mis aux prises deux puissantes nations, la France a une grande et profonde responsabilité. C’est elle qui l’a préparé dès longtemps et qui l’a rendu presque inévitable en méconnaissant les conditions de vie de l’Allemagne, en marquant une hostilité sourde ou violente à la nécessaire et légitime unité allemande. Cet aveu est douloureux sans doute, et il semble que ce soit redoubler la défaite du vaincu que le reconnaître responsable, pour une large part, de la guerre où il a succombé. Mais c’est au contraire échapper à la défaite en se haussant à la vérité qui sauve et qui prépare les relèvements. M. de Bismarck a dit : « La France est politiquement le plus ignorant de tous les peuples ; elle ignore ce qui se passe chez les autres. »
Sur l’Allemagne elle s’était longuement méprise. Elle avait oublié le merveilleux génie pratique et agissant de Frédéric II : elle avait oublié aussi l’admirable mouvement de passion nationale qui avait soulevé et emporté l’Allemagne de 1813. Elle se figurait que jamais l’âpre volonté prussienne ne disciplinerait les flottantes énergies de la race allemande. Et elle croyait qu’après une courte crise de patriotisme exaspéré, l’Allemagne, à peine délivrée de l’occupation étrangère, se livrait aux douceurs inertes d’un idéalisme impuissant, et renonçait à fonder dans le monde réel des intérêts et des forces sa grandeur politique, industrielle et militaire.
À vrai dire, si la France avait scruté plus profondément la pensée allemande, elle aurait vu que son idéalisme n’était ni abstrait, ni vain, qu’il s’alliait, au contraire, à un sens très précis de la réalité, ou plutôt qu’il était l’effort immense de l’esprit pour élever à sa hauteur toute la réalité. Hegel avait dit : « Il ne faut pas s’élever du monde à Dieu, il faut élever le monde à Dieu », c’est-à-dire saisir l’idée de l’univers sans abandonner jamais la réalité immédiate.
Ainsi le génie allemand construisait le pont sublime par où un peuple tout entier pouvait passer de l’audace précise de la spéculation à l’audace précise de l’action. Mais, pour le regard des Français, cet âpre paysage, dont l’architecture hardie des systèmes franchissait les abîmes, était comme noyé d’une brume romantique. Il avait comme un aspect lunaire. Quelques hommes pourtant commençaient à voir la réalité, Quinet surtout. Il n’avait pas attendu les durs avertissements que nous donnera Henri Heine en 1840 ; dès 1831, il annonçait que la communauté du génie allemand se traduirait assurément en communauté nationale et politique ; que l’unité allemande se causerait par la Prusse, et que cette force nouvelle, toute chargée de lourdes rancunes et de vieilles haines, menacerait, en son expansion soudaine et rapide l’Europe et la France elle-même. « La contradiction, disait-il, est devenue trop flagrante pour pouvoir durer entre la grandeur des conceptions allemandes et la misère des États auxquels elles s’appliquent. L’ambition publique éveillée par 1814, étouffée, à l’étroit dans ses duchés. Je pourrais nommer les plus beaux génies de l’Allemagne à qui le sol manque sous les pas, et qui tombent à cette heure, épuisés et désespérés, sur la borne de quelque principauté faute d’un peu d’espace pour s’y mouvoir à l’aise. Depuis que les constitutions ont fait des citoyens, il ne manque plus qu’un pays pour y vivre, et la forme illusoire de la Diète germanique, assiégée par les princes et par les peuples, tend à s’absorber un matin, sans bruit, dans une représentation constitutionnelle de toutes les souverainetés locales .... Nous n’avions pas songé que tous ces systèmes d’idées, cette intelligence depuis longtemps en ferment et toute cette philosophie du Nord, qui travaille ces peuples, aspireraient aussi à se traduire en évènements dans la vie politique, qu’ils frapperaient sitôt à coups redoublés pour entrer dans les faits et régner à leur tour sur l’Europe actuelle.
« Nous qui sommes si bien faits pour savoir quelle puissance appartient aux idées, nous nous endormions sur ce mouvement d’intelligence et de génie ; nous l’admirions naïvement, pensant qu’il ferait exception à tout ce que nous savons et que jamais il n’aurait l’ambition de passer des consciences dans les volontés, des volontés dans les actions, et de convoiter la puissance sociale et la force politique. Et voilà cependant que ces idées, qui devaient rester si insondables et si incorporelles, font comme toutes celles qui ont jusqu’alors apparu dans le monde et qu’elles se soulèvent en face de nous comme le génie même d’une race d’hommes, et cette race elle-même se range sous la dictature d’un peuple, non pas plus éclairé qu’elle, mais plus avide, plus ardent, plus exigeant, plus dressé aux affaires. Elle le charge de son ambition, de ses rancunes, de ses rapines, de ses ruses, de sa diplomatie, de sa violence, de sa gloire, de sa force au dehors, se réservant à elle l’honnête et obscure discipline des libertés intérieures. Depuis la fin du moyen âge, la force et l’initiative des États germaniques passe du Midi au Nord avec tout le mouvement de la civilisation. C’est donc de la Prusse que le Nord est occupé à cette heure à faire son instrument ? Oui ; et si on le laissait faire, il la pousserait lentement, et par derrière, au meurtre du vieux royaume de France. En effet, au mouvement politique que nous avons décrit ci-dessus est attachée une conséquence que l’on voit déjà naître. À mesure que le système germanique se reconstitue chez lui, il exerce une attraction puissante sur les populations de même langue et de même origine qui en avaient été détachées par la force. Sachons que la plaie du traité de Westphalie et la cession des provinces d’Alsace et de Lorraine saignent encore au cœur de l’Allemagne autant que les traités de 1815 au cœur de la France. »
Or, à mesure que les peuples allemands cherchaient à échapper à leur chaos d’impuissance et d’anarchie, à mesure qu’ils marquaient leur volonté de s’organiser, de préluder par l’union douanière à l’union politique et à l’action nationale, à mesure que l’idéalisme allemand se révélait plus substantiel et plus énergique, quelle était la pensée, quelle était l’attitude de la France ? Dès lors, je veux dire dès le règne de Louis-Philippe, il y a dans la pensée française à l’égard de l’Allemagne incertitude, ambiguïté, contradiction. S’opposer à la libre formation d’un peuple c’est répudier toute la tradition révolutionnaire. Au nom de la Convention, Hérault de Séchelles s’écriait : « Du haut des Alpes la liberté salue les nations encore à naître ». C’est l’Allemagne et l’Italie qu’il évoquait ainsi à la lumière de la vie. La féodalité n’était pas seulement tyrannie, elle était morcellement : et la liberté ne pouvait naître qu’en brisant à la fois des entraves et des cloisons. Les démocraties ne pouvaient se former que dans les cadres historiques les plus vastes. Maintenir la nationalité allemande à l’état de dispersion, c’était donc pour la France révolutionnaire refouler et briser la Révolution elle-même : Comment l’eût-elle pu sans une sorte de suicide ? Mais d’autre part laisser se constituer à côté de soi, débordant au-delà même du Rhin, la formidable puissance de l’Allemagne organisée et unifiée, c’était renoncer sinon à toute sécurité, du moins à l’instinct de suprématie. Ah ! qu’il était difficile à la France de devenir une égale entre des nations égales ! Qu’il lui était malaisé de renoncer à être la grande nation pour n’être plus qu’une grande nation ! Il fallait que par un prodigieux effort de conscience elle dominât toute sa tradition, toute son histoire, toute sa gloire. La première des nations de l’Europe continentale, elle avait été organisée, et sa force concentrée avait été par là même une force rayonnante, rayonnement de puissance, rayonnement d’orgueil, rayonnement de pensée, rayonnement de générosité, rayonnement de violence, les Croisades, la catholicité française du XIIIe siècle, la primauté insolente et radieuse de Louis XIV, l’universalité de l’Encyclopédie, la Révolution des Droits de l’Homme, enfin l’orage napoléonien qui fécondait l’Europe en la bouleversant. La France s’était habituée à être le centre de l’histoire européenne, le centre de perspective quand elle n’était pas le centre d’action.
Elle ne discernait plus son intérêt de l’intérêt du monde, son orgueil de sa générosité. Elle croyait avoir conquis, en se donnant, le droit de dominer, et elle avait eu des façons hautaines de propager la liberté elle-même. La Révolution avait été une fièvre d’enthousiasme humain et d’orgueil national. Elle voulait bien que les peuples fussent libres, mais libres par elle, des peuples libérés, des peuples affranchis, c’est-à-dire formant autour d’elle et sous son patronage auguste de libératrice une clientèle reconnaissante. Quoi ! tous ces peuples maintenant allaient-ils donc se constituer par leur propre effort, devenir des puissances vraiment et pleinement autonomes ? Toute cette argile qu’elle avait cru pétrir et animer du souffle de sa bouche allait donc s’animer d’une étincelle intérieure ? Elle pourrait être menacée demain, non plus par des coalitions accidentelles et passagères qui attestaient sa puissance même et l’éclat de son destin, mais par la constitution permanente et par la vie normale de grandes nations indépendantes et redoutables ... Son droit d’aînesse européenne allait lui échapper ; son privilège d’unité allait se communiquer à d’autres ; son instinct de conservation s’inquiétait et son orgueil d’idéalisme souffrait comme sa vanité de domination.
C’est déjà beaucoup qu’en cette crise profonde de la France tant de consciences françaises se soient trouvées pour accepter et même pour saluer avec joie les destins nouveaux. Qui pourrait lui faire grief de ne pas avoir pratiqué d’emblée, avec unanimité et avec suite la politique internationale qui convenait à l’idée nouvelle ? Il lui aurait été plus facile d’accepter cet élargissement du rôle des autres peuples si elle-même avait pu développer d’un mouvement régulier toutes les forces de démocratie, de liberté politique et de progrès social que contient le génie de la Révolution. Sa fierté eût été consolée si elle avait gardé, dans sa vie intérieure, une avance sur les autres nations qui s’organisaient et se libéraient à leur tour. Mais quoi, dans la France même de la Révolution la démocratie paraissait condamnée, par la monarchie bourgeoise et censitaire, à un demi-avortement. Il semblait à plus d’un esprit que la France ne pourrait retrouver la pleine liberté révolutionnaire que par la force d’expansion révolutionnaire. Et la tentation des vieilles primautés s’insinuait à nouveau dans le rêve de démocratie. Quinet nous a laissé de ce trouble de conscience un éloquent témoignage dans un de ses écrits : « 1815 et 1840 ». C’est au moment où la politique brouillonne de M. Thiers provoquait contre la France une coalition européenne où la Prusse était entrée : Quinet reprend d’un accent belliqueux la revendication française des « frontières naturelles » ; il veut, comme Danton, porter la France au Rhin. Il sonne la fanfare d’un nationalisme vigoureux en proclamant qu’il n’y a pas de liberté intérieure pour un peuple sans la pleine indépendance extérieure et que cette pleine indépendance n’existera point pour le peuple français tant qu’il n’aura pas dilaté ses frontières et retrouvé la partie la plus nécessaire, la plus nationale des conquêtes de la Révolution. Cet intérêt est si vital pour la France et elle est menacée, si elle se résigne, d’une telle déchéance qu’il vaut mieux pour elle assumer seule le risque d’une guerre générale contre la coalition européenne, à la condition de bien comprendre qu’elle joue cette fois son existence même, qu’elle ne peut sans périr subir une invasion nouvelle, un amoindrissement nouveau, et que toute la terre du pays doit se soulever contre l’étranger avec la violence d’une convulsion naturelle. Toutes les tentatives gouvernementales seront vaines, la démocratie populaire sera frappée d’impuissance comme l’oligarchie bourgeoise, le peuple sera débile comme le pouvoir tant que le ressort de la vie nationale sera comprimé et faussé par les traités de 1815. « Plus j’y pense, plus je reste persuadé que ni le despotisme, ni la liberté, ni le gouvernement, ni les partis ne peuvent se fonder d’une manière assurée sur un État dont les bases ont été mutilées par la guerre, et que la paix n’a pas tenté de réparer. Chaque jour, je me convaincs que le pouvoir chancellera aussi longtemps que chancellera le pays, assis sur les traités de 1815 ; qu’il n’est pire fondement que la défaite ; que surtout il faut désespérer de la liberté si l’on ne peut recouvrer l’indépendance. L’État craque sur les bases menteuses que nos ennemis lui ont faites de leurs mains, et au lieu de le soutenir, nous nous rejetons les uns aux autres les causes de ce dépérissement général. Je vois autour de nous des pays, où l’on est unanime dans les projets de conquête ; ils marchent, malgré leurs divisions apparentes, comme un seul homme, à l’accomplissement de leurs desseins sur le globe. Et nous, non seulement nous nous interdisons, comme au vieillard de la fable, toute vaste pensée, tous longs espoirs, tout projet d’accroissement, mais nous ne pouvons même nous réunir pour reconnaître le mal qui nous fait tous périr.
« Pour la France, il ne s’agit pas tant de conquérir que de s’affranchir, non pas tant de s’accroître que de se réparer, elle ne doit pas faire un mouvement qui ne la mène à la délivrance du droit public des invasions. Tout ce qui est dans cette voie est bien, tout ce qui est contraire est mal. Royauté, république, juste-milieu, démocratie, bourgeoisie, aristocratie, hommes de théorie, hommes de pratique, tous ont là-dessus le même intérêt ; c’est le point où leur réconciliation est forcée, puisque chacun de nos partis ne sera rien qu’une ombre aussi longtemps qu’il n’y aura parmi nous qu’une ombre de France, et que nos débats intérieurs seront stériles et pour le monde et pour nous-mêmes tant que, d’une manière quelconque, par les négociations ou par la guerre, nous ne nous serons pas relevés du sépulcre de Waterloo. C’est ainsi que l’Allemagne est restée méconnaissable aussi longtemps qu’a duré le traité de Westphalie .... Je sais qu’il est dangereux jusqu’à la mort de touchera ces traités (de 1815), mais je sais aussi que nous périssons immanquablement si nous ne pouvons en sortir, et je vois devant nous la vieillesse prématurée qui s’avance. Car pour porter haut le drapeau de la civilisation moderne il faut un peuple qui, loin de chanceler à chaque pas, soit, au contraire, appuyé sur des bases inexpugnables. Il faut que les nations qui lui confient ce dépôt se reposent en sa force. Que l’immensité du danger relève donc les esprits au lieu de les abattre... Ô France, pays de tant d’amour et de tant de haine... qu’arriverait-il si ton nom n’était plus une protection et la force un refuge pour tous les faibles ? Ce jour-là il faudrait croire les prophéties de mort qui annoncent la chute des sociétés modernes et la ruine de toute espérance. »
Telle était, sur ce haut esprit, la fascination des souvenirs révolutionnaires et napoléoniens. Quoi ! la France de 1840, avec son Alsace et sa Lorraine, la France qui touchait au Rhin et qui par Strasbourg menaçait le cœur de l’Allemagne encore divisée, cette France n’était qu’une ombre de France ! et elle était incapable de faire sa grande œuvre de démocratie, de liberté politique, de justice sociale et de solidarité humaine tant qu’elle n’aurait pas de nouveau, et par la force de l’épée, conquis toute la rive gauche du Rhin.
3. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 22:08
"Je soussigné, Leymarie, Léonard, soldat de 2e classe, né à Seillac (Corrèze).
Le Conseil de Guerre me condamne à la peine de mort pour mutilation volontaire et je déclare formelmen que je sui innocan. Je suis blessé ou par la mitraille ennemie ou par mon fusi, comme l’exige le major, mai accidentelmen, mai non volontairemen, et je jure que je suis innocan, et je répète que je suis innocan. Je prouverai que j’ai fait mon devoir et que j’aie servi avec amour et fidélitée, et je je n’ai jamais féblie à mon devoir.
Et je jure devandieux que je sui innocan.
Léonard Leymarie"
Leymarie a été fusillé le 12 décembre 1914 à Fontenoy.
4. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 22:09
Une lettre citée par le rapport du 30 mai 1917 de la Section de renseignements aux Armées.
"Je te dirais qu’en ce moment tous les combattants en ont marre de l’existence. Il y en a beaucoup qui désertent - 10 à ma compagnie qui ont mis les bouts de bois dans la crainte d’aller à l’attaque. Je crois qu’on va faire comme chez les Russes, personne ne voudra plus marcher. Il est vrai que ce n’est plus une vie d’aller se faire trouer la peau pour gagner une tranchée ou deux, et ne rien gagner."
5. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 22:09
Lettre d’un soldat (1917), retenue par le contrôle postal.
"Tous les soldats crient : « A bas la guerre ! » et refusent de prendre les lignes. J’espère que tous en feront autant et que nous finirons ce carnage depuis qu’il dure... A Soissons, ils ont tué deux gendarmes.
Nous n’avons rien à gagner à la continuation de la guerre. Ça a l’air de chauffer grave à Paris avec les grèves. Tant mieux."
6. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 22:11
Lettre d’un soldat du 128e RI, Ve Armée.
"24 mai [1917] Voici les faits. La journée s’était passée dans le plus grand calme, il y avait eu même moins d’abus sur le pinard que les jours précédents. Mais après un petit incident à la 11e Compagnie (assaut de boxe du lieutenant avec un poilu) juste au moment de la soupe, il fut décidé dans tout le 3e bataillon et le 2e bataillon aussi que personne ne monterait. Les officiers ayant eu vent de cette rumeur passèrent dans leurs compagnies à la soupe afin de sonder les poilus et les exhorter au calme et à monter quand même. Rien à faire : tout était décidé ; à 17 heures, heure du rassemblement, tous sortirent dans la rue en veste et calot, et entonnèrent l’Internationale. Les fusils mitrailleurs étaient braqués, prêts à tirer si une compagnie avait le malheur de monter. Commandant, colonel et général de Corps vinrent supplier les hommes. Ce dernier fut hué au cri de « A mort ». Vous voyez d’ici le tableau."
7. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 16:38
Voilà comment les historiens présentent la chose :
« Les causes de la Première Guerre Mondiale sont à rechercher dans un passé quelque peu lointain : depuis 1870, la guerre était devenue « l’industrie nationale » de l’Allemagne qui se croyait appelée à remplir une mission divine d’hégémonie universelle. Son expansion économique et son orgueil dressèrent contre elle la Triple Entente (l’Angleterre, la France et la Russie). La politique des armements qui s’ensuivit rendit le conflit inévitable.
Mais la cause la plus proche fut l’assassinat de l’Archiduc François Ferdinand, héritier d’Autriche à Sarajevo le 28 juin 1914 par un étudiant serbe, Gavrilo Princip ; il deviendra le prétexte recherché pour déclarer la guerre au Conseil secret de Potsdam, le 5 juillet 1914. L’ultimatum autrichien du 23 juillet 1914 à dessein inacceptable par la Serbie, met en garde la Russie protectrice des Slaves. L’Autriche rejette la réponse serbe et l’Allemagne écarte les chancelleries qui veulent tenter une médiation. »
8. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 21:04
Amusant : sur les buts de guerre des belligérants, Wikipedia dans une énorme pages n’arrive à faire que deux lignes sur les buts de guerre de la France !!! Mais on ne compte pas le nombre de lignes des buts de guerre de l’Allemagne. Normal : la thèse est que la France n’avait que des buts de paix !!!!
voir ici
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 mars 2014, 16:31, par luc nemeth
Bonjour.
Il n’y a pas que... Wikipedia, qui est en cause : et ce qu’on peut d’ores et déjà entendre, alors que le "centenaire" de 1914 n’est pas encore commencé stricto sensu, donne une idée de ce à quoi on va avoir droit.
Mais en plus du mensonge patriotique, qui de toute façon ne peut plus aujourd’hui être reservi sous la même forme, et risque de laisser place -construction européenne oblige- à un versement de larmichettes oecuménique autour des victimes-des-deux-camps, et en marge de la "fabrique des émotions", plus spécifiquement destinée au téléspectateur, on assiste à l’émergence d’un bourage de crâne insidieux et qui vise à accréditer que grâce (?) à la première guerre mondiale nous serions entrés dans la modernité -le mot est dit. Déjà, il y a là de quoi donner envie de fuir à reculons devant la modernité, mais en plus : c’est là une théorie qui demande à être nuancée.
Certes l’entrée en guerre de 1914 fut la victoire des couches dites modernistes, du Capital (disons, pour résumer, tout ce que l’on appelle de nos jours le complexe militaro-industriel). Mais on ne se débarrassera pas si facilement de ce qu’a rappelé Arno Maier dans son excellent livre sur la Persistance de l’Ancien Régime et le fait qu’à la veille de la première guerre mondiale l’Europe était encore gouvernée par des nostalgiques de cet ordre-là. Et si effectivement ce furent comme presque toujours les forces "modernistes" qui allaient dicter leur loi elles furent ici puissamment secondées par la caste dirigeante, intimement persuadée qu’un bon bain de sang ne pouvait que faire du bien à ce prolétariat qui n’en finissait pas de relever la tête...
Cordialement
PS. j’ai assisté d’ores et déjà à deux "débats", organisés dans le cadre des festivités. J’ai été effrayé par la promiscuité des historiens, avec tout ce qui relève du commémoratif : il n’y avait même plus le début du commencement d’un semblant de distance. Même aux Etats-Unis, où le patriotisme se porte bien, un pareil spectacle de servilité aurait difficilement été concevable. Quoi que l’on puisse penser pour le reste des commémorations, et de ceux à qui elles profitent : à chacun, son métier... et les vaches seront bien gardées !
2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 mars 2014, 18:49, par Robert Paris
Merci de tes remarques qui me semblent tout à fait judicieuses. On ne peut pas compter sur l’Histoire officielle, sur les institutions de la bourgeoisie, sur les hommes politiques, sur les spécialistes, sur les média pour nous révéler l’état d’affolement de la grande bourgeoisie, d’effondrement de la confiance en elles-mêmes des classes dirigeantes qui a donné naissance à cette boucherie "moderne".
Qu’il suffise de faire remarquer qu’aucun homme politique ne voulait accepter le poste de chef du gouvernement et qu’ils se refilaient tous la patate chaude.
Nous vivons aujourd’hui au moment où il est le plus facile de comprendre une telle situation puisqu’elle se reproduit... La classe dirigeante est très inquiète de l’avenir, quand les distributions massives de milliers de milliards de dollars, de yens, d’euros ou de livres ne suffiront plus à faire tenir les marchés financiers et où tout l’édifice croulera encore plus qu’en 2007-2008 et où la vague révolutionnaire prolétarienne commencera de monter dès que les prolétaires auront pris conscience de l’absence d’avenir qu’offre le capitalisme.
On ne risque certes pas de nous montrer que c’est cette absence d’avenir qui a entraîné les boucheries précédentes.
9. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 21:07
Sur la thèse "l’Allemagne est cause de tout", voici Foch dans ses mémoires :
« L’Allemagne de 1914, lancée dans la Weltpolitik, n’eût jamais déclaré la guerre si elle avait posément compris son intérêt. Elle pouvait, sans faire appel aux armes, poursuivre dans le monde son développement économique. Qui eût osé se mettre en travers ? Formidable déjà, et soutenu d’ailleurs par une active propagande comme aussi par une puissance militaire reconnue sur terre et sur mer, qui garantissait à ses voyageurs de commerce comme à ses ingénieurs en quête de concessions à l’étranger un accueil des plus avantageux et par là une capacité de pénétration et d’acquisition incomparable, le développement allemand dans une marche constante distançait grandement celui des autres nations. Sans faire de guerre nouvelle, l’Allemagne conquérait progressivement le monde. Le jour où l’humanité se serait réveillée de ses vieilles habitudes pour mesurer la réduction de ses libertés et de ses possibilités, elle se serait trouvée tenue par les éléments allemands établis dans les différents pays sous toutes les formes mais restés toujours citoyens allemands grâce à leur double nationalité, et recevant le mot d’ordre de Berlin. D’ailleurs, pas un gouvernement, surtout d’essence démocratique, n’aurait pris la décision, devant cette hégémonie allemande en marche, et en vue d’éviter le désastre final, la domination de son pays par l’élément allemand, de prendre des dispositions particulières de protection. Il aurait reculé devant la discussion et la lutte à entreprendre avec un état si fortement armé que l’Allemagne. Loin de paraître chercher la guerre, encore plus éloigné de la déclarer, il aurait même craint de la provoquer, tant il eût redouté de déchaîner les horreurs qu’allait entraîner un conflit moderne entre de grandes nations. En quelque vingt ans de paix le monde se fût trouvé Germanisé, l’humanité ligotée.
Mais le gouvernement de Berlin, grisé par sa puissance et emporté par un parti pangermaniste aveugle, pleinement confiant d’ailleurs en son armée supérieure à toute autre, ne craignait pas de recourir aux armes et d’ouvrir une ère de lourdes hécatombes et de redoutables aventures pour hâter cette domination du monde qui lui était réservée, à son sens.
L’Allemagne de 1914 a d’ailleurs couru avec élan aux armes, pour appuyer ses grandioses et folles aspirations et sans mesurer la grandeur des crimes qu’elle assumait devant l’humanité. Elle était bien devenue une Grande Prusse. »
10. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 21:07
Et toujours Foch explique que
« La France de 1914, loin de désirer la guerre, à plus forte raison de la rechercher, ne la voulait pas. Quand la lutte parut imminente à la fin de juillet, le gouvernement français consacra tous ses efforts à la conjurer. Mais pour faire honneur à sa signature, si les Alliés étaient attaqués, il marcherait.
C’était la politique que la République n’avait cessé de pratiquer depuis plus de quarante ans. Sans jamais oublier les provinces perdues, tout en cherchant à cicatriser la plaie toujours saignante qu’avait causée leur arrachement, la France avait répondu par une attitude pleine de dignité et de résignation aux virulentes provocations des incidents de Schnoebelé, de Tanger, d’Agadir, de Saverne et autres. Elle avait successivement réduit la durée de son service militaire de cinq ans à trois ans, puis de trois ans à deux ans, et ce n’est que sous la menace des continuels renforcements allemands et sous l’empire des plus légitimes inquiétudes et d’une évidente menace, qu’elle était revenue hâtivement en 1913 au service de trois ans. Il en était grand temps. Elle était bien résolue à ne recourir à la force que le jour où son existence et sa liberté seraient mises en péril par une agression allemande. Seul un pareil danger pouvait décider à la guerre un gouvernement démocratique, assez éclairé pour mesurer la grandeur des sacrifices et l’ampleur du cataclysme qu’une guerre européenne devait entraîner dans la vie des peuples.
Au mois de juillet de cette année 1914, si le ciel franco-allemand continuait de rester chargé de nuages, la France toujours forte de sa sagesse croyait l’orage si peu prochain que le Président de la République et le Président du Conseil des ministres partaient, au lendemain de la fête nationale, pour la Russie, en un voyage de plusieurs semaines. Pour un grand nombre d’autorités, pour le Parlement, commençait la saison des vacances. Moi-même je partais de Nancy le 18 juillet avec l’intention de passer quinze jours de congé en Bretagne. »
11. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 21:24, par RP
François Furet sur la première guerre mondiale :
« - Oui, il me semble que la guerre de 14 a pour le 20ème siècle une importance absolument fondamentale, une importance aussi grande que la Révolution française pour l’histoire du 19ème. C’est l’événement dont sort le caractère particulier du siècle et ses tragédies. Pourquoi ? Parce qu’il y a trois éléments nouveaux dans la guerre de 14. C’est la 1ère guerre « démocratique » au sens où « tout le monde y va », où elle touche le tissu social plus profondément que n’importe quelle autre guerre du passé, y compris les guerres de la Révolution et de l’Empire. C’est la 1ère guerre industrielle, technique, où l’on peut observer l’effet multiplicateur de la technologie moderne sur le caractère du massacre. Et c’est la 1ère guerre aussi interminable, au sens où elle n’est pas finissable par un compromis. A partir de la Marne, les armées sont enterrées, on ne peut plus gagner que deux ou trois cents mètres au prix de pertes terribles et d’ailleurs la République française est aussi indifférente aux massacres de ses fils en un sens que l’Empire allemand. Et plus elle dure, plus les sacrifices qu’elle provoque rendent injustifiable une paix de compromis. Et par conséquent, il y a dans cette guerre quelque chose d’extraordinaire, c’est qu’elle prend un caractère idéologiquement interminable alors qu’elle n’a pas commencé comme cela. Elle a commencé comme une guerre de puissances et elle dure comme une guerre sans autre fin possible que l’extermination de l’adversaire. Alors voilà, quand on prend ces trois caractères ensemble, on a un événement gigantesque. »
Si quelqu’un a compris, dans cette intervention, d’où vient cette guerre et où elle va, il nous le dit... A part que Furet est très enthousiaste pour une sale boucherie !
12. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 14 février 2014, 22:36
Lettres de "poilus" de la guerre de 1914-1918 :
Verdun, Le 18 mars 1916, Ma chérie, Je t’écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S’il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m’a coûté mon pied gauche et ma blessure s’est infectée. Les médecins disent qu’il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j’ai été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d’attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, nous n’étions plus que quinze mille environ. C’est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m’arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu’un jour plus tard, dans une tente d’infirmerie. Plus tard, j’appris que parmi les vingt mille soldats qui étaient partis à l’assaut, seuls cinq mille avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le Général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m’as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d’il y a deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu’il n’aille jamais dans l’armée pour qu’il ne meure pas bêtement comme moi. Je t’aime, j’espère qu’on se reverra dans un autre monde, je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m’as fait passer, je t’aimerai toujours. Adieu Soldat Charles Guinant
13. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 14 février 2014, 22:45
Lettre d’Henri Floch fusillé pour l’exemple à Vingré. Le caporal Henri Floch était greffier de la justice de paix à Breteuil.
Ma bien chère Lucie, Quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé.
Voici pourquoi : Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de deux heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m’ont fait prisonnier avec deux autres camarades. J’ai profité d’un moment de bousculade pour m’échapper des mains des Allemands. J’ai suivi mes camarades, et ensuite, j’ai été accusé d’abandon de poste en présence de l’ennemi.
Nous sommes passés vingt-quatre hier soir au Conseil de Guerre. Six ont été condamnés à mort dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu’il y a dedans.
Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l’âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l’embarras dans lequel je vais te mettre...
Ma petite Lucie, encore une fois, pardon.
Je vais me confesser à l’instant, et j’espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d’abandon de poste qui m’est reproché. Si au lieu de m’échapper des Allemands, j’étais resté prisonnier, j’aurais encore la vie sauve. C’est la fatalité
Ma dernière pensée, à toi, jusqu’au bout. Henri Floch
14. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 février 2014, 07:55, par alain
Quel lien entre crise économique, révolution et guerre ?
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 29 mars 2014, 13:34, par luc nemeth
ta question est intéressante, alain, et on pourrait encore y ajouter : le lien entre crise économique, révolution, et... paix -lorsque, sous le nom de paix, se remet en place (sous des formes différentes, c’est l’évidence) l’ordre ancien qui avait produit la crise, et en bien des cas, trouvé son salut dans la guerre... Les mots, ici ne sont pas innocents, ni même, leur séquence : ainsi à Stanford, où on ne penche pas véritablement à gauche, se trouve la Hoover Institution for... War, Revolution and Peace !
PS. c’est là une question que j’ai été amené à me poser car j’avais consacré ma thèse à la défunte SDN : et sans me lancer dans une comparaison poussée je n’avais pu qu’établir le rapprochement entre la Pax americana, nom donné au nouvel équilibre (?) découlant de l’armistice de 1918, et la... Pax romana.
15. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 février 2014, 08:02, par Robert Paris
Il est certain que la crise de 1867 a poussé les puissances européennes à la guerre franco-allemande de 1870 comme elle a poussé le prolétariat à s’organiser politiquement dans le courant socialiste, que la crise de 1929 a produit la montée révolutionnaire de 1936 et la guerre mondiale de 1939 et que la crise de 2007-2008 a produit les révolutions du Maghreb et du monde arabe et finira par produire une nouvelle guerre mondiale si on ne met pas fin au système de la propriété privée des moyens de production, système qui a atteint en 2007 ses limites de capitalisation, trop inférieure à la masse des capitaux existants.
Mais la guerre n’est pas seulement la réponse finale de la bourgeoisie à la crise économique ; elle est aussi une réponse à la révolution sociale. La bourgeoisie a transformé partout les risques révolutionnaires en guerres mondiales : tous les empires subissaient la montée révolutionnaire avant 1914. Elle n’a fait ainsi que retarder et aviver la révolution qui a renversé tous ces empires. Elle a aussi transformé toutes les révolutions en guerre : Russie 1918, Espagne 1936 et actuellement la Syrie.
16. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 février 2014, 16:49, par Robert Paris
« La haine de classe contre le prolétariat et la menace immédiate de révolution sociale qu’il représente détermine intégralement les faits et gestes des classes bourgeoises… »
Rosa Luxembourg dans « Fragment sur la guerre, la question nationale et la révolution »
17. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 février 2014, 14:44
Cette guerre aussi appelée « première guerre industrielle, a vu un développement extraordinaire des groupes capitalistes industriels et financiers dans chacun des pays belligérants, particulièrement en France, en Allemagne et en Grande Bretagne.
Tout ce beau monde s’était engraissé avec les fournitures de guerre, tandis qu’à l’arrière les salaires étaient réduits au minimum vital « pour assurer la victoire de la patrie » et bien sûr « pour ne pas compromettre la compétitivité des entreprises » (déjà !). Toutes les classes dominantes avaient eu intérêt à déclencher la guerre : les grands propriétaires fonciers, les marchands de canons, les banquiers et les spéculateurs avides.
En Allemagne le groupe sidérurgique Krupp a clôturé les années de guerre avec un bénéfice de quelque 40 millions de marks de l’époque, une somme énorme. Le journaliste allemand Guntter Walraff a relaté comment les soldats allemands se faisaient déchiqueter par les grenades britanniques pourvues de mécanisme de mise à feu breveté parKrupp. Pour chaque grenade lancée sur les « armées de la patrie » Kruppempochait 60 marks.
Les travailleurs des pays en guerre s’entretuaient tandis que Krupp et le fabriquant britannique de mitrailleuses Vickers pouvaient compter sur une « collaboration fructueuse ».
En France, le groupe Schneider fournira une grande partie de l’armement et des munitions utilisés pendant 4 ans.
Les groupes de constructions mécaniques comme Renault, les sociétés minières et bien d’autres vont s’étendre, s’enrichir comme jamais, car les causes de cette guerre sont avant tout et de loin économiques.
Cette guerre fut une époque bénie pour les maîtres de forges, chaque combattant « consommant » trois tonnes d’acier par an. En 1916 François de Wendel, qui se vantait d’être un grand patriote, demanda dans une lettre à l’Etat-major français que l’on évite de bombarder la zone de Briey en Lorraine, en territoire occupé par les allemands, pour épargner les usines sidérurgiques de la famille. Ces usines où se fabriquaient pourtant des obus pour l’armée allemande, ne furent pas bombardées.
Renault qui dispose de 500 ouvriers en septembre 14 à la production des moteurs d’avions, en fera travailler plus de 4.000 dans son usine de Billancourt en 1917. En 1914 on produit en France 100 mitrailleuses, on en fabrique 17.000 en 1918. Au Royaume –Uni on produit 5 millions d’obus en 1914, 67 millions en 1918.
La population civile est sollicitée, les emprunts serviront à financer « l’effort de guerre ».
La grande guerre est dans la continuité des conflits liés au développement du capitalisme dans le monde. Pour Lénine, c’est un conflit impérialiste pour le partage du monde, pour la redistribution des colonies, des zones d’influence du capital financier (Lénine : l’impérialisme, stade suprême du capitalisme – 1917).
18. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 février 2014, 18:51
Jean-Jacques Becker écrit :
« Un grand historien comme Baptiste Duroselle considérait, à la fin de sa vie, que finalement le mystère de la guerre de 1914 n’avait pas été percé. (« La grande guerre des Français, l’incompréhensible »)
Mais il est caractéristique que l’ouvrage de Jean-Jacques Becker titrait sur des "responsabilités allemandes", pas de responsabilités françaises !
19. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 6 mars 2014, 18:14
"On a dit aux allemands : ’En avant, pour la guerre fraîche et joyeuse ! Nach Paris et Dieu avec nous., pour la plus grande Allemagne’ Et les lourds allemands paisibles, qui prennent tout au sérieux, se sont ébranlés pour la conquête, se sont mués en bêtes féroces.
On a dit aux français ’On nous attaque. C’est la guerre du Droit et de la Revanche. A Berlin !’ Et les français pacifistes, les français qui ne prennent rien au sérieux, ont interrompu leurs rèveries de petits rentiers pour aller se battre.
(...) Vingt millions, tous de bonne foi, tous d’accord avec Dieu et leur Prince... Vingt millions d’imbéciles... Comme moi !"
"La Peur" (août 14) - Gabriel Chevallier
20. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 6 mars 2014, 18:19
"Cette tranchée toute neuve était ourlée de terre fraîche, comme une fosse commune. C’était peut-être pour gagner du temps qu’on nous y avait mis vivants."
"Les Croix de Bois" (Avant l’attaque - 1915) - Dorgelès
21. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 6 mars 2014, 18:22
"- Vous avez de bons moments, là-haut ?
Suffoqué, je regarde ce vieux cornichon blafard. Mais je lui réponds vite, suavement :
– Oh ! oui, monsieur...
Son visage s’épanouit. Je sens qu’il va s’écrier : "Ah ! ces sacrés poilus !"
Alors j’ajoute :
– ... On s’amuse bien : tous les soirs nous enterrons nos copains !"
"La Peur" (en permission) - G. Chevalier
22. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 4 avril 2014, 11:25, par Verel
Le capitalisme et la guerre de 1914
Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage, a dit Jaurès. Pour ceux qui pensent que le capitalisme est forcément la cause de tous les maux du monde, cette phrase est en soit une preuve de leur conviction : la guerre de 1914 : 1918 est le fruit du capitalisme, voire le résultat d’un complot organisé par des capitalistes.
France Inter donnait la parole à ses auditeurs mardi soir, 11 novembre, pour interroger les historiens de la grande guerre. On a eu ainsi droit aux questions de deux adeptes de la thèse ci-dessus : le moins qu’on puisse dire est que les historiens n’ont pas été dans leur sens !
Le premier intervenant voyait dans le déclenchement de la guerre une volonté de mettre fin à la montée dangereuse (pour les capitalistes) du mouvement ouvrier et dans l’armistice la conséquence de la prise de pouvoir par Lénine et la crainte de son expansion.
L’historien de service lui a expliqué qu’en réalité, en 1914, les mouvements ouvriers révolutionnaires étaient faibles voire inexistants et que les partis socialistes avaient très vite soutenu leur pays (Jean Jaurès était une exception).
Il n’a pas répondu directement sur la question touchant la fin de la guerre, mais d’autres réponses ont clairement présenté la réalité bien connue des historiens : en 1918, l’Allemagne était complètement à bout de souffle, au bord de l’effondrement (en raison du blocus naval en particulier) et l’offensive qu’elle a mené au début de l’année était pour elle l’opération de la dernière chance, avant que les américains n’arrivent en masse. En novembre elle était absolument incapable de résister à l’avancée des troupes alliées.
Le second intervenant a été encore plus direct, accusant un « groupe franco allemand de capitalistes » d’avoir fomenté la guerre (pour vendre des armes bien sûr) et en fournissant la preuve par la protection accordée à un de Wendel ;
Le réponse de l’historien a été sans nuances : l’immense majorité des capitalistes étaient pour la paix, considérant que la guerre est mauvaise pour le business. Il est vrai que ceux qui n’ont aucune idée de ce qu’est la gestion d’une entreprise peuvent ignorer cette évidence.
J’imagine que ce second intervenant n’a pas du tout été convaincu, et qu’il en a voulu à l’émission de ne pas lui avoir permis de citer tous les arguments en faveur de sa thèse : on connaît la capacité de certains à ne voir ou entendre que ce qui les arrange et à confondre indices et preuves.
L’historien a au contraire pointé les principales causes de la guerre : les impérialismes et les nationalismes.
D’une certaine manière, la guerre de 1914 est aussi un lointain résultat de la révolution française. Celle-ci a popularisé dans toute l’Europe l’idée du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cette idée a débouché sur le refus des monarchies de droit divin et la volonté de la démocratie. Mais elle s’est traduite aussi par la valorisation de la notion de peuple : le sentiment d’appartenance à un même peuple, souvent lié à la langue se traduit au 19ème siècle par la lutte des allemands contre Napoléon à partir de 1813, par l’adhésion des Italiens à la démarche de Garibaldi qui débouche sur l’unité italienne, par l’adhésion des allemands à un regroupement autour de la Prusse, aussi bien que par les réactions des français à l’invasion de leur pays en 1870.
La conscience de faire partie de différents peuples mine l’empire Austro Hongrois à la fin du 19ème siècle, comme il fait des Balkans une poudrière.
C’est ce nationalisme et non pas le capitalisme qui est à la source de la guerre. De même qu’en 1993 ou en 2005, les hommes d’affaires sont pour l’Europe et son pacifisme et les souverainistes de droite ou de gauche pour le non.
23. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 avril 2014, 17:10
Sur la première guerre mondiale : COMMENT ENTERRER EN COULEUR LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES DE LA GUERRE DE 1914 ?
24. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 25 avril 2014, 20:08
Un livre de deux universitaires américains, The Panic of 1907, opportunément paru l’année dernière (New York, Wiley & Sons), suggère de nombreux parallèles entre les paniques de 1907 et de 2008, en même temps qu’il indique quelques leçons.
Car la panique de 1907 est la dernière crise américaine proprement financière – celle qui a donné naissance au système monétaire américain actuel, et à la Réserve Fédérale.
Et comme celle de 2008, et contrairement aux crises de 1929, 1937, de 1946, de 1973, de 1980, de 1991 et de 2001, la crise de 1907 était d’abord et avant tout une crise d’origine financière.
La crise était survenue au terme d’une période de grande inventivité financière qui avait vu naître les « trusts », entités comparables à certains hedge funds actuels et à quelques grandes sociétés d’investissement coté et non coté, qui usaient et abusaient de ce qu’on appellerait aujourd’hui des facilités bancaires.
C’est quand l’un des plus fameux trusts, le Knickerbocker Trust Company, a cessé d’honorer ses engagements que la crise de 1907 a pris de l’ampleur et s’est transformée en panique boursière : les grands indices boursiers perdent alors 40 % en un an – exactement comme ils ont perdu entre 40 et 50 % depuis 15 mois, leurs pertes s’étant accentués quand les firmes les plus engagées dans les produits les plus « inventifs » se sont retrouvé en cessation de paiement (Bear Sterns, AIG, Lehman Brothers).
Autre parallèle – contraire à ce qu’on dit ici ou là sur le fait que la crise de 2008 serait la première crise d’une finance mondialisée – la crise de 1907 affecta la quasi-totalité des places financières du globe, du Danemark à l’Egypte, du Mexique à l’Allemagne, ou de l’Italie à l’Argentine.
Autre parallèle encore : c’est parce que le président Theodore Roosevelt était étranger – et hostile – à ce monde financier que ses entités multiformes ont pu proliférer presque hors de tout contrôle, exactement comme les produits dérivés ont pu proliférer pour le plus grand bonheur (comprenez : pour la plus grande fortune) des banques d’affaires qui les commercialisent et des clients, hedge funds, fonds communs de placements, sociétés d’assurance, banques… qui les utilisent.
25. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 mai 2014, 17:24, par Robert Paris
Crise, guerre et révolution sont très liés et les dates déjà le montrent clairement :
La guerre de 1871 est liée à la crise de 1866 et à la crise de 1873. Révolution en 1871.
La guerre de 1914 est liée à la crise de 1907 et à la crise de 1913. Révolution en 1917.
La guerre de 1939 est liée à la crise de 1929 et à la crise de 1937. Révolution en 1945.
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 31 mai 2014, 10:45, par Max
A la croissance des années 1909-1912 succède une récession qui touche surtout les pays débiteurs ou fournisseurs de matières premières.
La crise s’est manifestée en Allemagne au début de 1913 dans le bâtiment et s’est étendue en mars à la sidérurgie qui, en quatre ans, avait augmenté sa production de près de 60%. Aussitôt la Reichbank a décidé de relevé son taux d’escompte de 5 à 6% et le chômage est apparu. La Grande-Bretagne à son tour a été touchée, avec un léger décalage, à travers la baisse des prix de la fonte et les difficultés de l’industrie cotonnière. Les US ont été atteints au printemps, la France au mois d’aout.
La crise se généralise.
Si les effets de cette crise sont assez limités dans les pays industriels, elle a de graves répercussions dans les pays fournisseurs de matières premières ou importateurs de capitaux. Ainsi, l’Argentine est fortement touchée par la hausse du taux d’escompte de la banque d’Angleterre, qui a conduit la plupart des créanciers britanniques à rapatrier leurs capitaux à court terme et les banques argentines à placer les leurs à Londres...
extrait d’un article des Echos de 1913.
2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er juin 2014, 08:15, par Max
Quel lien entre la crise financière de 1907 et la Première Guerre mondiale ?
L’ approche du 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale en 1914 fait réagir les dirigeants politiques et les commentateurs bourgeois de la situation politique et économique de la planète. Le Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, a même déclaré récemment que la polarisation croissante entre le nord et le sud de l’Europe a fait reculer le continent d’un siècle.
L’histoire des Etats-Unis a été marquée par de nombreuses crises bancaires. Après la Guerre de Sécession est apparu un système de banques nationales, regroupées au sein de chambres de compensation visant à établir une solidarité au sein du secteur. Dans certains États, les autorités garantissaient les dépôts effectués dans les banques nationales.
Toutefois, à partir du début du xxe siècle (comme au début du XXIième avec la crise des subprimes), une partie de plus en plus importante de l’activité bancaire commença à se dérouler dans des organismes financiers new-yorkais appelés "Trusts" qui ne faisaient pas partie de ce système de protection, même s’ils acceptaient des dépôts comme une banque traditionnelle.
La croissance était forte au début du siècle dernier, et les Trusts pouvaient investir sur les marchés boursiers, ce qui était interdit aux banques nationales. En outre, elles étaient soumises à des réglementations nettement moins strictes en matière de liquidité et de réserves. En 1907, les actifs déposés dans ces sociétés non réglementées dépassaient les actifs déposés dans les banques nationales.
Les Trusts distribuant des rendements plus élevés que les banques traditionnelles, ils étaient naturellement incités à prendre de plus en plus de risques. En octobre 1907, la faillite d’un trust provoquée par l’échec d’une opération boursière spéculative va provoquer l’effondrement de ce système, et une ruée des épargnants sur les dépôts des trusts.
En quelques jours, l’indice Dow Jones s’effondre suite à l’arrêt du marché du crédit. Les banquiers traditionnels, emmenés par JP Morgan, vont alors mettre en place un plan de sauvetage qui permettra à la Bourse de retrouver progressivement ses niveaux d’avant la crise.
Mais l’effondrement boursier de 1907 provoqua une crise économique profonde, avec une récession qui dura de mai 1907 à juin 1908, un recul de la production industrielle de 11%, une hausse du taux de chômage de 3 à 8 % et un nombre de faillites vertigineux. L’indice Dow Jones resta toutefois déprimé jusqu’en 1915.
3. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 15 août 2014, 16:18, par Eléonore Visart
Bonjour, excusez moi, ma question est sans doute stupide, mais je ne vois pas en quoi cette Première guerre a rendu certaines nations ou les banquiers plus riches qu’avant la guerre ?
4. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 15 août 2014, 19:18, par Robert Paris
La question n’est pas bête du tout !
On peut lire dans wikipedia :
– L’entreprise Krupp s’enrichit durant la Première Guerre mondiale en s’imposant comme l’une des principales entreprises du complexe militaro-industriel allemand.
- En 1914, lorsque la guerre éclate, la compagnie Renault se lance dans la production de munitions, d’avions militaires et plus tard dans les tanks avec son Renault FT-17. En 1918, Renault est devenu le premier manufacturier privé de France et il est honoré par les Alliés pour sa contribution à l’effort de guerre.
D’abord les marchands de canons évidemment. Les de Dietrich par exemple. Depuis la fin du XIXe siècle, ils avaient un pied de chaque côté de la frontière profitant ainsi, aussi bien du marché allemand que du marché français. La première guerre mondiale fit exploser leurs profits. Pendant les quatre années de guerre, ils firent plus de bénéfices que lors des seize années précédentes. Et pour faire bonne mesure, on trouvait un de Dietrich député au Reichstag pendant que d’autres de ses enfants étaient dans l’armée française.
L’autre industrie qui gagna énormément dans la guerre, ce fut l’automobile, mais pas toujours en fabriquant des voitures. Toutes les grandes firmes automobiles surent obtenir des marchés juteux de l’État.
En 1915, André Citroën décrochait un contrat pour un million d’obus. Pour les fabriquer, il obtint aussi de l’État, une aide pour la construction d’une usine géante, quai de Javel à Paris. Les obus furent livrés avec plusieurs mois de retard. Un rapport établit que Citroën avait vendu ces obus deux fois plus cher que le prix du marché. Il ne fut jamais publié. En revanche les aides de l’État lui permirent de moderniser et d’introduire le travail à la chaîne dans cette usine tournant principalement avec une main-d’oeuvre féminine sous-payée.
Berliet s’enrichit dans les camions ; Renault avec les tracteurs, les avions, les chars, sans oublier les fameux taxis de la Marne.
Quant aux Peugeot, après avoir prospéré dans différents domaines, comme on l’a vu, ils s’étaient lancés dans l’automobile avant la guerre. L’usine de Sochaux fut fondée en 1912 et produisait déjà 4 000 voitures en 1913. Pendant la guerre, la société Peugeot reçut 26 millions de l’État pour fabriquer des moteurs d’avions de chasse, dont aucun ne sera jamais livré, mais cela lui permit d’agrandir ses installations.
D’autres entreprises profitèrent des commandes de guerre. Dans la chimie, Péchiney fut un des premiers à se consacrer à la production de guerre et à profiter des aides de l’État. Le ministère de l’armement construisit et équipa à son profit une usine à Saint-Auban.
C’est aussi grâce à la guerre que se forgea l’empire Boussac. Marcel Boussac, né en 1889 dans une famille de négociants en tissus, fut mobilisé en 1914 mais trouva immédiatement le moyen de ne pas aller au front et mit la main sur des usines dans les Vosges. Il vendit pour 75 millions de francs de fournitures à l’armée, entre 1914 et 1918 : chemises, caleçons, étuis de masques à gaz. La guerre fit sa fortune. En 1918, il pouvait donc racheter des usines défaillantes et se retrouvait à la tête de 15 000 ouvriers.
Bien souvent les patrons ont grugé l’État et se sont enrichis sur le dos des soldats. La société de moteurs d’avions Gnome et Rhône (future SNECMA) vendit ses pièces à l’armée trois fois leur prix réel. Une grande société de pêcherie, La Morue française, livra aux troupes 600 tonnes de poissons avariés. Il faut dire que le sous-secrétaire d’État au ravitaillement, Joseph Thierry, était également administrateur de cette société...
Les profits dégagés pendant la guerre furent faramineux. Globalement c’est toute la grande bourgeoisie qui en sortit renforcée et enrichie. Pendant que les rentiers, les bourgeois moyens ou petits se retrouvaient ruinés, la haute bourgeoisie elle, vit ses positions assurées, sa fortune augmentée.
Certains historiens ont mis en avant la mort au combat de nombreux fils de bourgeois, pour montrer qu’ils avaient aussi payé la guerre. Mais cela ne prouve qu’une chose : c’est qu’en plus d’avoir envoyé à la mort plus de dix millions de fils de paysans et d’ouvriers, la bourgeoisie était prête aussi à sacrifier une partie de ses propres enfants sur l’autel de ses profits.
5. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 25 août 2014, 16:11, par Eléonore Visart
Merci à vous ! J’essaye de bien comprendre tout ceci pour le livre sur lequel je travaille en ce moment. Le premier chapitre est consacré aux deux guerres et je veux y démontrer, qu’aujourd’hui comme alors, pas grand chose n’a changé. Ce sont toujours les "mêmes" au pouvoir. La différence ce sont les moyens qu’ils ont entre les mains et nous aussi...ces moyens le plus souvent découvert "grâce" à la science sans conscience, cette science contre laquelle, Einstein nous mettait en garde. Mais en tant qu’ex-catholique, croyant encore au christianisme (qui n’est pas celui des Eglises), je démontre aussi toute la responsabilité de ces Eglises dans ces grandes guerres et l’état du monde. Quand je pense que Benoit XVI avait choisi ce mafieux de Peter Sutherland comme conseiller financier !! Il est encore au Vatican d’ailleurs. Le Vatican fait aussi partie de toute cette mafia.
6. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 26 août 2014, 05:57, par Robert Paris
Bien sûr, je ne peux que vous encourager dans l’important travail dont vous me parlez. A Vois des Travailleurs, nous ne pensons pas que la religion soit un secours pour lutter contre le système mais nous respectons votre conviction personnelle du moment que vous êtes consciente qu’en tant qu’institution, la religion s’est toujours tournée du côté des classes dirigeantes contre le peuple travailleur. Bien sûr, la guerre est l’un des exemples qui montre ce soutien des religions aux classes dirigeantes et cela ne date pas d’aujourd’hui ! Rappelons qu’en 1914, ce n’est pas par la presse que la population des campagnes a appris la mobilisation générale : c’est par le tocsin des églises !
7. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 31 août 2014, 10:10, par Robert Paris
Vous avez mis le doigt sur un élément important : cette Première guerre a rendu certaines nations, les capitalistes et les banquiers plus riches qu’avant la guerre ! Parce qu’elle a mobilisé les moyens des grands Etats pour l’industrie de guerre !
Pierre Léon décrit cela en détails le changement du capitalisme initié en 1914 dans son ouvrage « Histoire économique et sociale du monde » (tome 1914-1947) :
« Nul n’avait songé à la possibilité d’une production industrielle massive pendant plusieurs années dans des conditions en somme très défavorables au départ… Ce fut une divine surprise : la mobilisation de l’économie fut partout un succès. Elle se caractérisa surtout par une croissance intensive, c’est-à-dire par une augmentation de la productivité du travail grâce à des améliorations techniques… L’assurance d’avoir des débouchés donnait de la témérité aux techniciens et aux financiers. Ces innovations de guerre profitèrent essentiellement à la chimie, la sidérurgie et la construction mécanique (automobiles, avions, bateaux). Le travail à grande échelle et la répartition des commandes s’accompagnèrent de modifications dans l’ampleur de l’organisation des branches industrielles et de mouvements d’intégration financière d’entreprises… De nouvelles dispositions d’esprit animèrent le patronat ; elle s’expliquent par l’absence de concurrence mais aussi par la possibilité d’avoir recours au crédit de l’Etat, ce qui réduisait d’autant la tutelle du capitalisme financier sur l’appareil productif… Tous les changements précédents s’expliquent par l’attrait des profits fournis par l’économie de guerre. Les dividendes substantiels que touchèrent certains actionnaires dès 1915 et l’assurance que donnait désormais l’intervention de l’Etat provoquèrent une reprise du mouvement d’investissement… L’engouement pour les entreprises de matériel de guerre fut naturellement le plus fort ; les profits retirés justifiaient pleinement ce choix. »
8. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 31 août 2014, 17:33, par R.P.
Dans ces guerres, on n’a pas vu de groupe catholique conséquent s’opposant à la guerre. C’est le prolétariat révolutionnaire qui s’y est opposé en faisant la révolution.
9. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er septembre 2014, 09:53, par Robert Paris
Pierre Léon poursuit :
« Le gain net des entreprises allemandes par actions passa de 1,656 milliard de marks en 1912-1913 à 2,213 milliards en 1917-1918 et le dividende moyen distribué passa de 8,7% à 10,1% du montant nominal des actions… Chez les Alliés, c’étaient les entreprises de munitions, d’explosifs et d’automobiles qui proposaient les plus grands profits. Le cas de Du Pont de Nemours fut à cet égard édifiant : ses bénéfices nets pendant la guerre furent de 266 millions de dollars au total, alors que la moyenne annuelle avant-guerre ne dépassait pas six millions. Il est vrai que Du Pont fut le plus gros fournisseur de munitions des Alliés ; ces profits lui permirent d’acquérir 23% du capital de la General Motors. La société des moteurs Daimler détenait, quant à elle, un record pour la rentabilité de son capital. Ce dernier était au départ de 8 millions de marks ; ses bénéfices pour 1916 furent de 12 millions contre 3,5 en 1913 ; les bénéfices distribués depuis cette date progressèrent annuellement ainsi : 14, 16, 28 et 35% du nominal. Ses réserves passèrent de 5,5 à 8 millions… Le cas de Renault en France, sans être aussi enviable, fut également profitable. Au lendemain de la guerre, certains secteurs, grâce à leurs énormes réserves, se trouvaient en position pour racheter ou intégrer des industries plus pacifiques qui avaient entre temps végété mais qui devaient certainement reprendre… Ces années sombres ont tout de même laissé dans l’esprit de quelques-uns le souvenir de bénéfices faciles que seule la guerre pouvait procurer… »
10. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er septembre 2014, 14:14, par Robert Paris
Pierre Léon décrit également comment les Etats ont financé les dépenses folles pour aider l’industrie privée de guerre :
« Avant les hostilités, la France et l’Allemagne avaient prévu l’éventualité d’une action financière. Dès le 11 novembre 1911, la Banque de France s’était engagée en cas de guerre à ouvrir un compte particulier au gouvernement de 2,9 milliards contre un intérêt de 1% seulement. En Allemagne, dès juillet 1914, les banques émettrices quadruplaient leurs avances au Reich ; une certaine panique règna qui disparut dès le déclenchement des hostilités. En France, il n’y eut aucun affolement de ce genre, mais des difficultés de paiement surgirent dès les premiers jours. Par contre, Londres connut, dès les premiers mois, un afflux de capitaux en quête de sécurité : le cours de la livre monta. Lorsqu’il devint évident que la guerre serait longue et la victoire loin d’être acquise, les liquidités se réfugièrent dans les pays neutres. Pour lutter contre le vent de panique, la fuite des capitaux et de l’or, des mesures d’urgence furent prises. En France, les opérations de bourse furent arrêtées le 30 juillet et, devant la cessation des paiements, le 1er août, un moratoire sur les effets de commerce et les réglements bancaires fut décrété. En Allemagne toutes les bourses furent fermées avant le 4 août : la convetibilité du mark fut suspendue et les taux d’escompte portés de 4 à 6%. Pour trouver de nouveaux moyens de financement, les deux Chambres à Paris votèrent, le 4 août, des lois qui permirent à la Banque de France de faire de nouvelles avances et au gouvernement d’engager des dépenses sans autorisation préalable. Une telle politique comportait des dangers d’inflation évidents, d’autant que le ministre des Finances repoussa au 1er janvier 1916 l’application des impôts nouveaux sur les revenus. Pour couvrir ces avances il ne restait plus que le recours à l’emprunt. Dès le 14 septembre, la Banque de France émettait pour le compte de l’Etat des bons du Trésor, appelés désormais Bons de la Défense Nationale… Le 14 août, le Reichstag votait à son tour des lois exceptionnelles pour le financement de la guerre. Sans délier la Reichsbank de l’obligation d’avoir une encaisse légale, le gouvernement lui donna pour mission de tenir à sa disposition une quantité illimitée de moyens de paiement. Elle imagina un expédient pour couvrir l’émission croissante de billets ; elle n’utilisa pas les Bons du Trésor mais créa des bons, cautionnés par des marchandises ou des titres, qu’elle offrit au public et qui circulaient comme des billets… Au début de 1915, il apparut que la guerre serait longue et qu’il faudrait prévoir plus sérieusement la guerre économique. Dès lors, la guerre provoqua une demande sans précédent, sauf de produits de luxe… Le plus gros des armes fut fabriqué dans les pays du champ de bataille. Pour cela, la France réclama surtout de l’acier : en 18 mois, de mai 1917 à novembre 1918, elle obtint de Washington 1,5 million de tonnes d’acier à obus soit presque autant que le poids de céréales panifiable expédié par les USA… Les Alliés s’étaient adressés à tous les pays susceptibles de les aider et, par répercussion, tous les pays neufs connurent une activité sans précédent. »
Cela montre combien est mensongère l’idée que les grandes puissances n’avaient aucun intérêt économique à la guerre…
11. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er septembre 2014, 19:45, par Robert Paris
Pierre Léon précise que l’intervention massive de l’Etat et de ses fonds dans l’économie de guerre ne visait nullement à concurrencer l’industrie privée de guerre :
« L’intervention de l’Etat dans le système économique et social ne datait pas du conflit, mais, à de rares exceptions près, cette ingérence n’avait été que législative et monétaire. En raison de l’ampleur des besoins et pour la durée de la guerre uniquement, les gouvernements en vinrent à diriger directement la vie économique de leur pays. Jamais il ne fut question de nuire aux moyens privés de production. Cependant, cette d’un attribut nouveau de l’Etat, faite sans motifs idéologiques, purement pragmatique, eut un double effet : il s’ensuivit tout d’abord un nouveau type de rapports entre les entreprises et le pouvoir (entre le capital et l’Etat) qui préfigurait l’avenir ; de plus, cette expérience permit aux dirigeants politiques et aux économistes de prendre conscience du rôle des politiques économiques pour remédier aux effets économiques ou sociaux, néfastes, du « laisser-faire »… L’entente entre « armée » et « industrie » fut d’ailleurs apparemment bonne ; tout le monde était au service de la même cause ; et l’organisation hiérarchisée de l’entreprise prit une signification collective. »
En somme, on a militarisé le travail d’usine et privatisé les fonds publics….
12. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er septembre 2014, 19:57, par R.P.
Tu écris : « Le premier chapitre est consacré aux deux guerres et je veux y démontrer, qu’aujourd’hui comme alors, pas grand chose n’a changé. Ce sont toujours les "mêmes" au pouvoir. »
Je ne suis pas certain que pas grand chose n’ait changé mais effectivement le ouvoir est aux mains des massacreurs de 1914 et 1939...
13. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 14 janvier 2015, 19:35, par Robert Paris
Renault 1914-1918, profiteur de guerre
Le site www.histoirerenault. net (l’histoire revue et corrigée par le patron de Renault) veut « faire découvrir une période pendant laquelle Renault a montré une implication très importante pour soutenir l’effort de guerre de la nation : les années 1914-1918. » Malheureusement, il manque à ce site bien des éléments pour apprécier comment le patron de Renault a été un des patrons de combat de l’époque qui ont poussé à la boucherie guerrière et combien cela lui a profité sur le dos de la population.
Alors que la marque au losange connaît de sérieuses difficultés avant la guerre, le gouvernement français charge Louis Renault de diriger la mobilisation des industriels en région parisienne et Renault s’en attribue la plus belle part. Renault, qui dispose de 500 ouvriers en septembre 1914 à la production des moteurs d’avions, en fera travailler plus de 4.000 dans son usine de Billancourt en 1917. En 1914 on produit en France 100 mitrailleuses, et on en fabrique 17.000 en 1918. En 1914, lorsque la guerre éclate, la compagnie Renault se lance dans la production de munitions, d’avions militaires et plus tard dans les tanks avec son Renault FT-17. En 1918, Renault est devenu le premier manufacturier privé de France et il est honoré par les Alliés pour sa contribution à l’effort de guerre.
Le chiffre d’affaires de Renault a ainsi été multiplié par quatre entre 1914 et 1918, passant de 53,9 millions de francs en 1914 à 249 millions de francs en 1919… Rappelons que Jacques Prévert affirmait : « Mourir pour la patrie ! C’est mourir pour Renault ! » Toutes les grandes firmes automobiles surent obtenir des marchés juteux de l’État. En 1915, André Citroën décrochait un contrat pour un million d’obus. Pour les fabriquer, il obtint aussi de l’État, une aide pour la construction d’une usine géante, quai de Javel à Paris. Les obus furent livrés avec plusieurs mois de retard. Un rapport établit que Citroën avait vendu ces obus deux fois plus cher que le prix du marché. Il ne fut jamais publié. Peugeot reçut 26 millions de l’État pour fabriquer des moteurs d’avions de chasse, dont aucun ne sera jamais livré, mais cela lui permit d’agrandir ses installations. Le patriotisme des patrons de l’Automobile est plutôt curieux et il commence par leur coffre-fort ! Si le peuple a laissé sa vie sur les champs de bataille et souffert de la misère, les profits dégagés par les grands patrons pendant la guerre furent faramineux.
Globalement c’est toute la grande bourgeoisie qui en sortit renforcée et enrichie. Quant aux ouvriers, pour moins de huit francs par jour, ils subissaient non seulement les bas salaires mais des conditions de travail aggravées. Les ouvriers travaillaient de onze à douze heures par jour, sept jours sur sept. Dans les usines, les accidents étaient nombreux : on en recensa près de 60.000 dans les seuls établissements privés en 1917, dont 300 mortels. Le 13 juin, l’effondrement d’un bâtiment provoqua la mort de 26 personnes aux usines Renault de Billancourt. Pendant que les rentiers, les bourgeois moyens ou petits se retrouvaient ruinés, et les travailleurs des villes et des campagnes écrasés, la haute bourgeoisie elle, vit ses positions assurées, sa fortune considérablement augmentée.
14. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 septembre 2015, 08:05, par Robert Paris
Un article de la direction de Renault dans le « Bulletin des usines Renault » avertissait que l’après-guerre allait être le retour de la guerre à l’intérieur, contre les travailleurs :
« Vous vous doutez que lorsque cette guerre sera finie, l’autre guerre, la guerre économique commencera…. Dans cette guerre, vous serez les soldats de première ligne. »
Et, une fois de plus la première ligne sera appelée à donner le plus de morts pour nourrir… les marchands de canons Renault !
26. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 22 mai 2014, 07:27
La grande immolation de 1914-1918, c’est d’abord 8 millions et demi de Français mobilisés, des millions de blessés et 1.400.000 tués sur l’autel des nécessités du profit.
27. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 22 mai 2014, 07:30
Que Clemenceau, ait pu à la fois porter les surnoms de briseur de grèves et de Père la Victoire en dit long sur les amours incestueuses entre la guerre sociale et la guerre tout court...
28. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 22 mai 2014, 07:35
Lorsque François Hollande simple VRP OTANISTE de la province hexagonale du gouvernement du spectacle mondial déclare:depuis l’Elysée au début novembre 2013 que « cent ans plus tard, il nous revient d’aborder dans un esprit de réconciliation cette douloureuse question des fusillés », il convient de se souvenir, d’une part, que les sectes gouvernementalistes de la gauche du Capital ont, depuis les journées de juin 1848, toujours été à la pointe des massacres de l’ouvrier séditieux et, d’autre part, que c’est bien Albert Thomas, ministre socialiste de l’armement en 1916-1917, qui fut le grand organisateur de l’exploitation ouvrière en temps de guerre pendant que les Sembat, Blum et Cachin ne cessaient de promouvoir le théâtre d’intérêts de la "défense nationale" du négoce à tous crins.
Quand le locataire de l’Elysée, simple marionnette pitoyable de la machination financière circulante, semble regretter que les perturbateurs et les mutins d’hier aient pu être fusillés alors que cela eut lieu avec la bénédiction de la nomenklatura ministérielle socialiste d’alors, celui-ci fait simplement acte de dénégation pathologique en ce sens qu’il fait là mine de récuser le passé pour mieux préparer et justifier le demain convulsif en ce moment ultra-crisique qui approche et où assurément et comme d’habitude les forces du progrès du dressage civilisationnel s’essayeront à passer par les armes les hommes récalcitrants et
indisciplinables.
Ne laissons pas détourner ou enfouir le populicide du premier charnier impérialiste et refusons en premièrement le mémoricide. Les monuments aux morts des villes et villages les plus reculés viennent nous raconter la tragédie de tous ces prolétaires sacrifiés et ainsi jetés dans les batailles les plus sanguinaires de la valorisation capitaliste. Nous avons des devoirs pratiques et théoriques de lutte de classe à l’égard des prolétaires de 1914
: devoir de dénoncer la grande réécriture des événements ; devoir de combattre le grand lessivage de la réalité historique.
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 24 mai 2014, 17:27, par luc nemeth
merci (pour les victimes, et au nom de la vérité historique) d’avoir rappelé le rôle de Juin 1848, dont le souvenir a par la suite été effacé par l’image de l’encore-plus-grand massacre de la Semaine sanglante... Sartre a finement rappelé, dans le t. III de L’idiot de la famille, la différence de nature entre les victimes de 1830, et celles de juin 1848 : en 1830 la bourgeoisie fait tirer dans le tas au non d’un idéal encore vaguement... ’’’universaliste’’’, hérité de 1789 ; tandis qu’en 1848 c’est la haine de classe abjecte envers la populace, qui s’exprime. Et c’est chose remarquable que parmi les tués de 1848, dont le nombre n’a jamais été établi, la grande majorité le fut, non pas, sur les barricades, mais le plus souvent, dans l’heure qui suivit, liquidés dans quelque arrière-cour... Mais ce sont là des choses qu’ils n’aiment pas trop rappeler les trop-vertueux républicanistes qui contrôlent ce secteur de la "recherche". D’ailleurs l’histoire de la 2ème République n’a pas été bien écrite, pour ce type de raisons, entre autres : ces messieurs n’aiment pas qu’on leur rappelle, qu’à la date du coup d’Etat du 2 décembre, le prince-président n’avait déjà en réalité plus beaucoup de libertés à confisquer...
2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 24 mai 2014, 18:24, par Robert Paris
Grand merci aussi pour ta contribution très intéressante.
On peut aussi rappeler sur juin 1848 ce petit article
29. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 22 mai 2014, 07:45
La boucherie de 14-18 a liquidé physiquement des millions de prolétaires pour que persiste le cycle d’abomination de l’exploitation humaine.
30. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 15 juin 2014, 08:43
« la responsabilité de la guerre incombe à l’Europe tout entière... Si, au lieu de faire une coupe horizontale de l’Europe, on en fait une verticale des classes de la société, on constate que toute la responsabilité repose sur les Cabinets d’Europe et que les peuples sont complètement innocents. »
Emil Ludwig, dans son ouvrage intitulé "Juillet 1914", paru en 1929
31. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 juillet 2014, 19:35, par Edouard
Mais la bourgeoisie française, elle n’avait pas elle de raison de craindre une crise révolutionnaire l’amenant à se jeter dans la mêlée d’une guerre mondiale, d’y prendre des risques sociaux et politiques considérables, seulement pour échapper à une révolution prolétarienne ?
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 juillet 2014, 08:37, par Robert Paris
On peut retrouver une bonne description de la situation sociale et politique à la veille de la première guerre mondiale dans « Les hommes de bonne volonté » de Jules Romains dans son ouvrage « La montée des périls ». Il y décrit un face à face de plus en plus inévitable entre le prolétariat de la banlieue parisienne et la bourgeoisie (ainsi que son Etat) dont j’aimerais bien reproduire des extraits.
2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 juillet 2014, 10:53, par Robert Paris
Extrait de « Les hommes de bonne volonté » de Jules Romains dans son ouvrage « La montée des périls » :
« Durant un siècle, l’énergie de cette banlieue n’a cessé de croître ; sa valeur vitale ; l’importance qu’elle a pour Paris ; la dépendance où elle le tient. Elle travaille pour lui d’abord, et durement. Elle est le faisceau même des servitudes qu’il suppose et impose ; le lieu des fonctions pénibles, encombrantes, puantes, bruyantes ou basses ; ce que l’on cache ; ce que l’on veut oublier ; ce dont on sait bien qu’on est de moins en moins à même de s’en passer ; l’esclave innombrable qu’on commande sans doute par des ordres qu’on lui donne, mais qui vous commande, lui, par le fait qu’il existe et qu’on ne peut plus vivre sans lui.
Peu à peu, sans que personne l’eût prémédité, ni même deviné d’avance, la banlieue Nord a vu la vie quotidienne de Paris venir se ramasser sous sa main, et à sa merci ; a vu se rassembler les forces, les substances, les moyens, sans lesquels Paris ne peut absolument pas durer comme ville, ni agir comme capitale.
Or, en même temps que cette concentration des structures matérielles, il se faisait, à l’intérieur de la masse humaine qui s’agglomérait là pour les servir, une distribution toute nouvelle de la volonté collective et des pouvoirs, un agencement sans précédent des rapports moraux, une organisation à demi souterraine de l’autorité et de l’obéissance. Une discipline ouvrière, émanée de la masse elle-même, sans prétendre supprimer pour le moment la discipline professionnelle émanée du patron, se tenait ainsi derrière, silencieuse et prête ; et si, dans le train-train de chaque jour, elle ne lui disputait pas l’usage ordinaire et purement technique des forces de tous ordres ainsi accumulées, elle se réservait d’en faire un usage solennel, fût-il simplement négatif, dans certains cas critiques, où le tout de l’ordre social serait engagé, le jour, par exemple, où les chefs du prolétariat croiraient devoir créer ou utiliser une situation révolutionnaire.
(…)
Octobre 1910 venait d’être une époque d’une grande signification. Préparée dès l’été par un pullulement de grèves locales, annoncée de plus loin par une série de mouvements, d’inspiration syndicaliste, et de tendance révolutionnaire, dont les plus imposants avaient été la grève des postiers de mars 1909, et la grève des inscrits maritimes d’avril et mai 1910, la grève générale, tant de fois décrite par les voyants, ou située par les théoriciens dans le monde excitant des mythes, venait de faire son entrée dans le monde réel.
Entrée semblable à un ouragan. Du fond du ciel chargé, le souffle accourut soudain, augmentant de violence à chaque heure, faisant trembler tout l’édifice social, donnant à ceux qui y étaient logés un frisson qu’ils ne connaissaient pas.
Le 10, les cheminots de la Compagnie du Nord déclenchaient la grève. Le 11 et le 12, elle s’étendait à tous les réseaux. Le 15, elle était généralisée, au point d’intéresser la plupart des services dont dépendait la vie de la capitale.
Pour la première fois, en somme, les deux Pouvoirs, campés l’un vis-à-vis de l’autre, en arrivaient à un véritable corps à corps. (…) Ce n’était pas encore la révolution. C’en était la répétition d’ensemble et éventuellement le prélude. Si les circonstances y aidaient, si les événements, une fois mis en branle, glissaient d’eux-mêmes vers la révolution, on pouvait penser que les meneurs ne feraient pas de grands efforts pour les arrêter sur la pente. (…)
Paris gouvernementale éprouva soudain, comme une réalité accablante qui périmait les vues de l’esprit, la présence de la banlieue Nord. Il s’aperçut que les ordres venus de lui n’avaient plus la force de franchir la zone des bureaux. (…) La grève, commencée par les chemins de fer, avait gagné bientôt l’ensemble des transports en commun ; puis la production d’énergie. Elle atteignait, directement ou indirectement, l’alimentation. Le pain et le lait manquaient, comme la lumière.
Paris séculaire, habitué aux vieilles révolutions de rues, sentait avec autant de surprise que d’angoisse cette banlieue récente, maîtresse des machines, qu’il avait laissée croître sans y penser, procéder contre lui non par secousses coléreuses mais par étouffement. (…) De son côté, la banlieue Nord ne mesurait peut-être pas sans stupeur l’événement immobile qu’on lui faisait accomplir. (…) L’attitude des cheminots, soutenus par l’ensemble des travailleurs, déciderait des événements. L’enjeu était démesuré. Il s’agissait du sort de la Société tant immédiat que lointain. Mais l’avenir se trouvait encore engagé sur un autre plan. Depuis quelques années, en effet, le syndicalisme révolutionnaire avait inscrit à son programme un antimilitarisme précis, qui, s’échappant des formules creuses, des condamnations toutes verbales de la paix armée et de la guerre, envisageait contre ces fléaux une action concertée du prolétariat. (…)
Le 18, les trains remarchaient. La farine, le lait, la viande étaient distribués. En tournant les commutateurs, on voyait s’allumer les lampes. L’ouragan avait duré huit jours.
32. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 juillet 2014, 12:26, par R.P.
La grève des cheminots de 1910, orchestrée par le Syndicat national des chemins de fer, entend mobiliser la solidarité des travailleurs, mais en appelle aussi au « public », c’est-à-dire à l’opinion que l’on cherche à sensibiliser et même à émouvoir. Cependant, en dépit de son ampleur et de sa durée, la grève échoue et débouche sur une très importante répression (38 000 révocations). -
33. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 juillet 2014, 13:38, par Robert Paris
Il faut rappeler que l’ouvrage de Jules Romains développe la thèse selon laquelle l’Etat bourgeois et les classes dirigeantes ont lancé la guerre mondiale pour fuir les risques révolutionnaires prolétariens.
Ainsi il conclue le chapitre précédemment cité par :
« Si l’ouragan avait communiqué à Paris, et dans une certaine mesure, à quelques grandes villes, un tremblement pathétique, il avait à peine eu le temps d’être perçu au cœur des provinces… Mais ces huit jours devaient longuement agir par la suite, et même selon des voies peu apparentes ou détournées. Pas un village au fond des provinces, pas un homme, qui ne dût tôt ou tard en ressentir les effets »
Pas étonnant car les effets, c’est la peur de la bourgeoisie qui la mène à la guerre.
Le chapitre suivant présente deux grands bourgeois industriels en train de peser les conséquences de la grève des cheminots.
L’un dit : « Les meneurs n’ont qu’un but : la révolution sociale. Les grèves, les réclamations sur tel ou tel point, c’est pour tenir leurs troupes en haleine… »
Il s’inquiète et montrant son usine : « Nous nous donnons beaucoup de mal… Ce n’est peut-être pas nous qui utiliserons ce que nous sommes en train de construire…. Je commence à me demander si nous nous en tirerons autrement que par une guerre… »
34. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 juillet 2014, 14:16, par R.P.
Aristide Briand, qui a cassé la grève, prônait, au début de sa carrière politique, la grève générale. Devenu Président du Conseil, il est cette fois de l’autre côté de la barrière, celui des gouvernants. Le théoricien du « grand soir » doit préserver les intérêts vitaux du pays. Début octobre 1910, les électriciens, les gaziers, les employés du téléphone, cessent progressivement leur activité pour soutenir les cheminots qui se croisent déjà les bras, sur tout le réseau ou presque.
La situation est grave. Le pays est sur le point de se bloquer complètement.
Les affrontements entre grévistes et non grévistes sont particulièrement violents : un ouvrier serre-freins non gréviste a été tué par ses « collègues » à Cormeilles-en Parisis.
L’état-major des armées envoie des notes alarmistes sur son incapacité à défendre le pays si la grève continue : les troupes ne pourront plus être acheminées aux frontières et les communications interrompues risquent de couper les régiments des ordres venant de Paris... sans parler des risques réels d’insurrection généralisée.
Les régions du Nord et de l’Ouest de la France sont les plus touchées par ce conflit social de très grande ampleur, sévèrement réprimé fin octobre 1910.
Pour mémoire Jules Durand est arrêté le 11 septembre 1910 et condamné à mort le 25 novembre 1910, soit concomitamment avec cette grande grève des cheminots, souvent baptisée "grève de la thune".
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 20 juillet 2014, 17:37
La Chambre syndicale nationale des cheminots passe pour la première fois à l’action le 8 juillet 1891 pour les salaires, les conditions de travail et contre des révocations de militants. Au bout de trois jours, face aux difficultés d’extension, d’aucuns
incitent à recourir à l’action directe : la prise d’assaut de la gare Saint-Lazare est suggérée, on propose de noyer les feux des locomotives... Le pouvoir réagit, déploie la troupe. La grève ne parvient pas à irradier en dehors de la région parisienne, où l’on dénombre 6 000 grévistes.
Si les compagnies cèdent quelque peu sur les revendications, elles répriment durement. La grève s’éteint le 21 juillet et 2 000 agents sont révoqués, parmi lesquels le secrétaire de la Chambre syndicale, Prades. Au lendemain de cette révocation, Eugène Guérard, alors proche de l’ancien communard Jean Allemane et qui s’affirme partisan du syndicalisme révolutionnaire, est élu secrétaire de la Chambre syndicale, qui va se transformer en 1895 en Syndicat national des travailleurs des chemins de fer de France et des colonies.
Le syndicat national s’enquiert auprès des syndicats d’autres corporations d’un soutien en cas de grève. Moins de 50 des 2 000 syndicats contactés font connaître leur soutien et le conseil d’administration décide en conséquence de reporter la grève à... l’année suivante.
Cependant, en septembre, les terrassiers déclenchent un mouvement puissant et la grève atteint bientôt la province. Cette dynamique relance l’idée de la grève chez les travailleurs du rail. Le 6 octobre 1898, le conseil d’administration s’adresse par circulaire aux groupes et les somme de répondre dans les trois jours. Soixante-quatorze réponses parviennent dans les délais : 29 groupes sont partisans de la grève, 31 y sont hostiles, 14 se déclarent hésitants.
Au cours de la deuxième semaine d’octobre, à plusieurs reprises, le CA vote sur la grève générale. Ces votes successifs révèlent une minorité importante hostile au déclenchement de la grève. Les groupes, à nouveau consultés, se partagent quasi à égalité : 36 pour, 34 contre. Dans la nuit du mercredi 12 octobre, au terme d’un long débat, la décision de grève est prise : le mouvement doit commencer le vendredi 14 au matin. Alors que les membres provinciaux du conseil d’administration rejoignent leurs localités, des plis sont envoyés aux militants sous des enveloppes dépourvues d’identifiant et à des adresses de convenance. Las ! La police est prévenue, intercepte nombre de plis et d’affiches et lacère les placards apposés en région parisienne. Le 14 au matin, l’armée est dans les gares, sur les voies, dans les ateliers, partout où le mouvement risque de prendre. Non prévenus dans leur immense majorité, les cheminots apprennent en découvrant la troupe sur les lieux de travail qu’un ordre de grève a été lancé !
Dans ces conditions, le mouvement est un échec complet : on ne dénombre, le 14, que 135 grévistes et, au cours des trois jours que dure la grève, la moyenne est de 75. La répression s’abat tout de même : 36 révocations sont prononcées. Effets secondaires non négligeables, l’échec de la grève et de déploiement de la troupe cassent la dynamique du mouvement du bâtiment.
En 1910, Aristide Briand se dit sensible aux revendications des cheminots, mais il se déclare hostile aux manifestations et à la grève. En juin 1910, les cheminots apprendront par la presse que les compagnies ont précisé leur position auprès du gouvernement et qu’elles n’auront aucun contact avec les syndicats. Le 29 juin 1910, un meeting commun du Syndicat national et de la Fédération des mécaniciens et chauffeurs concrétise l’alliance. Emile Toffin fera partie du Comité de grève. Le 17 juillet 1910, le conseil d’administration du Syndicat national mandate le Comité central de grève, élu par le congrès, pour qu’il déclenche la grève lorsqu’il jugera le moment propice.
.
Fin septembre 1910, une ultime tentative de la Fédération des mécaniciens et chauffeurs pour nouer un dialogue avec les compagnies échoue.
Nous sommes, on le voit, bien éloignés de la précipitation qui a prévalu tant en 1891 qu’en 1898, où l’entrée dans la grève générale était un objectif en soi.
L’attitude bloquée des compagnies et du gouvernement donne à penser que l’épreuve de force est souhaitée, voire provoquée. En août, quelques escarmouches se sont produites au PLM et dans le Nord à propos de révocations faisant suite à des ripostes contre des mesquineries du quotidien et l’attitude de petits chefs.
Le vendredi 7 octobre 1910, des milliers de cheminots se réunissent à la Bourse du travail de Paris pour protester contre les révocations. Le lendemain, la Compagnie du Nord annonce que tous ses ouvriers toucheront au moins la fameuse « thune »
(5 francs) quotidienne, mais la plupart ont déjà un salaire supérieur.
C’est sur le réseau Nord que le mouvement de grève s’engage, car la Compagnie du Nord a créé les conditions du conflit en supprimant les heures supplémentaires et en les remplaçant par des compensations financières moins importantes. C’est là aussi où les 5 francs sont attribués de façon particulièrement sélective. Le mouvement débute le 8 octobre dans le dépôt de La Chapelle, où travaille Emile Toffin. Plusieurs centaines de grévistes se dirigent vers le dépôt de la Plaine Saint-Denis, qui entre à son tour en lutte. Le lendemain, le 9 octobre, le Comité de grève propre au réseau Nord se réunit à Amiens et décide de l’extension de la grève à l’ensemble du réseau.
Finalement, dans la soirée du lundi 10 octobre, 3 000 cheminots se rassemblent en meeting à la Bourse du travail.
Dès le 11 octobre, les soldats du Ve Génie investissent les deux premiers dépôts entrés dans la grève, ainsi que la gare du Nord. L’armée s’installe rapidement sur tout le réseau. Le gouvernement Briand accentue la pression en décidant le même jour la mobilisation des cheminots du réseau Nord pour une instruction de vingt et un jours à partir du 13 octobre. La formule sera applicable aux autres réseaux, mais les cheminots refusent massivement d’obtempérer. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, un éphémère Comité de grève national, qui regroupe des représentants de chaque réseau, se réunit en formation restreinte. Beaucoup de responsables de la tendance réformiste (dont le secrétaire général du Syndicat, Marcel Bidegaray) sont à Toulouse au congrès de la CGT. Le Comité appelle à la généralisation de la grève pour le 12. En riposte, le gouvernement lance vingt et un mandats d’arrêt contre les membres présents ou non à la réunion.
Le 13 octobre, le pouvoir force les feux. Le préfet Lépine arrête cinq membres du Comité central de grève en charge de l’organisation du mouvement dans les locaux du journal L’Humanité, où ils ont trouvé refuge.
Une vingtaine de mandats d’amener sont d’autre part délivrés à l’encontre de syndicalistes accusés d’actes de sabotage. Très vite, les compagnies répliquent à la grève par des révocations, dont les premières sont effectives le 13 octobre. Le premier concerné est Emile Toffin.
Le mouvement de grève a été puissant. Le 11 octobre, Paris-Nord ne fait plus rouler que 18,5 % des trains habituels. Le lendemain, 12 octobre, 12,5 % des trains seulement sont acheminés et les marchandises ne circulent plus. Le 13, la situation se stabilise mais, le
vendredi 14, un reflux est perceptible et le mouvement va vite s’affaiblir avec des îlots de résistance. Sur les autres réseaux, le mouvement reste restreint, sauf sur le réseau Etat (le réseau Ouest vient d’être repris en gestion directe par les pouvoirs publics).
Suite à l’arrestation des membres du Comité central de grève, un deuxième Comité a été mis en place dont les orientations, connues des principaux animateurs, ne rassurent guère : Jean-Pierre Grandvallet, ouvrier aux ateliers d’Epernay (compagnie de l’Est), s’affiche réformiste et Robert Communay, du PLM, n’a pas une grande audience. De plus, ils viennent de deux réseaux faiblement présents dans la grève. De son côté, la CGT décide de laisser au mouvement son caractère corporatif et ne s’engage guère au-delà de l’édition d’une affiche intitulée : « Bravo les cheminots ! ». De fait, L’Humanité devient l’organe officiel du deuxième Comité de grève et l’appui des députés socialistes est recherché pour dénouer le conflit
35. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 juillet 2014, 14:24, par Edouard
Et l’Angleterre alors ?
36. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 juillet 2014, 16:52, par R.P.
En août 1911, la classe dominante britannique était forcée de déployer des troupes et des bateaux de guerre à Liverpool pour écraser un grève générale presque insurrectionnelle. Le maire de la ville mettait en garde la gouvernement contre « une révolution en marche ».1
Ces événements extraordinaires représentaient le point culminant de toute une série de luttes en Grande-Bretagne et en Irlande avant la Première Guerre mondiale, passées à la popularité sous le nom de « grande fièvre ouvrière ». Comme le montre l’article qui suit, ces luttes étaient en fait une expression spectaculaire de la grève de masse, et faisaient intégralement partie d’une vague internationale qui allait finalement culminer dans la révolution de 1917 en Russie. Même si aujourd’hui, elles ne sont pas largement connues, elle restent riches en leçons pour les luttes d’aujourd’hui et de demain.
Entre 1910 et 1914, la classe ouvrière en Grande-Bretagne et en Irlande déclencha des vagues successives de grèves massives avec un souffle et une hargne sans précédent contre tous les secteurs-clefs du capital, grèves qui balayèrent tous les mythes soigneusement fabriqués sur la passivité de la classe ouvrière anglaise qui avaient fleuri pendant la précédente époque de prospérité capitaliste.
Les mots utilisés pour décrire ces luttes dans l’histoire officielle vont de « unique », « sans précédent », à « explosion », « tremblement de terre »… En opposition aux grèves organisées par les syndicats largement pacifiques de la dernière moitié du XIXe siècle, les grèves d’avant la guerre s’étendirent rapidement et sauvagement aux différents secteurs – mines, chemins de fer, docks et transports, ingénierie, construction – et menacèrent de déborder tout l’appareil syndical et de s’affronter directement à l’Etat capitaliste.
C’était la grève de masse que Rosa Luxembourg a analysé si brillamment, dont le développement marquait la fin de la phase progressiste du capitalisme et l’apparition d’une nouvelle période révolutionnaire. Bien que l’expression la plus achevée de la grève de masse ait été celle de 1905 en Russie, Rosa Luxembourg montra que ce n’était pas un produit spécifiquement russe mais comme « une forme universelle de la lutte de classe prolétarienne déterminée par le stade actuel du capitalisme et des rapports de classe » (Grève de masse, Parti et Syndicats, Petite Collection Maspero, p. 154). Sa description des caractéristiques générales de ce nouveau phénomène décrit de façon très vivante « la grande fièvre ouvrière » :
« La grève de masse …voit tantôt la vague du mouvement envahir tout l’Empire, tantôt se diviser en un réseau infini de minces ruisseaux ; tantôt elle jaillit du sol comme une source vive, tantôt elle se perd dans la terre. Grèves économiques et politiques, grèves de masse et grèves partielles, grèves de démonstration ou de combat, grèves générales touchant des secteurs particuliers ou des villes entières, luttes revendicatives pacifiques ou batailles de rue, combats de barricades - toutes ces formes de lutte se croisent ou se côtoient, se traversent ou débordent l’une sur l’autre c’est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants. » (Id., p.127)
Loin d’être le produit de conditions particulières à la Grande-Bretagne, la grève de masse en Angleterre et en Irlande faisait partie intégrante de la vague internationale de luttes qui se sont développées dans toute l’Europe de l’Ouest et en Amérique après 1900 : la grève générale de 1902 à Barcelone, les grèves de 1903 des cheminots en Hollande, la grève massive des mineurs de 1905 dans la Ruhr…
Les révolutionnaires ont encore à tirer toutes les leçons des grèves massives en Grande-Bretagne – en partie à cause de l’aspect abrupt et de la complexité des événements eux-mêmes, mais aussi parce que la bourgeoisie a rapidement essayé de les enterrer tranquillement comme étant un épisode oublié2. Ce n’est pas par hasard si aujourd’hui, c’est la grève générale de 1926, et pas la vague de grèves d’avant-guerre, qui a l’honneur d’avoir une place dans l’histoire officielle du « mouvement ouvrier » anglais : 1926 représentait une véritable défaite, alors que 1910-1914 a vu la classe ouvrière anglaise à l’offensive contre le capital.
37. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 24 juillet 2014, 21:39, par Robert Paris
1910, c’est en même temps la grève des cheminots en France, la montée ouvrière en Espagne, la grève de masse en Angleterre et en Irlande, la révolution républicaine au Portugal avec notamment l’obtention du droit de grève, les mouvements révolutionnaires basques en Espagne, les manifestations de masse pour le suffrage universel en Allemagne, le succès du mouvement pour le droit de vote des femmes en Suède, la manifestation de masse aux obsèques de Tolstoï, le soulèvement des peuples des Balkans, etc...
38. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 25 juillet 2014, 12:58, par Robert Paris
1910, c’est aussi la révolte des Albanais contre l’empire ottoman, la révolte des Abès de Côte d’Ivoire, la révolte des vignerons de Champagne, la révolte des peuples du Gabon, la révolte ouvrière internationale contre la condamnation de Durand, charbonnier du Havre, la révolte des marins brésiliens, les débuts de la révolte en Arabie, les révoltes des peuples de la boucle du Niger et, en France, la révolte des ménagères, la révolution mexicaine, la révolte des pêcheurs de Rivière-au-Renard au Québec, etc, etc...
39. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 25 juillet 2014, 13:33, par Robert Paris
Et n’oubliez pas le 8 mars 1910 : première journée internationale des femmes !!!
40. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 10 août 2014, 15:28, par R.P.
Lire aussi :
Pourquoi l’Etat et la bourgeoisie française ont commandité l’assassinat de Jaurès avant de se lancer dans la première guerre mondiale ?
41. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 22 août 2014, 08:22, par Robert Paris
Rappelons aussi les grèves de 1910 en Allemagne qui ont suscité un débat intense de 1910 à 1912 entre révolutionnaires et réformistes au sein de la social-démocratie allemande, notamment entre Rosa Luxemburg et Pannekoek d’un côté et Kautsky de l’autre (polémique largement moins connue que celle de 1905 à propos de la révolution russe), grèves dans lesquelles la social-démocratie avait joué le rôle de frein de luttes spontanées. Et aussi, à la même époque, le mouvement de masse en Allemagne en faveur de la république, de janvier à mars 1910 conjointement aux grandes grèves des mines et du bâtiment, situation où la direction social-démocrate a joué le rôle de frein, ce dont l’accuse l’aile révolutionnaire de la social-démocratie. Rosa relance ainsi le débat sur la grève de masse ce qui sous-entend une situation pré-révolutionnaire. Rosa Luxemburg compare même l’Allemagne de 1910 à la Russie de 1905 ! Alors que l’Allemagne connaît sa pire crise économique depuis 1907 avec un chômage de masse, qu’elle connaît également une crise de son régime politique, qui impose à celui-ci des réformes démocratiques inconnues jusque là, la social-démocratie et la direction des syndicats font tout pour temporiser, refusent de prendre la tête des mouvements spontanés. En 1911, Kautsky lui-même est contraint de décrire ainsi la situation en Europe : « C’est devenu une vérité d’évidence : les luttes politiques et économiques contemporaines débouchent toujours plus sur des actions de masse. » (article intitulé « L’action de masse ») Et en 1912, le même Kautsky écrit dans « La nouvelle tactique » : « Le point de départ de la critique de Pannekoek est la série d’articles que j’ai publiés l’automne dernier à propos de « l’action de masse » dans la Neue Zeit, articles eux-mêmes suscités par les troubles qui avaient lieu peu de temps auparavant en Angleterre, en France et en Autriche, conjointement à des grèves de très grande ampleur (en août en Angleterre) et à des manifestations contre la hausse des prix (en septembre en France et en Autriche). A ces troubles avaient pris part essentiellement des masses inorganisées… Je parvins à cette conclusion que, dans ce contexte marqué par l’aiguisement constant des conflits entre les classes, par la hausse des prix et le danger de guerre, on pouvait être certain que la combinaison de l’action du prolétariat organisé avec celle des grandes masses inorganisées promettait d’être un facteur important. » Malgré toute l’hypocrisie réformiste de Kautsky, il est capable de remarquer « l’aiguisement constant des conflits entre les classes » entre 1910 et 1911 en Europe !
42. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 22 août 2014, 08:26, par Robert Paris
L’autre lien, classique lui aussi, c’est la guerre qui se transforme en révolution. Là aussi, on trouve l’exemple dans la révolution française avec la révolution jacobine qui découle de la révolte du peuple contre les trahisons des Girondins dans la guerre contre les puissances européennes. On l’a vu aussi en Russie, en 1905, suite à la défaite militaire contre le Japon. On l’a vu dans la vague révolutionnaire en Europe à partir de 1917, pendant la guerre mondiale inter-impérialiste. C’est même la révolution prolétarienne qui a contraint les bourgeoisies européennes à arrêter leur guerre, ce qui n’a pas empêché l’éclatement des révolutions dans les pays vaincus. On l’a vu dans la vague révolutionnaire en Asie après la deuxième guerre mondiale, suite à la défaite japonaise.
Dès que la crise de la domination capitaliste atteint son sommet, l’alternative guerre ou révolution devient inévitable.
Et la première guerre mondiale, causée préventivement par une montée révolutionnaire menaçante ?
La première guerre mondiale, issue de la crise capitaliste de 1907, comme la deuxième est issue de la crise capitaliste de 1929, elle est issue non seulement de contradictions critiques sur le plan économique mais aussi social et politique, c’est-à-dire de la lutte des classes : grandes grèves en Espagne (1910-1914), et dans l’année 1910 : début de la révolution mexicaine, insurrection au Maroc, révolte au Brésil, révolution politique au Portugal, manifestations politiques de masse en Allemagne, grève des cheminots devenant grève générale en France, … 1910, c’est aussi la révolte des Albanais contre l’empire ottoman, la révolte des Abès de Côte d’Ivoire, la révolte des vignerons de Champagne, la révolte des peuples du Gabon, la révolte ouvrière internationale contre la condamnation de Durand, charbonnier du Havre, la révolte des marins brésiliens, les débuts de la révolte en Arabie, les révoltes des peuples de la boucle du Niger et, en France, la révolte des ménagères, la révolution mexicaine, la révolte des pêcheurs de Rivière-au-Renard au Québec, etc, etc... 1910, c’est en même temps la grève des cheminots en France, la montée ouvrière en Espagne, la grève de masse en Angleterre et en Irlande, la révolution républicaine au Portugal avec notamment l’obtention du droit de grève, les mouvements révolutionnaires basques en Espagne, les manifestations de masse pour le suffrage universel en Allemagne, le succès du mouvement pour le droit de vote des femmes en Suède, la manifestation de masse aux obsèques de Tolstoï, le soulèvement des peuples des Balkans, etc... Entre 1910 et 1914, la classe ouvrière en Grande-Bretagne et en Irlande déclencha des vagues successives de grèves massives avec un souffle et une hargne sans précédent contre tous les secteurs-clefs du capital, grèves qui balayèrent tous les mythes soigneusement fabriqués sur la passivité de la classe ouvrière anglaise qui avaient fleuri pendant la précédente époque de prospérité capitaliste. Et n’oubliez pas le 8 mars 1910 : première journée internationale des femmes !!!
43. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 23 août 2014, 15:31, par Robert
Lire des documents historiques sur la guerre de 14-18 : ici
44. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 25 août 2014, 14:04, par Robert Paris
Impliqués dans la guerre mondiale de 1914-1918, il y a des pays que l’on cite moins comme la Roumanie. C. Virgil Gheorghiu écrit dans « La maison de Petrodava » :
« - La guerre est déclarée. La Roumanie est entrée dans la guerre mondiale. Dans les villages d’en-bas, tous les hommes sont appelés. Ceux qui se sauvent sont pris, ligotés et envoyés au combat…
- Pourquoi a-t-on déclaré cette guerre mondiale ? Les Turcs nous ont encore envahis ?
– Non, Domnitza, il n’existe plus de Turcs en Europe, ni Vandales, ni Huns.
– Qui a envahi la Roumanie, pour qu’on nous appelle tous au combat, maintenant, au début de l’automne ?
– Personne n’a envahi la Roumanie.
– Alors contre qui et pourquoi nous battons-nous, maintenant…
– Personne ne sait exactement qui est l’ennemi, mais nous sommes en état de guerre. Les combats ont déjà commencé. La Roumanie est entrée dans la guerre mondiale qui dure déjà depuis deux ans. D’un côté, comme on l’écrit dans les journaux – il y a les Allemands avec leurs alliés, de l’autre les Français avec les leurs. Nous n’avons aucun motif de nous battre, ni contre les Allemands, ni contre les Français. C’est seulement d’ici quelques jours que nous saurons exactement quels sont les ennemis. Il paraît que le gouvernement a tiré au sort. Et c’est un numéro blanc qui est sorti, mais comme il était nécessaire que nous entrions aussi en guerre, parce qu’il s’agit de la première guerre mondiale, où doivent se battre toutes les nations de la terre, même les plus petites, et c’est pour ça que ça s’appelle « mondial », on a joué à pile ou face ; on a jeté une pièce de monnaie ; pile, nous nous battons contre la France, bien qu’il s’agisse de notre sœur latine, face, contre l’Allemagne, bien que le roi de Roumanie soit allemand. »
45. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 26 août 2014, 09:39, par Robert Paris
En France, il n’y a pas eu que la grève des cheminots de 1910. C’est toute une montée des luttes ouvrières qui n’a cessé de monter : affrontements ouvriers à Chambéry et Grenoble en 1906, électriciens de Paris en grève en 1907, la Bâtiment en 1908 avec le mouvement de Draveil-Vigneux-Villeneuve-saint-Georges, les sablières de la seine en 1908, les postiers en 1909, la grève des cheminots se généralisant à d’autres professions en 1910 et ne s’arrêtant que par l’arrestation du comité de grève et 15.000 révocations, les électriciens et les chauffeurs de taxis en 1911, les dockers et les inscrits maritimes en 1912. Il faut y rajouter les manifestations contre la guerre comme le 13 juillet 1907 et en juin 1913 contre le vote de la loi des trois ans.
Il n’y a pas eu que la France, l’Allemagne et l’Angleterre où l’ébulliton ouvrière monte. On peut citer aussi l’Italie.
Voici comment Pietro Nenni rapporte ces années-là en Italie dans « Six ans de guerre civile en Italie » :
« Dans le mouvement syndical, les tendances anti-réformistes et soréliennes prenaient de la force. Le parti socialiste n’échappait pas à la crise et son axe se déplaçait de droite vers la gauche. En même temps allait s’organiser un mouvement nationaliste et impérialiste, qui se déclarait à la fois antisocial, antilibéral et antigiolittien. L’expédition coloniale en Tripolitaine mit pour la première fois en mouvement ces forces nouvelles qui n’existaient encore qu’en puissance et qui allaient dramatiser ou, comme l’on dirait aujourd’hui, radicaliser les luttes sociales et politiques. A Bologne, la jeunesse bourgeoise et nationaliste attaqua, à coups de matraque, les ouvriers qui manifestaient contre la guerre. En Romagne, et notamment à Forli, la grève générale prit le caractère d’une émeute. Trois jours durant le prolétariat fut maître du pavé… Les ouvriers déboulonnaient les rails pour empêcher les trains militaires de partir, occupaient les gares, organisaient le ravitaillement… Cela « chauffait ». A trois reprises, la cavalerie chargea, sabres au clair. Les manifestants tenaient bon. Une palissade fut démolie et nous nous servîmes des planches comme d’une arme. Les femmes se jetaient à terre pour arrêter l’élan des charges. Les gamins bombardaient cavaliers et gendarmes avec des pavés. Nous fûmes repoussés à plusieurs reprises, mais revinmes toujours à l’attaque… Courte victoire. Le lendemain, la ville était en état de siège et la Bourse du Travail, sans tenir compte de nos derniers appels à la résistance, délibérait sur la fin de la grève… L’extrémisme s’accentuait de jour en jour. Vers le milieu de 1914, un événement, qui reçut le nom de « Semaine rouge », donna la mesure de l’état de surexcitation du pays. Le mouvement de grève prit naissance à Ancône, où, le 7 juin, dans un conflit avec la police à « Villa Rossa », trois ouvriers furent tués. De là il s’étendit à la Romagne et à l’Ombrie, et gagna l’Italie tout entière. Les cheminots s’étant joints à la grève, celle-ci fut vraiment générale. Dans plusieurs villes, elle revêtit un caractère d’émeute, notamment à Ancône, dans la Romagne, à Florence et à Naples. La force publique fut débordée. Un moment on eût l’impression d’être en pleine révolution. Les citoyens arboraient des cocardes rouges. A Ravenne, les grévistes avaient arrêté un général. Dans des petites villes on proclamait la République au son du tocsin. A Rome, une manifestation qui se dirigeait contre le Palais-Royal fut péniblement dispersée par l’armée… A Fabriano, une colonne de « bersaglieri » fut désarmée et dut assister à la proclamation de la République. Des églises flambaient. Le drapeau rouge flottait sur des édifices publics. »
46. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 26 août 2014, 10:48, par Robert Paris
Prenons l’année 1913...
Il y a cent ans, en France, le 10 février 1913, débutait dans les usines Renault la deuxième grève du chronométrage, après celle des 4 et 5 décembre 1912. La grève est totale : 4000 ouvriers arrêtent le travail.
En 1913, en Irlande, les membres du syndicat général des travailleurs du transport (ITGWU) entament une grève à Dublin pour sa reconnaissance, les employeurs décrètent un lock-out dans toute la ville. C’est toute la société irlandaise qui se retrouve coupée en deux selon une ligne de fracture toute nouvelle : d’un côté pour les ouvriers en grève, de l’autre pour l’ordre et William Murphy. Indépendantistes ou unionistes, catholiques ou anglicans, irlandais ou anglo-irlandais, se retrouvent dans les deux camps, entre ceux prêts à mourir pour leur cause et ceux prêts à les affamer.
Le 14 avril 1913 en Belgique : grève générale initiée par le parti ouvrier pour protester contre le refus de Chambre d’adopter le suffrage universel.
1913 : grèves violentes au Royaume Uni
1913 : mouvements de grève en Russie
1913 : à Paris, grève des ouvriers boulangers et c’est aussi la grève des mineurs du Pas-de-calais
Novembre 1913 : préparation de l’armée révolutionnaire pour l’indépendance de l’Irlande
En 1913, Rosa Luxemburg écrit sur la grève générale belge :
« La grève générale belge ne mérite pas seulement, en tant que manifestation remarquable des efforts et des résultats de la masse prolétarienne en lutte, la sympathie et l’admiration de la social-démocratie internationale, elle est aussi éminemment propre à devenir pour cette dernière un objet de sérieux examen critique et, par suite, une source d’enseignements. La grève d’avril, qui a duré dix jours, n’est pas seulement un épisode, un nouveau chapitre dans la longue série des luttes du prolétariat belge pour la conquête de l’égalité et de l’universalité du droit de vote, luttes qui durent depuis le commencement de la dernière décennie du XIX° siècle et qui, selon toute apparence, sont encore très éloignées de leur fin. Si donc nous ne voulons pas, à la manière officielle, applaudir toujours et à toute occasion tout ce que fait et ne fait pas le Parti social-démocrate, il nous faut, en face de ce nouvel assaut remarquable du Parti Ouvrier Belge, dans ses luttes pour le droit électoral, nous poser la question suivante : Cette grève générale signifie-t-elle un pas en avant sur la ligne générale de combat ? Signifie-t-elle en particulier une nouvelle forme de lutte, un nouveau changement tactique qui serait appelé à enrichir, à partir de maintenant, les méthodes de combat du prolétariat belge, et peut-être aussi du prolétariat international ? »
Et aux USA, 1913 c’est l’année de la grève de 25.000 ouvriers du caoutchouc à Akron...
47. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 26 août 2014, 16:50, par Robert Paris
La guerre est une manière de détruire socialement et politiquement la classe ouvrière. Le 13 janvier 1915, Millerand déclarait à la délégation syndicale des Métaux : "Il n’y a plus de droits ouvriers, plus de lois sociales ; il n’y a plus que la guerre."
48. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 26 août 2014, 16:51, par Robert Paris
Henri Poulaille écrit dans "Pain de soldat" sur l’assassinat de Jaurès :
"On parlait dans la tristesse et la stupéfaction... A tout instant, la foule grossissait, débordant les barrages d’agents... Toute cette foule se surexcitait maintenant, malgré les appels au sang froid qui venaient de maints endroits... Les forces de police avaient peine contenir cette marée humaine. Des cris partaient à leur adresse, autant qu’à celle des responsables peut-être : "Assassins, assassins, lâches !" emmêlés de "Vive Jaurès, à bas la guerre !" "Jaurès tué, c’est la guerre" dit quelqu’un. - Lui seul aurait pu empêcher la guerre, reprenait un autre ; - Non, on n’a qu’à vouloir. C’est à nous d’empêcher la guerre", dit un ouvrier au visage ravagé."
49. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 août 2014, 12:01, par Robert Paris
La période qui précède la première guerre mondiale n’est pas faite que de reculs.
Par exemple en 1912 :
En janvier, première grève générale au Portugal ; en Allemagne, la social-démocratie devient le premier parti au parlement, le Reichstag, la bourgeoisie est affolée et ne parvient pas à former un cabinet majoritaire ; les Bantous d’Afrique du sud créent leur propre parti ; révolte en Tunisie contre les colons français appelée « boycott des tramways » ; les Sénousis du Sahara se défendent contre le colonisateur italien en Libye ; gouvernement révolutionnaire de Sun Yat-Sen en Chine ; apparition du syndicalisme ouvrier en Indonésie ;
En avril, insurrection de Fès contre la colonisation française au Maroc
En mai, grève générale et émeutes à Budapest (Hongrie) organisées par les sociaux-démocrates. La répression par la police fait six morts, 182 blessés et 300 arrestations.
En juillet, soulèvement au Nicaragua contre un pouvoir conservateur soutenu par les USA
En décembre, les travailleurs anglais imposent le salaire minimum garanti pour les mineurs et en Roumanie, ils imposent une loi d’assurance ouvrière
Etc, etc…
50. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 août 2014, 18:39, par Robert Paris
Henry Poulaille écrit dans « Les damnés de la terre » :
« Depuis quelques jours, chez Radigond, toute la famille est réunie pour la soupe à la même heure. Cela ne s’était pas vu depuis des années. La cause en était la grève (celle de 1909).
Nini n’en semblait pas plus ravie que cela…
Elle fulminait.
– Vous êtes là tous les trois sur le sable… et ça sera pire qu’en 1906, j’prévois ça ! Et si on vous foutait en l’air, tous autant que vous êtes, postiers, facteurs, « et caetera », où que vous iriez ? Pas foutus de faire au’chose, hein ! J’pousse les choses au noir, pasque c’est heureusement impossible qu’on vous balance tous…
– Tiens, la mère, regarde plutôt Le Journal, à la page 1, au lieu de ton feuilleton. C’est nous qui sommes à l’honneur. Tiens, c’est écrit : « Plus de trois millions de lettres, plus de cent mille télégrammes restent en souffrance. » C’est même écrit assez gros de manière à ce que les myopes comme toi puissent le voir sans lunettes…
Les jours passaient. Radigond et se sgars étaient toujours en alerte. On avait saboté le télégraphe. On le ferait payer cher ! et cher, disait-on. Ce n’était pas le moment de se lâcher les coudes.
Dans une séance de nuit, la Chambre par 458 voix contre 69 se disait décidée à ne pas tolérer de grève des fonctionnaires.
Et l’on tenait… et solidement.
On avait fait appel à la troupe ; les soldats étaient occupés au triage des lettres, à la manipulation des « morses »…
De fait, le gouvernement capitulait ; le tiercement qui eût retardé l’avancement régulier des agents des PTT dans une proportion de 30% était supprimé.
Un nouveau meeting au Tivoli-Vauxhall décidait la reprise du travail…
La grève était finie. L’après-midi même, place Vauban, les grévistes faisaient leur dernière manifestation, et c’était en cortège joyeux qu’ils partaient vers leur travail…
– Les fonctionnaires, disait Radigond, ont gagné leur première grande bataille…
D’ailleurs quelques faits nés au cours des grèves récentes étaient inquiétants. En ce mois de mars, en même temps que les postiers, une série de mouvements alertaient la police, la gendarmerie, la troupe.
A Mazamet, dans le Tarn, on avait des craintes. Après trois mois, la grève des délaineurs menaçait de dégénérer en combats de rues ; on venait d’envoyer les enfants dans des localités voisines. C’était mauvais signe. A Tunis, les zouaves remplaçaient les cheminots. Mais c’était surtout dans l’Oise que la situation était grave.
A Méru et environs, les boutonniers au nombre de 12 000, s’étaient mis en grève, l’emploi de la nacre artificielle, la transformation de l’outillage ayant abaissé leurs salaires dans d’effarantes proportions. Des manifestations avaient eu lieu dans plus de vingt localités à la fois. Une « horrible jaquerie » disait-on.
Il y avait eu du grabuge à Ablainville, où l’usine principale fut dévastée ainsi que la maison du patron ; à Méru, ç’avait été chez le maire de Saint-Crépin que les « jacques » avaient opéré. Tout ce qui était facilement déménageable avait été sorti et brûlé sur la route.
Pendant quelques jours, des bagarres avaient éclaté, puis on avait repris le travail partiellement.
– Alors, vous avez gagné votre grève ! ça m’a fait bougrement plaisir, leur avait dit Magneux qu’ils étaient allés voir à l’hôpital…. Oui, on est en époque révolutionnaire… mais c’est souvent la réaction qui profite des situations révolutionnaires par la faute de la somnolence des militants qui répugnent trop à l’action directe…
C’est qu’on était forts !
Quel magistral soufflet c’était pour le gouvernement et le Clemenceau, que ce grand meeting de l’Hippodrome, organisé par les syndicats des électriciens, des maçons d’art et des terrassiers, pour affirmer la solidarité du prolétariat industriel avec les travailleurs de l’Etat.
– On vit une époque révolutionnaire, répétait Radigond, reprenant le mot de Magneux, en revenant de ce meeting….
Dans l’Oise, la lutte reprenait de plus belle, sur ces entrefaites.
Le 9 avril, 600 militants chahutaient les jaunes et s’attaquaient à deux ou trois établissements à Lormaison, à Saint-Crépin, où travaillaient des « renards », chez le fils du maire, celui que l’on avait déménagé un mois auparavant. Chemin faisant, les manifestants abattaient les poteaux du télégraphe, coupaient les fils, cela sur une étendue de plus d’un kilomètre. C’était l’ « émeute caractérisée »… Des escadrons de hussards étaient dès le lendemain sur les lieux et la gendarmerie arrêtait des « émeutiers », ce qui occasionnait de violentes bagarres ; à plusieurs reprises les ouvriers tentaient d’arracher leur proie aux « cognes ».
On dut appeler du renfort. Des escadrons de chasseurs à cheval, des dragons, des cuirassiers arrivèrent.
Trois compagnies de chasseurs cantonnaient à Méru… Malgré ce déploiement de troupes et les multiples patrouilles et parades, de bruyantes manifestations se déroulèrent au cours de la grève générale de vingt-quatre heures décidée dans la région en protestation. »
51. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 29 août 2014, 13:54, par Robert Paris
Rappelons nous que, dans la révolution française, la bourgeoisie girondine lance la guerre pour arrêter la révolution...
Rappelons-nous aussi que Napoléon III se lance dans l’impérialisme guerrier pour se sauver de la révolution ouvrière montante.
52. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 30 août 2014, 21:01, par R.P.
Et n’oublions pas les Balkans qui connaissaient eux aussi un soulèvement révolutionnaire, contre l’oppression nationale et sociale...
53. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 31 août 2014, 10:18, par Robert Paris
Rosa Luxemburg décrivait ainsi dans "Was weiter" (Où allons-nous ?) l’impuissance du mouvement ouvrier organisé (politique et syndical) face aux mouvements de masse montants en Europe :
"La question est de savoir si la social-démocratie allemande, qui s’appuie sur les organisations syndicales les plus puissantes et la plus grande armée d’électeurs existant au monde, est capable d’impulser une action de masse du genre de celle qui a été suscitée... avec un grand succès dans la petite Belgique, en Italie, en Autriche-Hongrie, en Suède - sans parler de la Russie - ou si, par contre, en Allemagne, une organisation syndicale comptant deux millions de membres et un puissant parti bien discipliné sont aussi peu capables, dans les moments décisifs, de déclencher une action de masse efficace que les syndicats français paralysés par la confusion anarchiste et que le Parti socialiste français, affaibli par ses conflits internes."
54. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 31 août 2014, 15:37, par Robert Paris
Rappelons aussi la révolution mexicaine débutée en 1911...
En novembre 1910 l’insurrection démarre très lentement, et l’échec est sanglant à Puebla où les principaux conspirateurs (dont Aquiles Serdan) sont découverts et massacrés. Les premiers soulèvements ont lieu dans les régions minières du nord dans l’État de Chihuahua avec Pascual Orozco et les classes moyennes rurales, mais aussi en Basse-Californie, à Oaxaca, au Sonora et à Coahuila sous l’impulsion de guérilleros liés au Parti libéral mexicain, organisation de tendance libertaire fondée par Ricardo Flores Magón. Au printemps 1911, l’insurrection s’étend à d’autres régions, dans les États du nord et, tardivement, dans le Morelos, où se forme une armée de paysans villageois, sous la conduite d’Emiliano Zapata, un petit propriétaire, maire de son village : il soutient la cause madériste en échange de la promesse d’une réforme agraire. Le régime porfirien tombe en mai 1911 avec la démission et le départ en exil de Porfirio Díaz.
En tant que leader de la rébellion, Zapata doit se réfugier dans la montagne pendant la répression. Il réapparaît en 1909, en étant proclamé président de la Junte de Défense des terres de Ayala, commençant de cette manière son activité révolutionnaire. En Mars 1911 il rejoint le mouvement guérillero de Madero, renforçant le Plan de San Luis Potosí contre le dictateur Porfirio Díaz. Le Plan Ayala prévoit la restitution des terres à la population indigène et une véritable Réforme Agraire. Son ascension politique le conduit à prendre en charge l’organisation du mouvement révolutionnaire dans le sud du Mexique, étant nommé chef suprême du mouvement révolutionnaire de la région méridionale, puis chef maderiste de Morelos.
55. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 31 août 2014, 15:42, par Robert Paris
Et aussi la révolution chinoise débutée en 1911-1912 :
En 1905, des notables décident de construire avec leur propres fonds des voies de chemin de fer en Chine ; or en mai 1911 les autorités impériales sous l’impulsion du ministre Sheng Xuanhuai décrètent la nationalisation des voies de chemin de fer, les puissances étrangères voyant d’un mauvais œil l’influence du milieu des notables nationalistes. Les indemnités proposés aux notables chinois leur paraissent insuffisantes : ils créent des comités de défense notamment au Sichuan. Une ligue pour la protection des chemins de fer est créée, mais ses manifestations entrainent l’arrestation de ses dirigeants, suivie de manifestations pour réclamer la libération de ces derniers. La répression des manifestations cause plusieurs victimes, radicalisant la contestation. Les sympathies révolutionnaires gagnent la nouvelle armée du Hubei, un tiers environ de ses 15 000 hommes soutenant les républicains. En mai 1911, la nomination d’un nouveau gouvernement, dirigé par le prince Yikuang et composé d’une forte majorité de mandchous, est perçu comme une provocation.
Dans une caserne de Wuchang — un quartier de Wuhan —, le 10 octobre, des militaires de l’armée du Hubei s’insurgent et déclenchent un soulèvement armé. Le gouvernement impérial tarde à réagir et, dès le lendemain, la ville est contrôlée par les insurgés. Ils proclament la sécession de la province sous l’égide d’un gouvernement républicain, dirigé par le général Li Yuanhong, qui appelle à l’insurrection les autres provinces.
Plusieurs provinces chinoises proclament leur indépendance dans les semaines qui suivent : le 22 octobre, une troupe de révolutionnaires comptant des soldats de l’armée du Hubei marche sur Changsha et prend la ville, tuant le gouverneur du régime Qing. Le même jour, des membres du Tongmenghui lancent une insurrection à Xi’an et achèvent de prendre le contrôle de la ville le 23. Toujours le 23, le Tongmengui, mené notamment par Lin Sen, emmène un soulèvement des troupes du Jiangxi : un gouvernement militaire est proclamé à Jiujiang. Le 29, une insurrection armée, comptant Yan Xishan parmi ses leaders, éclate à Taiyuan : le gouverneur du Shanxi est tué et la province déclare à son tour son indépendance. Le 30, après la prise de Kunming, Cai E devient le chef du gouvernement militaire du Yunan. Le 31, Nanchang est prise à son tour par le Tongmenghui.
La cour impériale réagit en nommant le 14 octobre le général Yuan Shikai à la tête du gouvernement. L’armée de Beiyang est envoyée pour affronter les insurgés. Elle prend Hankou -un quartier de Wuhan. Mais dès le 2 novembre, Yuan Shikai, ne croyant plus à l’avenir de la dynastie Qing, déconsidérée depuis la guerre des Boxers et sans appui de l’étranger, entame des négociations secrètes avec les révolutionnaires. Le 9 novembre, Huang Xing prend contact avec Yuan et lui propose la tête de l’État.
Le drapeau à cinq couleurs.
Le 3 novembre, l’insurrection éclate à Shanghai, le gouvernement militaire étant proclamé dans la ville cinq jours plus tard. Le 4, la révolte gagne le Guizhou. Le 5, le gouverneur du Jiangsu, Cheng De, est amené par les insurgés à déclarer l’indépendance de la province. Le 6, c’est le tour du Guangxi et le 9, celui du Fujian, où le vice-roi Song Shou se suicide. Toujours le 9, l’indépendance du Guangdong est déclarée, Hu Hanmin prenant la tête du gouvernement de la province. À la fin novembre, le Sichuan tombe à son tour. Le même jour, Li Yuanhong télégraphie à tous les gouverneurs insurgés pour leur proposer de tenir une conférence à Wuchang et de fonder un nouveau gouvernement central. La conférence débute le 30 novembre, les délégués s’accordant finalement pour établir un gouvernement provisoire. Le 2 décembre, les révolutionnaires prennent Nankin. Entretemps, la Mongolie extérieure profite de la situation pour déclarer son indépendance le 1er décembre, établissant le khanat de Mongolie autonome : le Tibet expulsera à son tour les autorités chinoises en 1912, pour proclamer sa souveraineté l’année suivante.
Le 3 décembre, les troupes de Yuan Shikai s’accordent sur un cessez-le-feu avec les révolutionnaires et entame des négociations de paix.
Le 11, les délégués de dix-sept provinces, venus de Shanghai et Hankou, se réunissent dans la ville et parlementent à nouveau, s’accordant sur l’élection d’un président provisoire. Un nouveau drapeau national est choisi : certains réclament le choix du drapeau bleu à soleil blanc, emblème du Tongmenghui, mais le choix se porte finalement sur le drapeau à cinq couleurs, symbole de l’union de toutes les ethnies chinoises, qui contrebalance la tonalité jusque-là anti-mandchous de l’insurrection contre la Dynastie Qing. Un compromis est adopté, le drapeau au ciel bleu à soleil blanc devenant l’enseigne de vaisseau de la République. L’élection du président est repoussée, les insurgés apprenant que Yuan Shikai est prêt à les soutenir et décidant d’attendre sa décision.
Le 25 décembre, Sun Yat-sen, jusque-là en exil, arrive à Shanghai : en raison de son prestige, les révolutionnaires lui proposent d’assumer la présidence. L’élection a lieu le 29 décembre à Nankin, en présence de 45 délégués représentant 17 provinces. Recevant les suffrages de 16 provinces sur 17, Sun Yat-sen est élu président.
56. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er septembre 2014, 09:54, par Robert Paris
Rosa Luxemburg écrit dans une lettre du 13 mars 1906 : « Nous vivons des temps agités où tout ce qui existe mérite de disparaître. »(extrait de Faust de Goethe)
57. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er septembre 2014, 12:30, par Robert Paris
Il flottait déjà, avant même qu’éclate la première guerre mondiale, un parfum de révolution dans tout l’Empire Ottoman. Il y avait eu la guerre italo-ottomane lors de laquelle notre famille avait été contrainte de se réfugier à Beyrouth car Isaac, notre grand-père, était consul italien à Alep et sujet italien. Il y avait de multiples expressions de sentiments d’hostilité de toutes les nationalités opprimées de l’empire qui était attisé par les grandes puissances comme l’Angleterre et la France contre l’empire. Les Anglais entretenaient même une armée arménienne pour préparer le conflit contre l’empire. Les peuples avaient flairé leur libération et n’entendaient plus s’en laisser imposer par cette prison des peuples. Les Arméniens bougeaient. Les Kurdes bougeaient. Les Juifs étaient touchés par l’aspiration à la liberté. Les Alaouites se rebellaient. Avant même qu’éclate la révolution russe, tout était comme un baril de poudre près à exploser.
58. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er septembre 2014, 12:40
Le régime ottoman était déjà menacé, depuis 1900, de l’intérieur par la révolution bourgeoise jeune turque. Il n’avait pas eu la force d’écraser cette rébellion. Les Jeunes-Turcs parviennent à renverser le sultan en 1908 avec l’aide des mouvements minoritaires, et dirigent alors l’Empire ottoman. Comme l’empire, comme toutes les classes dirigeantes turques, les « jeunes turcs » se sentent menacés par la révolte des peuples et commencent à les massacrer systématiquement. Il faut dire que les grandes puissances laissent croire à ces peuples qu’ils vont les soutenir militairement contre l’empire, ce qui ne sera pas vrai…
59. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er septembre 2014, 16:32
En 1911 débute le soulèvement marocain du Rif contre le colonisateur, une guerre révolutionnaire...
60. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 2 septembre 2014, 07:39, par Robert Paris
Dans la révolte des peuples opprimés de l’Empire Ottoman, notons celle des Arméniens avec notamment la seconde révolte de Sassoun en 1904... La révolte monte jusqu’en 1915 où l’empire répond par le premier génocide des Arméniens.
61. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 9 septembre 2014, 09:14, par Robert Paris
Le début de la première guerre mondiale n’a pas été, contrairement à ce qui a été dit partout lors des commémorations, la déclaration de guerre mais seulement l’ordre de mobilisation et le gouvernement a commencé ses premiers mensonges de guerre par cette déclaration fameuse du président Poincaré : « La mobilisation, ce n’est pas la guerre »…. !
62. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 10 septembre 2014, 06:12, par Robert Paris
De 1910 à 1914, Rosa Luxemburg mène une polémique publique contre Kautsky et reproche publiquement à la social-démocratie allemande de freiner les grèves, de refuser les grèves générales politiques, de refuser de tirer des leçons du vaste mouvement européen de grèves générales tendant à devenir insurrectionnelles. Alors que Kautsky affirme que les grèves se font de plus en plus rares en Allemagne, Rosa Luxemburg écrit :
« Que nous montre, par exemple, la statistique des grèves en Allemagne ? … Pendant toute la dernière décennie du XIXe siècle, il y a eu en Allemagne, en tout, 3 772 grèves et lockes outs, tandis que durant les neuf années allant de 1900 à 1908, il y en a eu 15.994. Les grèves deviennent si peu « de plus en plus rares » qu’au contraire elles ont quadruplé au cours de la dernière décennie ; en chiffres absolus, 425.142 travailleurs ont pris part à des grèves au cours de la dernière décennie du XIXe siècle et 1.709.415 au cours des neuf première années de ce siècle, sit quatre fois plus à nouveau… Mais regardons l’Europe occidentale. Le camarade Kautsky qui conteste tout ce que je viens de dire s’oblige à rompre des lances avec une autre contradictrice que moi : la réalité. Car que voyons-nous, si nous examinons attentivement les grèves de masse les plus importantes des dix dernières années ? Les grandes grèves de masse en Belgique qui avaient imposé le suffrage universel demeurent, dans les années 90, un exemple isolé, une expérience pleine de hardiesse. Mais depuis lors, quelle richesse d’expérience, quelle diversité ! En 190, c’est la grève de masse des mineurs de Pennsylvanie qui, selon les camarades américains, a fait davantage pour la diffusion des idées socialistes que dix ans d’agitation ; en 1900 encore, c’est la grève de masse des mineurs en Auutriche, en 1902 celle des mineurs en France, en 1902 encore celle qui paralyse tout l’appareil de production à Barcelone, en solidarité avec les métallurgistes en lutte, en 1902 toujours, la grève de masse démonstrative en Suède pour le suffrage universel égalitaire également ; la grève de masse des ouvriers agricoles dans l’ensemble de la Galicie orientale (plus de 200.000 participants) en défense du droit de coalition, en janvier et avril 1903, deux grèves de masse des employés des chemins de fer en Hollande, en 1904 grève démonstrative en Italie, pour protester contre les massacres en Sardaigne, en janvier 1905, grève de masse des mineurs dans le bassin de la Ruhr, en octobre 1905, grève démonstrative à Prague et dans la région praguoise (100.000 travailleurs) pour le suffrage universel au parlement de Bohême, en ocotbre 1905, grève de masse démonstrative à Lemberg pour le suffrage universel égalitaire au Conseil d’Empire, en 1905 encore grève de masse des travailleurs agricoles en Italie, 1905 toujours, grève de masse des employés de chemin de fer en Italie, en 1906, grève de masse démonstrative à Trieste pour le suffrage universel égalitaire au Parlement régional, grève couronnée de succès ; en 1906, grève de masse des travailleurs de fonderies de Wittkowitz (Moravie) en solidarité avec les 400 hommes de confiance licenciés pour avoir chômé le 1er mai, grève couronnée de succès ; en 1909, grève de masse en Suède pour la défense du droit de coalition ; en 1909, grève de masse des employés de postes en France ; en octobre 1909, grève démonstrative de l’ensemble des travailleurs de Trente et Rovereto, en protestation contre les poursuites engagées contre la social-démocratie ; en 1910, grève de masse à Philadelphie, en solidarité avec les employés de tramways en lutte pour le droit de coalition, et, en ce moment même, se prépare une grève de masse des employés des chemins de fer en France. Voilà donc pour ce qui est de l’ « impossibilité » des grèves de masse, notamment des grèves de masse démonstratives, si superbement démontrée noir sur blanc par le camarade Kautsky. »
63. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 septembre 2014, 07:59, par Robert Paris
Marx a exposé, dès la fin de la guerre franco-allemande de 1870, qu’une nouvelle guerre opposant la France alliée à la Russie d’un côté et l’Allemagne de l’autre en découlait nécessairement et que cette guerre serait cette fois mondiale. Engels a expliqué ensuite dans de multiples articles et courriers que la perspective de la guerre mondiale se couplait avec la montée du mouvement ouvrier et des révolutions (révolutions sociales comme révolutions des nationalités contre les empires).
Marx écrit ainsi :
« Quiconque n’est pas complètement abruti par les criailleries du moment ou n’a pas intérêt à duper le peuple allemand, doit reconnaître que la guerre de 1870 porte tout aussi nécessairement dans son sein une guerre entre l’Allemagne et la Russie alliée à la France que la guerre de 1870 est elle-même née de celle de 1866. Je dis fatalement, sauf dans le cas peu probable où une révolution éclaterait auparavant en Russie. » (lettre de fin août 1870 au comité social-démocrate de Brunswick)
On remarquera dans ce courrier comme dans les textes qui suivent que Marx et Engels, loin de prédire que la révolution européenne allait débuter forcément dans les pays les plus développés d’Europe comme on leur prête à tort, ont parfaitement analysé le rôle révolutionnaire de la situation en Russie.
Engels affirmait déjà, début 1886, concernant la perspective de guerre européenne, que :
« La guerre, si elle éclate, ne sera menée que dans le but d’empêcher la révolution… Une guerre mondiale d’une ampleur et d’une violence encore jamais vues. Huit à dix millions de soldats s’entrégorgeront ; ce faisant, ils dévoreront toutes l’Europe comme jamais ne le fit encore une nuée de sauterelles. »
Engels reprend plus en détails ces idées dans une lettre à Lafargue repoduite par le journal Le Socialiste, organe du Parti ouvrier, le 6 novembre 1886, article réédité ensuite en Amérique par le journal Der Socialist et le journal Sozial-demokrat ainsi que la Revista Socialista en Roumanie en décembre 1886 :
« Sous Napoléon III, la rive gauche du Rhin avait servi à détourner vers l’extérieur les passions révolutionnaires ; de même, le gouvernement russe montra au peuple inquiet et remuant la conquête de Constantinople, la « délivrance » des Slaves opprimés par les Turcs, et leur réunion en une grande fédération sous la présidence de la Russie… Le chauvinisme grandissait de jour en jour et devenait menaçant pour le gouvernement russe… Le chauvinisme slavophile est plus puissant que le tsar, il faut qu’il cède par peur d’une révolution, les slavophiles s’allieraient aux constitutionnels, aux nihilistes, enfin à tous les mécontents. La détresse financière complique la situation. Personne ne veut plus prêter à ce gouvernement qui a déjà emprunté 1 milliard 750.000 francs à Londres et qui menace la paix européenne… La révolution en Russie changerait immédiatement la situation en Allemagne : elle détruirait d’un coup cette foi aveugle en la toute-puissance de Bismarck, qui lui assure le concours des classes dirigeantes ; elle murirait la révolution en Allemagne… Pour se sauver de la révolution, le pauvre tsar est obligé de faire un nouveau pas en avant. Mais chaque pas devient plus dangereux ; car il ne se fait qu’au risque d’une guerre européenne, ce que la diplomatie russe a toujours cherché à éviter. Il est certain que, s’il y a intervention directe du gouvernement russe en Bulgarie et qu’elle amène des complications ultérieures, il arrivera un moment où l’hostilité des intérêts russes et autrichiens éclatera ouvertement. Il sera alors impossible de localiser la guerre ; elle deviendra générale… Il est plus que probable que, si la guerre éclate entre la Russie et l’Autriche, l’Allemagne viendra au secours de cette dernière pour empêcher son complet écrasement… Afin d’échapper à une révolution en Russie, il faut au tsar Constantinople ; Bismarck hésite, il voudrait le moyen d’éviter l’une et l’autre éventualité. Et la France ? Les Français patriotes, qui depuis seize ans rêvent de revanche, croient qu’il n’y a rien de plus naturel que de saisir l’occasion qui peut-être s’offrira. Mais, pour notre parti, la question n’est pas aussi simple ; elle ne l’est pas même pour messieurs les chauvins. Une guerre de revanche, faite avec l’alliance et sous l’égide de la Russie, pourrait amener une révolution ou une contre-révolution en France… La force qui, en Europe, pousse à une guerre est grande… Une guerre générale nous rejetterait en arrière… La révolution en Russie et en France serait retardée : notre parti subirait le sort de la Commune de 1871. Sans doute, les événements finiraient par tourner en notre faveur ; mais quelle perte de temps, quels sacrifices, quels nouveaux obstacles à surmonter !... Cette guerre qui nous menace jetterait dix millions de soldats sur le champ de bataille… Si guerre il y a, elle ne se fera que dans le but d’empêcher la révolution ; en Russie, pour prévenir l’action commune de tous les mécontents, slavophiles, constitutionnalistes, nihilistes, paysans ; en Allemagne, pour maintenir Bismarck ; en France, pour refouler le mouvement victorieux des socialistes et pour rétablir la monarchie. »
Les courriers d’Engels continuent ce type d’analyse. Par exemple, le 13 septembre 1886, Engels écrit à Bebel :
« Pour Bismarck et l’Empereur, l’alternative est la suivante : d’une part, résister à la Russie et avoir alors la perspective d’une alliance franco-russe et d’une guerre mondiale, ou la certitude d’une révolution russe grâce à l’alliance des panslavistes et des nihilistes ; d’autre part, céder à la Russie, autrement dit trahir l’Autriche… En tout cas, l’antagonisme entre l’Autriche et la Russie s’est aiguisé dans les Balkans, au point que la guerre semble plus vraisemblable que la paix. Et ici, il n’y a plus de localisation possible de la guerre… Bref, il y aura un chaos et la seule certitude est : boucherie et massacre d’une ampleur sans précédent dans l’histoire ; épuisement de toute l’Europe à un degré inouï jusqu’ici, enfin effondrement de tout le vieux système… La meilleure solution serait la révolution russe, que l’on ne peut escompter qu’après de très lourdes défaites de l’armée russe. Ce qui est certain, c’est que la guerre aurait pour premier effet de rejeter notre mouvement à l’arrière-plan dans toute l’Europe, voire le disloquerait totalement dans de nombreux pays, attiserait le chauvinisme et la haine entre les peuples, et parmi les nombreuses possibilités négatives nous assurerait seulement d’avoir à recommencer après la guerre par le commencement, bien que le terrain lui-même serait alors bien plus favorable qu’aujourd’hui. »
Le 23 octobre 1886, il rajoutait, dans une lettre à Bebel :
« Les Russes ont dit à Bismarck, et il sait que c’est vrai, que « Nous avons besoin de grands succès du côté de Constantinople ou bien, alors, c’est la révolution »… Or ce que Bismarck redoute le plus, c’est une révolution russe, car la chute du tsarisme russe entraîne avec elle celle du règne prusso-bismarckien. Et c’est pour cela qu’il met tout en œuvre pour empêcher l’effondrement de la Russie – malgré l’Autriche, malgré l’indignation des bourgeois allemands, malgré que Bismarck sache qu’il enterre lui aussi en fin de compte son système… Nul ne peut prévoir quel sera le regroupement des combattants : avec qui l’un s’alliera et contre qui il s’alliera. Il est clair que l’issue finale sera la révolution. Mais avec quels sacrifices ! Avec quelle déperdition des forces – et après combien de tourments et de zigzags ! (…) Qu’il y ait la guerre ou la paix, l’hégémonie allemande est anéantie depuis quelques mois, et l’on redevient le laquais servile de la Russie. Or, ce n’était que cette satisfaction chauvine, à savoir être l’arbitre de l’Europe, qui cimentait tout le système politique allemand. La crainte du prolétariat fait certainement le reste… »
Insistons, durant toutes les années 1880, Engels répète que « La Russie est à l’avant-garde du mouvement révolutionnaire en Europe. »
64. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 septembre 2014, 16:03, par Robert
Rosa Luxemburg écrit en mars 1917 dans « La révolution en Russie » :
« La guerre a retardé de quelques années mais n’a pu empêcher ce que l’on sentait déjà sourdre avant qu’elle n’éclatât : la résurgence de la révolution russe. Le prolétariat russe qui, dès 1911, était parvenu à lever le faix de plomb de la période contre-révolutionnaire et d’année en année, dans les luttes de masses et les manifestations économiques et politiques, avait à nouveau brandi de plus en plus haut le drapeau révolutionnaire de 1905, le prolétariat russe n’a permis à la guerre de le désorganiser, à la dictature du sabre de le bâillonner, au nationalisme de le fourvoyer que pendant deux ans et demi. Il s’est relevé pour secouer le joug de l’absolutisme et a contraint la bourgeoisie à aller provisoirement de l’avant. Si aujourd’hui la révolution en Russie a été victorieuse si rapidement, en quelques jours à peine, c’est uniquement parce qu’elle n’est dans son essence historique que la prolongation de la grande révolution de 1905-1907. La contre-révolution n’est parvenue à l’écraser que pour une période très brève, mais l’œuvre inachevée de la révolution exigeait inexorablement d’être menée à son terme et l’énergie de classe inépuisable du prolétariat russe s’est embrasée même dans des circonstances aussi difficiles que celles d’aujourd’hui. Ce furent les souvenirs récents des années 1905-1906, du pouvoir politique partiellement illimité du prolétariat en Russie, de ses vaillants assauts, de son programme révolutionnaire radical qui permirent à la bourgeoisie de décider avec cette étonnante rapidité de prendre la tête du mouvement. Ce fut la crainte d’un développement sans entraves d’une révolution populaire comme celle qui, en 1905-1907… »
65. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 septembre 2014, 16:11, par Robert
Karl Kautsky et la première révolution russe de 1905 : "Ce qui promet de s’ouvrir c’est (...) une ère de révolutions européennes, qui aboutiront à la dictature du prolétariat, à la mise en train de la société socialiste."
66. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 22 septembre 2014, 16:14, par Robert Paris
Pour quelle raison, la guerre mondiale ?
Engels reliait la nécessité, pour les classes dirigeantes, de la guerre mondiale et la montée en force du prolétariat.
Parlant du développement du mouvement ouvrier, présenté comme une armée qui préparait l’affrontement avec la bourgeoisie mondiale ou la guerre mondiale, Engels écrivait :
« Nous menons une guerre de siège contre notre ennemi, et tant que nos tranchées ne cessent de progresser et de resserrer l’étau, tout va bien. Nous sommes maintenant tout près du second parallèle, où nous dresserons nos batteries démontables et pourrons bientôt faire taire l’artillerie adverse. Or, nous sommes déjà assez avancés pour que les assiégés ne puissent être dégagés momentanément de ce blocus que par une guerre mondiale. »
(Lettre d’Engels à H. Schlüter, où il reprend des arguments de son article « La future guerre mondiale et la révolution » – 19/03/1887)
67. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 23 septembre 2014, 12:09
Le texte de Trotsky qui suit démontre que, pour lui, en 1908, la révolution montait en Turquie et en Iran : lire ici
68. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 23 septembre 2014, 12:17
Au premier coup d’œil, on pourrait croire que les perspectives sociales-révolutionnaires de l’époque future sont à jamais détruites quand on contemple l’effondrement des Partis socialistes. Un tel scepticisme dans la conclusion serait une erreur. Il ignorerait le bon côté de la dialectique historique, tout comme nous avions trop souvent ignoré son mauvais côté.
La guerre de 1914 conduit au naufrage des Etats nationaux. Les Partis socialistes, appartenant à une époque désormais révolue, étaient des Partis « nationaux ». Ils se sont développés sous l’égide des gouvernements nationaux et les ont toujours défendus, alors même que l’Impérialisme, s’appuyant sur la base nationale, détruisait les entraves constituées par les différents nationalismes.
Dans leur chute historique, les gouvernements nationaux entraînent avec eux les Partis socialistes nationaux.
Le Socialisme ne périra pas, mais seule disparaîtra son expression historique provisoire. L’idée révolutionnaire se transforme.
Oui ! L’idée révolutionnaire se transforme. On peut dire qu’elle « mue » en rejetant loin d’elle sa vieille peau. Cette idée révolutionnaire s’incarne en personnes vivantes : c’est toute une génération socialiste qui, grâce à un travail d’agitation organisé, bouscule la réaction politique engourdie dans les routines du national « Possibilisme ».
De même que les gouvernements nationaux furent un frein au développement des forces productrices, de même les vieux Partis socialistes nationaux ont été le principal obstacle à l’avance révolutionnaire des classes laborieuses.
Ils devaient cacher toute l’ampleur de leur retard, masquer la mesquinerie de leurs méthodes. Ils ont apporté au prolétariat l’horreur et la honte de la lutte intestine à tel point que celui-ci, parmi les affres du désespoir, se libère des préjugés et des routines serviles et devient ce à quoi l’appelle la voix de l’Histoire : la Classe révolutionnaire luttant pour le Pouvoir.
Voilà ce qu’écrivait Trotsky en octobre 1914 dans "La guerre et l’internationale"
69. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 23 septembre 2014, 12:58, par Robert Paris
Voici la description par Lénine de la situation mondiale le 1er mars 1913 dans "Les destinées historiques de la doctrine de Karl Marx" :
« Les opportunistes n’avaient pas encore fini de glorifier la "paix sociale" et la possibilité d’éviter les tempêtes sous la "démocratie", que s’ouvrait en Asie une nouvelle source de grandes tempêtes mondiales. La révolution russe a été suivie des révolutions turque, persane, chinoise. Nous vivons aujourd’hui justement à l’époque de ces tempêtes et de leur "répercussion en sens inverse" en Europe. Quel que soit le destin réservé à la grande République chinoise, qui excite aujourd’hui les appétits de toute sorte d’hyènes "civilisées", aucune force au monde ne pourra rétablir le vieux féodalisme en Asie, ni balayer de la surface de la terre le démocratisme héroïque des masses populaires dans les pays asiatiques et semi-asiatiques... A la suite de l’Asie, l’Europe commence à se remuer mais pas à la manière asiatique. La période "pacifique" de 1872-1904 est à jamais révolue. La vie chère et l’emprise des trusts provoquent une aggravation sans précédent de la lutte économique, aggravation qui a même secoué les ouvriers anglais, les plus corrompus par le libéralisme. Une crise politique mûrit sous nos yeux même dans le plus "irréductible" pays de la bourgeoisie et des junkers, en Allemagne. »
70. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 23 septembre 2014, 13:01, par R.P.
Lénine
L’Europe arriérée et l’Asie avancée
18 mai 1913
Ces mots juxtaposés semblent un paradoxe. Qui ne sait pas que l’Europe est avancée et que l’Asie est arriérée ? Pourtant, les mots qui ferment le titre de cet article renferment une amère vérité.
L’Europe civilisée et avancée, avec sa technique brillamment développée, avec sa riche et multiple culture et sa Constitution, est arrivée à un moment historique où la bourgeoisie qui commande, soutient, par crainte du prolétariat grandissant en nombre et en force, tout ce qui est arriéré, agonisant, moyenâgeux. La bourgeoisie en voie de disparition s’allie à toutes les forces périmées ou périclitantes pour maintenir l’esclavage salarié ébranlé.
Dans l’Europe avancée commande la bourgeoisie, qui soutient tout ce qui est arriéré. De nos jours l’Europe est avancée, non pas grâce à la bourgeoisie, mais malgré elle ; car seul le prolétariat voit augmenter les millions de combattants qui forment son armée en lutte pour un avenir meilleur ; lui seul garde et répand une haine implacable pour tout ce qui est arriéré, pour la sauvagerie, les privilèges, l’esclavage et l’humiliation de l’homme par l’homme.
Dans l’Europe "avancée", seul le prolétariat est une classe avancée . Tandis que la bourgeoisie encore en vie est prête à tous les actes de sauvagerie, de férocité et à tous les crimes pour sauvegarder l’esclavage capitaliste en perdition.
On ne saurait guère fournir un exemple plus frappant de cette putréfaction de toute la bourgeoisie européenne que celui de son soutien de la réaction en Asie, pour les buts égoïstes des brasseurs d’affaires de la finance et des escrocs capitalistes.
En Asie croît, s’étend et se fortifie partout un puissant mouvement démocratique. La bourgeoisie y est encore avec le peuple contre la réaction. Des centaines de millions d’hommes s’éveillent à la vie, à la lumière, à la liberté. Quel enthousiasme ce mouvement universel provoque dans le cœur de tous les ouvriers conscients, qui savent que le chemin du collectivisme passe par la démocratie ! De quelle sympathie sont pénétrés tous les démocrates honnêtes pour la jeune Asie !
Et l’Europe "avancée" ? Elle pille la Chine et aide les ennemis de la démocratie, les ennemis de la liberté en Chine !
Voici un petit calcul simple, mais édifiant. Le nouvel emprunt de Chine a été contracté contre la démocratie chinoise. L’"Europe" est pour Yuan Chi-kaï qui prépare la dictature militaire. Et pourquoi le soutient-elle ? Par ce qu’elle fait une bonne affaire. L’emprunt a été contracté pour une somme d’environ 250 millions de roubles, au cours de 84 pour 100. Cela veut dire que les bourgeois d’"Europe" payent aux Chinois 210 millions de roubles, tandis qu’ils font payer au public 225 millions. Voilà d’un seul coup, en quelques semaines, un bénéfice net de 15 millions de roubles ! N’est-ce pas, en effet, un bénéfice "net " ?
Et si le peuple chinois ne reconnaît pas l’emprunt ? La Chine n’est-elle pas une République, et la majorité du parlement n’est-elle pas contre l’emprunt ?
Oh, alors, l’Europe "avancée" poussera des cris à propos de "civilisation", d’"ordre", de "culture", de "patrie" ! Alors elle fera donner du canon et écrasera la République de l’Asie "arriérée", en alliance avec l’aventurier, le traître et l’ami de la réaction Yuan Chi-kaï !
Toute l’Europe qui commande, toute la bourgeoisie européenne fait alliance avec toutes les forces de la réaction et du moyen âge, en Chine.
En revanche toute la jeune Asie, c’est-à-dire des centaines de millions de travailleurs d’Asie ont un allié sûr dans le prolétariat de tous les pays civilisés. Nulle force au monde ne pourra empêcher sa victoire, qui affranchira les peuples d’Europe comme les peuples d’Asie.
71. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 23 septembre 2014, 15:00
Souvenirs de la guerre de 1914 : « Témoignage » d’Eugène Dabit Lire ici
72. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 6 octobre 2014, 08:14
La guerre pour quelle raison ? Pour défendre l’Alsace et la Lorraine ? Voir ici la vérité : cliquez là
73. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 octobre 2014, 20:11
« Kautsky était encore marxiste, par exemple en 1909, au moment où il écrivait le Chemin du pouvoir, il soutenait précisément l’idée que la guerre rendait la révolution inévitable ; il disait que l’ère des révolutions approchait. Le Manifeste de Bâle [2], en 1912, fait état expressément et en toute netteté de la révolution prolétarienne par suite de la guerre impérialiste qui justement a éclaté en 1914 entre les groupes allemand et anglais. Or en 1918, lorsque par suite de la guerre, les révolutions ont éclaté, Kautsky, au lieu d’expliquer leur caractère inéluctable, au lieu d’étudier et de méditer à fond la tactique révolutionnaire, les moyens et les méthodes de préparation à la révolution, se met à qualifier d’internationalisme la tactique réformiste des menchéviks. N’est ce pas là une besogne de renégat ? »
Lénine
74. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 2 novembre 2014, 07:26
Le début de la Première Guerre mondiale qui devait être
« la der des ders » il y a cent ans, aura été
célébré de la façon la plus éclatante, la moins
protocolaire qui soit : par une série de massacres à
Gaza, en Irak, en Syrie, en Ukraine, en Lybie, sans parler
de ceux qui se poursuivent dans un quasi silence médiatique
en République Centrafricaine, au Soudan, en Érythrée et
certaines zones reculées en Birmanie, au Congo Kinshasa ou
en Chine. Sans parler des milliers de personnes qui tentent
de fuir ces guerres et finissent par mourir dans une zone
désertique, au fond d’une mer ou d’un océan.
Terrifiante continuité dans la barbarie entre l’été
1914 et l’été 2014.
Les grandes puissances, dont la France, ont joué leur
partition en coulisse ou directement dans ces guerres. À
présent, elles en mènent une nouvelle en Irak avec toute
une brochette de dictatures pétrolières, au mépris des
intérêts des peuples de la région. Tout ce que ce monde
capitaliste furieusement décadent depuis un siècle compte
d’irresponsables à la tête des États, des armées, des
grandes banques et entreprises et des formations
politiciennes qui complètent le dispositif, est en ordre de
marche pour sauver le système. À l’échelle mondiale, nous
assistons à une inquiétante montée des militarismes et
des nationalismes pour essayer de détourner l’attention des
vrais enjeux et pour casser la dynamique des luttes et des
mobilisations de toutes sortes.
Ce système impérialiste chaotique ne se serait pas
maintenu depuis un siècle s’il n’avait réussi à infuser
dans des millions de cerveaux une drogue morale, sorte de
lot de consolation, qui, lorsque les conditions s’y
prêtent, s’avère être une arme destructrice et même
autodestructrice : l’identité nationale, l’identité
ethnique ou l’identité religieuse. Au nom de ces identités
fallacieuses, on a pu détourner son regard du malheur
frappant « l’autre », montrer du doigt « l’autre »,
haïr « l’autre » et finalement dénoncer, combattre,
martyriser et tuer « l’autre », qu’il soit « le
Juif », « l’Arabe », « l’Allemand », « le
Noir », « l’Arménien », « le Tzigane », « le
Tutsi », etc. De ce point de vue, ni la Première Guerre
mondiale, ni la Deuxième de 1939-1945 ne sont encore
terminées. La guerre d’Algérie non plus ne l’est pas
davantage en ayant laissé en héritage le mépris ou la
haine des immigrés, de leurs enfants et de leurs
petits-enfants. L’antisémitisme, le racisme et la
xénophobie relèvent toujours la tête.
75. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 novembre 2014, 21:23
Le 17 novembre 1917, quelques jours seulement après la révolution d’Octobre (qui a lieu à Pétrograd le 8 novembre (26 octobre) 1917) éclate « l’émeute de Zurich ». Une fête spontanée est organisée par des pacifistes marginaux et des cercles de la jeunesse de gauche, pour fêter la victoire des bolcheviks en Russie. Elle provoque la mort de trois manifestants et d’un policier. On en attribua l’entière responsabilité au Parti socialiste suisse et à l’Union syndicale suisse, qui n’avaient pourtant joué aucun rôle dans ces événements.
Novembre 1918 - La grève générale
Un an plus tard, à l’approche du premier anniversaire de la révolution d’Octobre, diverses personnalités, dont le général Ulrich Wille, font part de leur inquiétude au Conseil fédéral, qui ordonne l’occupation militaire préventive de la ville de Zurich pour éviter toute insurrection révolutionnaire. Le comité d’Olten, qui regroupe les forces politiques et syndicales du socialisme suisse, répond par des grèves de protestation. Le Conseil fédéral refusant de faire marche arrière, le Comité d’Olten lance un appel à la grève générale (12-14 novembre 1918).
Le comité d’Olten présente neuf revendications :
Renouvellement immédiat du Conseil national selon le système de la représentation proportionnelle,
Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes,
Introduction du droit au travail pour tous,
Introduction de la semaine de 48 heures, dans toutes les entreprises publiques ou privées,
Organisation d’une armée essentiellement populaire,
Mesures visant à assurer le ravitaillement,
Assurance vieillesse et survivants,
Monopole de l’État pour les importations et les exportations,
Paiement des dettes publiques par les possédants.
La grève est suivie par quelque 250 000 ouvriers, on remarque une très forte participation dans les villes industrielles, mais bien plus faible en Suisse romande et au Tessin, qui sont occupés à fêter l’armistice de 1918. La participation des cheminots est déterminante car elle permet l’extension de la grève même aux régions rurales écartées. La grève se déroule dans le calme, les syndicats ayant pris des mesures préventives comme la prohibition de l’alcool. Il n’y a que peu de dérapages, comme à Granges, où trois grévistes sont tués le 14 novembre.
Après trois jours, les soldats envoyés en nombre par le Conseil fédéral sont maîtres de la situation. Le comité d’Olten cède sans condition, la grève est un échec. Le vendredi 15, le travail reprend presque partout sauf à Zurich, où les ouvriers du bois et les métallurgistes ne reprennent le travail que le lundi 18.
Conséquences
Plus de 3 500 personnes sont mises en accusation par la justice militaire dont grand nombre de cheminots, 147 personnes sont condamnées.
Certains points des revendications sont cependant appliqués :
Le point 1 avait en fait été accepté dès le 18 octobre 1918. La première élection au système proportionnel aurait dû avoir lieu en 1920. Elle se tient en 1919.
Le point 4, la semaine de 48 heures, est introduit en 1919.
Quant au point 7, l’AVS, qui est accepté par le peuple en 1925, il n’entre en vigueur qu’en 1948.
Du côté des ouvriers, la grève générale est l’événement qui a fait trembler la bourgeoisie. Du côté bourgeois, il s’agit du jour où la Suisse a failli « passer au bolchevisme ».
De cette grève, il résulte la naissance d’une certaine politique de consensus social. Mais les partis bourgeois se méfieront longtemps du parti socialiste, qui n’obtient un premier siège au Conseil fédéral qu’en 1943.
76. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 novembre 2014, 12:12, par Robert Paris
« Ce ne sont pas des soldats : ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie humaine [...] Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu’on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés. »
Henri BARBUSSE, Le Feu
77. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 novembre 2014, 12:17, par Robert Paris
Quel est le but de la guerre ? Vaincre l’ennemi !
Qui est l’ennemi principal ? La classe ouvrière organisée sur des bases de classe !
L’union sacrée imposé par la "défense de la patrie", voilà le moyen de briser l’alliance internationale de classe du prolétariat !
« Dans la guerre qui s’engage, la France [...] sera héroïquement défendue par tous ses fils dont rien ne brisera, devant l’ennemi, l’union sacrée. »
Raymond POINCARÉ, Message aux Chambres, 4 août 1914
78. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 novembre 2014, 12:22, par Robert Paris
« Ceux qu’ont l’pognon, ceux-là r’viendront,
Car c’est pour eux qu’on crève.
Mais c’est fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève.
Ce s’ra votre tour, messieurs les gros,
De monter sur l’plateau,
Car si vous voulez la guerre,
Payez-la de votre peau ! »
La Chanson de Craonne, printemps 1917
79. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 novembre 2014, 12:26, par Robert Paris
« Ma formule est la même partout. Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique étrangère ? Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. »
Georges CLEMENCEAU, Chambre des députés, 8 mars 1918
Politique des classes, je fais la guerre... à la classe ouvrière !
80. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 novembre 2014, 16:06
« Gémeau approuve et déclare que Pétain aurait dû faire fusiller 2 000 hommes et non 30 seulement, lors des mutineries de l’an dernier. La situation de l’armée française fut alors très grave et exigeait des mesures radicales pour extirper l’ulcère. Au lieu de les entraîner, on donna aux hommes des permissions et du repos » .
7 juin 1918 – Déclaration du commandant Gémeau, officier de liaison Français auprès du G.Q.G. britannique- Extrait de : Haig (Douglas), Les Carnets Secrets du Maréchal Douglas Haig, 1914-1919, présentés par Robert Blake, Presses de la Cité, Paris, 1964.
81. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 novembre 2014, 16:07
« La catastrophe de 1914 est d’origine allemande. Il n’y a qu’un menteur professionnel pour le nier. »
Georges Clemenceau, Grandeurs et misères d’une victoire
82. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 novembre 2014, 16:30, par Robert Paris
« Le retournement en août 1914 de la politique ouvrière […] soulève des problèmes considérables. C’est pourquoi il fait l’objet d’une polémique idéologique qui, après plus de quarante ans, n’a guère perdu de sa virulence. Si le premier devoir est […] de déterminer scrupuleusement quand et comment les choses se sont passées, on ne saurait cependant échapper ensuite à la nécessité de se prononcer sur le “qui” et le “pourquoi”. » écrit A. Kriegel, Aux origines du communisme français.
Contre qui ?
Contre le prolétariat international !
Pourquoi ?
Parce que 1914, c’est guerre mondiale ou révolution mondiale !
Lénine écrit comme cause de guerre : "la volonté d’enrayer le mouvement révolutionnaire du prolétariat" !
Voici la citation : "La guerre européenne et mondiale présente tous les caractères d’une guerre bourgeoise, impérialiste, dynastique. La lutte pour les marchés et pour le pillage des autres Etats, la volonté d’enrayer le mouvement révolutionnaire du prolétariat et de la démocratie à l’intérieur des pays belligérants, la tentative de duper, de diviser et de décimer les prolétaires de tous les pays en jetant les esclaves salariés d’une nation contre ceux d’une autre au profit de la bourgeoisie, tel est le seul contenu réel de la guerre, telle est sa signification."
dans "Les tâches de la social-démocratie révolutionnaire dans la guerre européenne"
83. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 novembre 2014, 09:46
Comme le résumait un grand banquier américain le 25 mars 1917 pour la revue Les Annales « Plus encore que le Kaiser, ce sont les banques de Berlin qui ont voulu la guerre ! » :
« Je pourrais vous confier que lorsqu’un peuple est sur le point de se sentir trop riche, une guerre est nécessaire pour l’arracher à la tentation du bonheur. Mais les idées abstraites ne sont pas mon fait. Je ne connais que les chiffres. J’ignore La Fayette. J’ignore si l’Allemagne attaqua la première. De l’histoire je ne retiens que la statistique. Je sais une chose, c’est que la Grande Guerre a quintuplé le chiffre de nos affaires, décuplé nos bénéfices et tout ce trafic magnifique nous l’avons opéré avec les Alliés. Nous nous sommes enrichis en vous procurant du coton, de la laine, de la viande, de l’acier, des obus, du blé, du cuir, des souliers, des mitrailleuses, des chevaux, des automobiles, des produits chimiques. Nos actions d’aciéries, telles que la Bethleem, ont monté en six mois de 600 pour cent. Nos poudreries, telles que l’usine Dupont, distribuent des dividendes de 110 pour cent. Le moindre de nos débardeurs ne travaille pas à moins d’un salaire de 35 francs par jour. C’est vous qui soldez. Tout ce qu’on pouvait vous vendre, nous vous l’avons vendu. Vous nous avez payés partie en or. Notre stock or dépasse aujourd’hui le stock or de tous les Alliés réunis. Mais vous nous avez payés aussi avec du papier. Or vos traites ne vaudront que ce que vaudra votre victoire. Il faut que vous soyez victorieux à tout prix pour faire face à vos engagements.
« Je vois plus loin encore. Il vous faudra reconstruire tout ce qui fut détruit. Cet argent que nous avons gagné sur vous, nous vous le prêterons pour relever vos villes, pour rebâtir vos fabriques, pour créer à nouveau votre existence économique. Un beau champ s’offre là pour nos placements futurs. Mais ce champ ne sera profitable que si vous triomphez avant l’épuisement complet. Voilà pourquoi nous voulons votre victoire rapide. L’Union vous aidera. Nous sommes derrière Wilson. Les rois eux-mêmes sont nos esclaves. Nous voulons la guerre ne serait-ce que pour protéger la flotte marchande anglaise dont la moitié du capital est yankee. Nous vous aiderons plus encore que vous ne pensez. Nous enverrons des volontaires, nous voterons le service militaire obligatoire, nous augmenterons encore notre production en obus, en canons, nous prendrons part s’il le faut, à la lutte continentale. Tous nos citoyens marcheront. L’Union n’est-elle pas déjà une gigantesque armée civile, exercée, assouplie, soumise de longue date à la rigoureuse discipline du trust. De cette armée nous sommes les chefs. Vous comprenez maintenant pourquoi la guerre est inévitable ? Les luttes entre peuples ? Mais c’est le seul moyen que nous avons de régler de trop lourdes différences en banque ! La Grande Guerre ? Guerre des tarifs, la nécessité d’un traité douanier avantageux, l’espoir d’une expansion économique nouvelle ! Plus encore que le Kaiser, ce sont les banques de Berlin qui ont voulu la guerre ! »
84. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 novembre 2014, 09:49
A tous les enfants (Boris Vian)
A tous les enfants qui sont partis le sac à dos
Par un brumeux matin d’avril
Je voudrais faire un monument
A tous les enfants
Qui ont pleuré le sac au dos
Les yeux baissés sur leurs chagrins
Je voudrais faire un monument
Pas de pierre, pas de béton
Ni de bronze qui devient vert
Sous la morsure aiguë du temps
Un monument de leur souffrance
Un monument de leur terreur
Aussi de leur étonnement
Voilà le monde parfumé,
Plein de rires, plein d’oiseaux bleus
Soudain griffé d’un coup de feu
Un monde neuf où sur un corps
qui va tomber
.
Grandit une tache de sang
Mais à tous ceux qui sont restés
Les pieds au chaud, sous leur bureau
En calculant le rendement
De la guerre qu’ils ont voulue
A tous les gras tous les cocus
Qui ventripotent dans la vie
Et comptent et comptent leurs écus
A tous ceux-là je dresserai
Le monument qui leur convient
Avec la schlague, avec le fouet
Avec mes pieds avec mes poings
Avec des mots qui colleront
Sur leurs faux-plis sur leurs bajoues
Des larmes de honte et de boue.
85. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 novembre 2014, 12:45
Comment expliquer une guerre aussi inhumaine, aussi générale ?
2a) La nature humaine ?
" Le fait est que les hommes dans leur grande majorité sont prêts à considérer, du moins en certaines circonstances, que le recours aux armes est une démarche légitime. Ce peut être le désir d’enrichir sa communauté et d’exalter son amour-propre... Ces considérations nous rappellent que la guerre est dans la nature humaine" (Robin Prior et Trevor Wilson ; Atlas des guerres ; La Première Guerre mondiale). Je comprends qu’un professeur d’Académie militaire fasse de la guerre une essence de la nature humaine. Mais, est-ce qu’en 1914 "les hommes dans leur grande majorité" ont fait délibérément le choix de la guerre ? Ayant beaucoup vécu enfant dans le monde des anciens combattants de 14, je suis en accord avec le récit de mon père ( Le chant des rivières) : " Le 1er août 1914, jour d’une grande foire à Entraygues, le tocsin sonna à trois heures de l’après-midi. Dès les premiers sons de cloche tout le monde comprit. Madame Marc passait en ce moment sur le trottoir où ma mère tenait une mercerie. Cette pauvre femme tomba évanouie. Pressentiment...? Peut-être. Son mari ne revint jamais... Cinq minutes après, le champ de foire était vide. Le silence, plus un bruit dans les cabarets... A la campagne, surpris à l’époque des grands travaux, les gens restaient comme assommés. Ce n’est que dans les casernes..."
2b) L’engrenage des alliances ?
Ce fait-là, souvent mise en avant dans les manuels scolaires, ne constitue pas vraiment une cause. Depuis 1880, chaque "Etat" :
– avait choisi une alliance en fonction de ses intérêts ;
– avait maintenu ou pas cette alliance fonction de ses intérêts ( la diplomatie anglaise est essentiellement dirigée contre la France dans les années 1890 avant de s’allier à elle)
– a fait jouer ou pas ses alliances en 1914, fonction de ses intérêts ( l’Italie, alliée de l’Allemagne et de l’Autriche Hongrie jusqu’en 1914 n’entre pas en guerre avec elles puis s’allie à la France et à la Grande Bretagne).
De plus, même si ces alliances ont joué un rôle, reste à expliquer le pourquoi de celles-ci. De plus, des personnalités, des gouvernements ont concrètement pesé en faveur de la guerre et de l’engrenage des alliances. Ainsi, le 20 mai 1914, le chef d’état-major général allemand Moltke demande à la Wilhemstrasse de faire des préparatifs politico-militaires en vue d’une guerre préventive contre la Russie et la France. Ainsi, l’état-major autrichien voulait la guerre. Ainsi, à mon avis, le Royaume-Uni attendait la bonne occasion pour affaiblir l’Allemagne. Ainsi, le président de la République française Raymond Poincaré a largement pesé en faveur de la guerre au moment décisif fin juillet ; or, il s’agit d’une grande personnalité de la droite et du capitalisme français du 20ème siècle.
c) Un hasard malencontreux ?
Quiconque parcourt les ouvrages spécialisés récents peut constater la vogue d’une méthode importée des Etats Unis pour qui l’histoire et même ses conflits majeurs naissent essentiellement de la conjonction accidentelle d’évènements fortuits. A.J.P. Taylor en est l’exemple type lorsqu’il explique la Guerre de 14-18 comme l’aboutissement d’une succession de facteurs secondaires : hasards, incidents, manoeuvres diplomatiques manquées, déclaration de guerre visant plus à à intimider qu’à provoquer le conflit, plans de mobilisation soumis aux horaires de chemin de fer" pris pour une attaque en règle... De telles "explications" nécessitent d’empiler des centaines de pages de faits décousus pour ne donner, en fin de compte, aucune cohérence causale.
La méthode "américaine" non causaliste, pèse parmi les historiens français des 20 dernières années :
– "Plus un évènement est lourd de conséquences, moins il est possible de le penser du point de vue de ses causes" ( François Furet)
– " La question des causes de la guerre de 1914 est d’une extrême complexité et, dans une large mesure, il reste une part de mystère dans la manière dont les puissances européennes se sont laissées glisser vers la catastrophe" ( Stéphane Audouin et Annette Becker dans " La Grande guerre" chez Gallimard).
d) L’attentat de Sarajevo
Le type d’"explications" ci-dessus domine aujourd’hui dans les manuels scolaires ; aussi, l’assassinat de l’archiduc héritier d’Autriche a bon dos. Comme si un évènement mineur pouvait déclencher une guerre mondiale sans raisons plus profondes. D’ailleurs, plusieurs personnalités politiques autrichiennes avaient expliqué dès 1919 comment cet assassinat avait été un prétexte.
e) Le choix de la guerre par des régimes autocratiques confrontés aux mouvements sociaux et démocratiques
Ce choix d’une "bonne guerre" pour rassembler la "nation" autour de son "sauveur" ne fait pas de doute pour de nombreuses personnalités proches du pouvoir, à Vienne et à Moscou en particulier. La Russie par exemple est secouée en juin et juillet 1914 par des grèves générales massives, y compris dans la capitale Saint Petersbourg.
Non, l’explication fondamentale est que l’Etat est là pour combattre la lutte des classes et la guerre des Etats encore pour combattre la lutte des classes et la guerre mondiale pour combattre la révolution mondiale !
86. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 novembre 2014, 14:57, par F. Kletz
« Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir la guerre entre les peuples, c’est abolir la guerre économique, le désordre de la société présente... »
Jean Jaurès
« Prolétaires, l’ennemi principal est dans votre propre pays ! »
Karl Liebknecht
87. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 20 novembre 2014, 12:22
Howard Zinn, historien et militant étasunien, dans son livre, « Une histoire populaire des États-Unis (de 1492 à nos jours) », analyse ainsi, sans prendre de gants, une des principales raisons de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917 :
« Le capitalisme américain avait besoin de cette rivalité internationale — et de ces guerres périodiques — pour créer une communauté artificielle d’intérêt entre riches et pauvres propre à supplanter la communauté originelle d’intérêt entre pauvres qui engendrait des mouvements sporadiques de révolte. »
88. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 novembre 2014, 15:41, par Robert Paris
Ce qui se passait en Belgique à la veille de la première guerre mondiale : voir ici
89. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 novembre 2014, 16:02, par R.P.
1913 en Belgique : lire aussi ici
90. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 2 décembre 2014, 19:36, par Robert
« On écrivait jadis qu’il est doux et bienséant de mourir pour son pays. Mais dans la guerre moderne, votre mort n’a rien de doux et de bienséant. Vous mourrez comme un chien sans raison valable… La seule manière de combattre le meurtre qu’est la guerre est de montrer les combinaisons malpropres qui la créent et les criminels et les salauds qui l’espèrent… »
Ernest Hemingway
91. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 décembre 2014, 12:31
« Mourir pour la patrie ! C’est mourir pour Renault ! »
Jacques Prévert
92. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 7 décembre 2014, 19:05
Jacques Prévert :
Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu’es-tu devenue maintenant
Sous cette pluie de fer
De feu d’acier de sang
Et celui qui te serrait dans ses bras
Amoureusement
Est-il mort disparu ou bien encore vivant
Oh Barbara
Le crépuscule est lâché sur le ciel des hommes,
Que n’arrêtera jamais le plus beau des psaumes.
Sous l’azur éteint, les cris et la déraison,
L’oiseau aveuglé cherche la belle saison,
Le creux d’un olivier et sa tunique verte,
Près d’une femme obstinée, ses paumes ouvertes.
Mais les ombres crucifient le rêve et l’envie,
Dans les sillons naufragés, du sang est servi.
Quand tiennent le haut du pavé les gens de guerre,
Nous, peuples soumis, nous leur offrons notre terre.
Pendant la fameuse glorieuse dernière avant-dernière grande guerre
Le président Poincaré rigolait dans les cimetières
Oh ! Pas aux éclats naturellement
Un petit rire discret
Un petit gloussement
Un rire d’homme du monde
Un joyeux rire d’outre-tombe
La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père qu’est-ce qu’il fait le père ?
Il fait des affaires [...]
Et le fils et le fils
Il ne trouve absolument rien le fils [...]
Le père continue il fait des affaires
Le fils est tué il ne continue plus
Le père et la mère vont au cimetière
Ils trouvent ça tout naturel le père et la mère
La vie continue la vie avec le tricot la guerre les affaires
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetière.
93. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 8 décembre 2014, 19:43, par alain
Et au Japon ?
94. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 8 décembre 2014, 19:54, par Robert Paris
En 1897, ‘La Société pour la préparation de la création de syndicats’ (Rodo kumiai kiseikai) fut créée, revendiquant 5700 membres. Pour la première fois dans l’histoire du mouvement ouvrier au Japon, elle avait son propre journal : Rodo sekai, diffusé tous les deux mois et édité par S. Katayama. Le but de ce mouvement était de créer des syndicats et des coopératives. Deux ans plus tard, cette association syndicale comptait déjà 42 sections et 54 000 membres. Les statuts et les positions de ces syndicats étaient basés sur les modèles européens. Le syndicat des conducteurs de trains développa une campagne pour l’introduction du droit de vote généralisé et déclara en mars 1901 que “le socialisme est la seule réponse définitive à la condition ouvrière”.
Le 18 octobre 1898, un petit groupe d’intellectuels se rencontra dans une Église Unitariste de Tokyo et fonda Shakaishugi Kenkyukai (l’Association pour l’Étude du Socialisme). Ils commencèrent à se réunir une fois par mois. Cinq de ses six fondateurs se considéraient toujours eux-mêmes comme des Socialistes Chrétiens.
La première phase du mouvement ouvrier ‘de destruction des machines’ (qui correspond d’une certaine manière au "Luddism" du mouvement ouvrier anglais à la charnière du 18e et du 19e siècle) ne fut dépassée qu’à la fin des années 1880, ouvrant ainsi la voie à une vague de grèves qui eurent lieu entre 1897 et 1899. En particulier, les ouvriers métallurgistes, les mécaniciens et les cheminots montrèrent leur combativité.
Dans les années 1900, un syndicat inspiré par le Manifeste du parti communiste, et donc révolutionnaire et sans lien avec les syndicats officiels, est constitué à la mine d’Ashio sous le nom d’Association fraternelle des mineurs du Japon. La fin de la guerre russo-japonaise entraîne une dégradation de la condition ouvrière et une vague de grèves. Ne pouvant obtenir les améliorations qu’il voulait par la négociation, le syndicat lance une grève pour le relèvement des salaires et contre les conditions d’exploitation des ouvriers. Elle dure du 4 au 7 février 1907. Le propriétaire de la mine, soutenu par le ministre de l’Intérieur Hara Takashi qui y possède des intérêts, fait appel à l’armée. Les ouvriers rouent de coups un des directeurs, s’emparent d’armes et de dynamite qu’ils utilisent pour faire sauter certaines installations. Les combats durent plusieurs jours et font plusieurs morts, dont le directeur de la mine.
Cette grève est emblématique pour le mouvement ouvrier au Japon, et par la suite, la mine reste un haut lieu des luttes sociales.
Les 5 et 6 avril 1903, à la Conférence Socialiste du Japon à Osaka, les participants réclamèrent la transformation socialiste de la société. Tandis que les exigences de ‘liberté, d’égalité et de fraternité’ étaient toujours présentes, la revendication de l’abolition des classes et de toutes les oppressions de même que l’interdiction des guerres d’agression apparurent également. Fin 1903, la Commoners Society (Heiminsha) devint le centre du mouvement anti-guerre, alors que le Japon poursuivait son expansion en Manchourie et en Corée et qu’il était sur le point d’entrer en guerre contre la Russie. Le journal de cette association était publié à 5 000 exemplaires. Là encore, c’était un journal sans structure organisationnelle forte derrière. D. Kotoku était l’un des orateurs les plus connus de ce groupe.
De la même façon qu’en Russie en 1905, l’aggravation dramatique des conditions de vie des ouvriers au Japon mena à l’éclatement de manifestations violentes en 1905 et à une série de grèves dans les chantiers navals et les mines en 1906 et 1907. La bourgeoisie n’hésita jamais un seul instant à envoyer la troupe contre les ouvriers et une fois de plus déclara toute organisation ouvrière illégale.
Après 1906, un courant anarcho-syndicaliste se développa, mais ses membres collaboraient périodiquement avec le mouvement socialiste, davantage enclin au réformisme. En 1910, le plus connu des anarchistes, Kotoku Shusui, et 26 autres anarchistes furent arrêtés et accusés de comploter l’assassinat de l’empereur et de sa famille. En 1911, à l’issue de ce qu’on appela le « procès de la grande trahison », Kotoku fut exécuté ainsi qu’onze autres personnes, dont sa compagne Kanno Suga. Après cela, la gauche organisée cessa pratiquement d’exister.
Après un renouveau de grèves en 1907, il y eut un autre recul de la lutte de classe entre 1909 et 1910. Pendant ce temps, la police faisait la chasse aux révolutionnaires. Le simple fait d’être muni de drapeaux rouges était déjà considéré comme un délit. En 1910, Kotoku fut arrêté. Beaucoup de socialistes de gauche le furentégalement. En janvier 1911, Kotoku et onze autres socialistes furent condamnés à mort, sous le prétexte d’avoir voulu assassiner l’empereur. La presse socialiste fut interdite de même que les meetings, et les livres socialistes qu’on put trouver dans les librairies et bibliothèques furent brûlés. Confrontés à cette répression, beaucoup de révolutionnaires s’exilèrent ou se retirèrent de toute activité politique.
Entre 1914 et 1921, la production d’acier japonais a doublé ; en valeur, la production de moteurs électriques est passée de 9 à 34 millions de yens. En tout, la production industrielle a été presque multipliée par cinq !
Il en a résulté un changement parallèle dans le poids social et la nature de la classe ouvrière japonaise. La proportion de la main-d’oeuvre industrielle employée dans l’industrie lourde, caractérisée par de grandes usines, est passée de 13,6 % en 1910 à 24,2 % à la fin de la guerre. Au début des années 1920, il existait au Japon un important prolétariat industriel installé dans les villes, majoritairement masculin, travaillant dans les aciéries, les chantiers navals, l’industrie chimique, les usines d’automobiles et de camions, etc. Et pourtant, le Japon est le seul grand pays capitaliste industriel de l’entre-deux-guerres où les luttes paysannes contre les propriétaires fonciers ont été une arène importante de conflits sociaux.
Les changements dans la composition de la main-d’oeuvre, combinés avec l’inflation qui accompagna l’expansion industrielle de la Première Guerre mondiale, provoquèrent une flambée de combativité ouvrière et d’agitation sociale qui atteignit son point culminant dans les « émeutes du riz » en 1918. Entre 1917 et 1918, le prix du riz avait doublé ; en août 1918, des femmes de pêcheurs de la préfecture de Toyama prirent d’assaut des boutiques de riz, à la suite de quoi les émeutes du riz gagnèrent l’ensemble du pays. Le gouvernement fit appel à la troupe pour réprimer les émeutes, tuant plus d’une centaine de manifestants. L’agitation déboucha sur un mouvement de masse pour le suffrage universel. Le cens fut abaissé en 1919 (faisant passer le nombre d’électeurs d’un à trois millions), mais le gouvernement refusa d’accorder le suffrage universel. Grèves et agitation ouvrière se répandirent aussi, et les socialistes japonais commencèrent à gagner de l’influence dans certains grands syndicats.
Entre 1917 et 1918, le prix du riz doubla. Durant l’été 1918, les ouvriers commencèrent à manifester contre cette augmentation. Nous n’avons pas d’informations sur des grèves dans les usines ni sur l’extension de revendications à d’autres domaines. Apparemment des milliers d’ouvriers descendirent dans la rue. Cependant, ces manifestations ne débouchèrent pas sur une forme organisée plus marquée, ni sur aucune revendication ou objectif spécifiques. Des magasins semblent avoir été pillés. En particulier, les ouvriers agricoles et la main d’œuvre récemment prolétarisée, de même que les Burakumin (les exclus sociaux) semblent avoir joué un rôle très actif dans ces pillages. Beaucoup des maisons et d’entreprises furent mises à sac. Il semble n’y avoir eu aucune unification entre des revendications économiques et des revendications politiques. Contrairement au développement des luttes en Europe, il n’y eut aucune assemblée générale ni aucun conseil ouvrier. Après la répression du mouvement, quelques 8 000 ouvriers furent arrêtés. Plus de 100 personnes furent tuées. Le gouvernement démissionna pour des raisons tactiques. La classe ouvrière s’était soulevée spontanément mais, en même temps, le manque de maturation politique en son sein était d’une évidence dramatique.
En avril 1918, le Japon fut le premier pays impérialiste à envahir le territoire du premier Etat ouvrier du monde. En novembre 1922, ses troupes furent les dernières à en partir, et après cela le Japon garda le contrôle de l’île de Sakhaline, n’acceptant d’évacuer ses troupes du nord de l’île qu’en 1925, au moment où des relations diplomatiques avec la Russie soviétique furent enfin établies. Le Japon continua à occuper le sud de Sakhaline jusqu’à ce que ses troupes en soient chassées par l’Armée rouge à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
95. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 11 décembre 2014, 01:01, par marie-paule
Bonsoir ,
Y aurait il quelques personnes qui sauraient me donner des renseignements sur les personnes (femmes) qui furent fusillée en 1913 et enterrée en fosse commune ? Mon arrière grand-mère Elisabeth Colbacq à été prise par les allemands à Binche en Belgique et fut emmenée jusqu’à Amiens ou elle à dut travailler jusqu’à ce qu’elle ne sache plus le faire et fut fusillée ensuite enterrée en fosse commune , jamais son époux Goreux Henry , ni ses enfants , n’ont reçu de certificat de décés , pourtant ma grand-mère avait la certitude qu’elle à fini de cette façon cruelle et dramatique .
Depuis mon enfance j’ai toujours désiré avoir un document concernant la mort de mon arrière grand-mère ainsi que des photos si celà était possible ...
Si quelqu’un lit ce message et aurait des document officiel , des photos ou des renseignements concernant mon arrière grand -mère ou les faits de cette époque , je serais très heureuse de pouvoir la lire .
De tous coeur merci à l’avance à qui pourras me donner des renseignements .
Je suis sur facebook .
Marie-Paule Meurant, Belgique .
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 11 décembre 2014, 07:54, par Robert
Est-ce que ce n’est pas plutôt en 1914 ?
2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 décembre 2014, 22:42, par meurant
Du peu que j’en sais , mon arrière grand mère était cordonnier Binche en Belgique elle est partie chercher le pain , n’est plus revenue , elle aurait était faite prisonnière et du aller à pieds jusque Amiens en France ou on l’a fait travailler jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus puis fut fusillée , nous n’avons jamais obtenu de certificat de décés et plus jamais de nouvelles , elle était veuve en première noces de Louis Chirez et avait deux filles et un garçon de son premier mariage , puis avec mon arrière grand père Goreux Henry une fille Gabrielle .
Si une personne pouvait voir éventuellement sur les monuments aux mort si son nom serait inscrit (par hasard )quoi qu’il parait qu’elle à était enterrée en fosse commune .
Merci pour l’intêret que vous portez à l’attention des chers disparus .
ps : Elle devait avoir des descendants de son premier mariage à Paris
3. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 6 avril 2023, 12:56
Lire ici :
https://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/gravis-alphonse#.ZC6ksNfP3cs
https://bibliotheques.wallonie.be/index.php?lvl=etagere_see&id=39&page=2&nbr_lignes=93
https://www.wawmagazine.be/fr/le-bapteme-du-feu-des-britanniques
https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t=11077
96. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 11 décembre 2014, 08:01
Les atrocités allemandes sont les exactions exercées par l’armée impériale allemande au début de la Première Guerre mondiale en Belgique tant en Flandre qu’en Wallonie et en France dans les départements de la Meuse, des Ardennes et de Meurthe-et-Moselle.
Les exactions commises par l’armée impériale allemande en août et septembre 1914 au début de la Première Guerre mondiale firent, en trois semaines, des milliers de victimes parmi les civils, suspectés d’être des francs-tireurs, amenés devant divers murs et fusillés par des pelotons d’exécution accomplissant de cette manière une justice expéditive au nom des lois de la guerre. 20 000 maisons furent également détruites, notamment 600 à Visé et 1 100 à Dinant en Wallonie, la région belge placée dans l’axe principal de l’invasion et qui subit le plus ces « atrocités ».
Du 5 au 26 août 1914, l’armée impériale allemande passa par les armes plus de 5 000 civils dans une centaine de communes de Wallonie et y détruisit plus de 15 000 maisons, dont 600 à Visé et 1 100 à Dinant, soit 70 % des exactions commises au début de l’invasion en France et en Belgique.
La liste qui suit n’est pas exhaustive car on n’y retient que les localités qui eurent à subir 10 morts au moins.
Le 5 août, Berneau et Soumagne (118 victimes civiles) ;
le 6 août, Battice (33 victimes civiles), Blegny, Esneux, Sprimont, Magnée, Olne, Hermée, Rétinne et Romsée ;
le 7 août, Warsage, Herstal, Lixhe et Louveigné ;
le 8 août, Baelen, Francorchamps, Herve et Mélen ;
le 10 août, Linsmeau ;
le 14 août, Barchon ;
le 15 août, Wandre ;
le 16 août, Visé ;
le 18 août, Haccourt et Heure-le-Romain ;
le 20 août, Liège, Érezée, Andenne (218 victimes civiles), Franc-Waret et Somme-Leuze,
le 21 août, Arsimont et Auvelais ;
le 22 août, Anloy, Mussy-la-ville, Neufchâteau, Tintigny (120 victimes civiles), Tamines (383 victimes civiles), Bouffioulx, Couillet, Farciennes, Monceau-sur-Sambre (63 victimes civiles), Montignies-sur-Sambre (35 victimes civiles) et Charleroi ;Dampremy (11 victimes civiles)
le 23 août, Ethe (218 victimes civiles), Bièvre (17 victimes civiles), Bouge, Dinant (voir aussi les Rivages (Dinant)) et Neffe (674 victimes civiles), Hastière-par-delà (19 victimes civiles), Spontin, Waulsort, Flénu, Jemappes, Nimy, Quaregnon, Ville-Pommerœul Saint-Léger et Virton ;
le 24 août, Bertrix, Houdemont, Izel, Offagne, Hermeton-sur-Meuse, Namur et Latour (71 victimes civiles) ;
le 25 août, Anthée (13 victimes civiles), Romedenne et Surice ;
le 26 août, Arlon, Dourbes (3 victimes civiles) et Frasnes-lez-Couvin (12 victimes civiles), dernière localité wallonne touchée.
Le 6 août, Mouland (village de la province de Liège au moment des faits) ;
le 9 août, Saint-Trond
le 18 août, Tongres
le 19 août, Aerschot et Attenrode…
le 25 août, Zemst plus de 10
Le 4 août 1914 au matin, la cavalerie allemande, fer de lance de l’invasion, pénètre sur le territoire belge. Le plan de campagne des Allemands, établi en 1905 par le général von Schlieffen (Plan Schlieffen) — et modifié par son successeur von Moltke — prévoit la traversée de la Belgique pour attaquer la France par le nord. Cette traversée doit être rapide. Pour cela, il faut écraser l’armée belge, et surtout les francs-tireurs comme ceux qu’ils ont affrontés en France en 18703.
La neutralité de la Belgique, consacrée dès 1831 dans le protocole de la Conférence de Londres (Traité des XVIII articles), est donc bafouée par l’intrusion de troupes allemandes sur le sol national ; l’état de guerre est déclaré. Le Roi Albert prend le commandement de l’armée comme le prévoit la constitution. La Belgique entre en guerre pour la première fois de son histoire.
Les Ire et IIe armées allemandes foncent, dès le 3 août, sur la ville de Liège dont elles doivent s’emparer. C’est chose faite le 8 août, date à laquelle la ville tombe officiellement entre les mains des Allemands. L’armée belge oppose cependant une résistance supérieure à ce que les stratèges allemands ont prévu. La résistance des forts, nombreux autour de Liège, freine l’avancée allemande, leur prise entraînant la mort d’environ 5 000 soldats allemands. La ville de Liège tombée, seul barrage important sur la route de l’invasion, la Ire armée allemande peut se diriger vers Bruxelles, tandis que le général von Bülow, à la tête de la IIe armée, poursuit sa route vers la Basse-Sambre, en direction de Namur et Charleroi.
Il arrive le 12 août à Huy dont une brigade belge s’est repliée sur Andenne après avoir fait sauter les passages sur la Meuse. Le 20 août, sur ordre du général von Bülow, une colonne allemande fusille à Andenne plus de deux cents civils. La IIe armée allemande poursuit son chemin dans la vallée de la Meuse, atteint la Sambre à Namur et arrive à proximité de Tamines, entre Namur et Charleroi, le 20 août. Face à elle, la 19e division d’infanterie du Xe corps d’armée français ; ces troupes françaises sont secondées par un détachement peu important de gardes civiques belges, soit 19 artilleurs de Charleroi commandés par le capitaine Gillieaux.
Le vendredi 21 août 1914, vers 6h du matin, une patrouille composée de cinq uhlans allemands descend la route de Ligny, venant de Velaine-sur-Sambre. Il atteignent à peine l’hôtel de ville qu’une trentaine de soldats français et quelques artilleurs de la garde civique de Charleroi ouvrent le feu et blessent un des cavaliers. Les quatre autres foncent chercher du renfort en direction du bois de Velaine. Le soldat blessé est fait prisonnier par la garde civique et soigné par le docteur Scohy.
Une heure plus tard, environ trente uhlans accompagnés de cyclistes se présentent à l’entrée du village, par la route de Ligny. Ils essuient, au même endroit, les coups de feu des soldats postés près de l’hôtel de ville. Mais entre-temps, des détachements entiers d’Allemands ont investi le quartier de la Praile, situé à l’entrée du village. Les soldats établissent, chez M. Mouffe, conseiller communal, un poste de la Croix-Rouge et y rassemblent une cinquantaine de civils, en majorité des hommes, qu’ils ont arrêtés sur leur chemin. La tension est déjà vive puisque des soldats menacent de fusiller les prisonniers, qu’ils accusent d’avoir tiré sur leurs compagnons d’armes. Vers 8 heures, un officier ordonne à cinq prisonniers d’aller ramasser le cycliste blessé une heure avant. Ces civils servent de bouclier au groupe de soldats qui, tout le long du chemin, tirent sporadiquement sur les maisons et dans la rue. Sur le chemin du retour, alors que le blessé est transporté par les civils, les soldats français visent l’escorte allemande qui immédiatement riposte. C’est alors que, lors du retour vers le poste de la Croix-Rouge, des soldats allemands tuent, sans raison, à l’intersection du Baty Sainte-Barbe et de la rue de Velaine, une fillette de huit ans, Céline Huybrecht, et blessent un homme et une jeune fille. Ces mêmes hommes incendient et saccagent également quelques maisons du quartier de la Praile.
De retour à la Croix-Rouge, où les Allemands détiennent toujours cinquante civils, le commandant allemand ordonne à une femme d’aller chercher le bourgmestre de Tamines ainsi qu’un médecin. Or M. Guiot, le bourgmestre faisant fonction, a quitté son domicile le matin, pour aller prévenir les Français, de l’autre côté de la Sambre (rive droite) de l’avance des Allemands. Elle se rend alors au domicile d’Émile Duculot, conseiller communal au moment des faits, afin de le mettre au courant des événements. Ce dernier raconte :
« Entre-temps, car il y avait urgence, j’entre chez Lalieu, médecin libéral et en même temps échevin et le mets au courant de la situation. Lalieu répond qu’il est trop vieux et demande qu’on aille chez le docteur Scohy. Celui-ci refuse également, c’est alors que le docteur Defossé et M. Férange, chef de la Croix-Rouge locale, accompagnés de cinq brancardiers arrivent à la rencontre d’Emile Duculot. Une fois les nouveaux venus mis au fait, ils se rendent chez Mouffe où l’officier allemand les attend au milieu du chemin. Le docteur Defossé entre immédiatement soigner le blessé tandis que M. Duculot est rappelé par l’officier. Monsieur Duculot lui expose alors la fuite du bourgmestre faisant fonction et se propose de le remplacer officieusement pour le moment.
Après avoir accepté, l’officier lui dit : - On a tiré sur nous !(…) J’ai déjà trois revolvers !
Émile Duculot répond : - Monsieur, ce n’est pas possible ! On ne peut absolument pas avoir tiré ici ! La preuve en est qu’on a soigneusement repris toutes les armes ; il est strictement interdit de tirer. Personne n’y a d’ailleurs songé »
L’officier change alors de sujet de conversation et demande au témoin jusqu’où ses hommes et lui peuvent avancer, sans danger, dans le village. Émile Duculot dit à son interlocuteur qu’il lui est impossible de répondre à cette question. L’officier lui intime alors l’ordre de se rendre avec d’autres civils, placés en tête des troupes, jusqu’à l’église des Alloux, afin d’y ôter le drapeau national fixé au clocher. Il accompagne son ordre de la menace de détruire le clocher au canon puis relâche tous les otages. Émile Duculot, avant de regagner son domicile, signale aux troupes françaises l’importance et la position des troupes allemandes.
97. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 11 décembre 2014, 08:04
Dès leur arrivée dans le quartier de la Praile, au nord de Tamines, les soldats allemands incendient plusieurs maisons puis, au fur et à mesure de leur progression, allument d’autres foyers ici et là.
Durant la nuit du vendredi 21 août au samedi 22 août, a lieu la fusillade au café tenu par Monsieur Hennion, situé sur la place Saint Martin. En effet, les soldats ont investi le café vers 17 heures, y réquisitionnant tous les combustibles possibles pour incendier les maisons voisines. Tandis que Monsieur Hennion accompagné de soldats se rend vers 21 heures au domicile du bourgmestre en fuite, d’autres soldats retiennent 20 personnes en otages : cinq femmes, cinq enfants et dix hommes. Alors que le combat n’a pas encore repris, les soldats ordonnent aux dix hommes de sortir du bâtiment et en abattent neuf qui viennent à peine de franchir le seuil de la porte ; ils incendient ensuite le café. Quant à Monsieur Hennion, nul ne connaît précisément les circonstances de sa mort : son corps est retrouvé sans vie dans le cimetière, les poignets liés.
Par ailleurs, 12 personnes réfugiées dans la cave du magasin « Bazar Mombeek », rue de la Station, y sont retenues prisonnières par des soldats alors que l’immeuble brûle. Cinq d’entre elles sont asphyxiées, les autres sont sauvées grâce à l’intervention d’un soldat allemand. D’autres scènes du même genre se déroulent dans le centre de Tamines. Les soldats arrêtent systématiquement les habitants qui leur tombent sous la main et les concentrent en divers endroits.
Les habitants du quartier du Cailloux, à l’Ouest de Tamines, sont parmi les plus chanceux. Un groupe d’environ cinq cents civils, arrêtés dans ce quartier, est escorté par des soldats et conduit en dehors de Tamines. Un témoin rapportera :
« Comme les 500 personnes qui fermaient le groupe, nous partions nous ne savions où, guidés par des soldats qui faisaient le coup de feu sur les personnes qui voulaient s’écarter de la route désignée. Et cependant ils nous conduisaient « hors de danger ».(…) Ce fut seulement à Baulet que les soldats nous abandonnèrent pour se joindre à des troupes en marche. »
Tandis que la bataille continue de l’autre côté du pont de la Sambre entre les troupes françaises et allemandes, la plupart des Taminois se terrent dans les caves ou tout ce qui peut servir de refuge pour échapper aux obus. La matinée, les soldats arrêtent systématiquement tous les habitants pour constituer deux groupes de prisonniers composés chacun d’hommes, de femmes et d’enfants. Une partie des habitants, formant le premier groupe, arrêtés par les soldats, est conduite, après avoir été dévalisée, dans un champ de betteraves situé en bordure de Tamines vers Velaine. Ce groupe de civil est placé au centre des troupes et se voit contraint de se coucher dans le champ, à une centaine de mètres de leurs canons.
Des soldats imitent un peloton d’exécution et font semblant de les fusiller. Les deux prêtres présents dans le groupe, l’abbé Donnet et l’abbé Hottlet récitent à haute voix l’acte de contrition. Ils restent au même endroit pendant environ une demi-heure, puis sont emmenés un peu plus loin. Le groupe grossit sans cesse à cause des nouveaux prisonniers.
Aux alentours de 17 heures, sur ordre des Allemands, ces centaines de civils pour la plupart traumatisés, descendent, escortés de soldats, vers l’église Notre-Dame des Alloux. Il y a du monde sur tous les autels, plein les confessionnaux, les gens se demandent s’ils seront fusillés ou s’ils seront brûlés dans l’église.
Pendant ce temps-là, les Allemands constituent à un autre endroit un second groupe de prisonniers, gardés à l’école des Frères abritant un local de la Croix-Rouge. Un témoin s’y rend vers 10 heures en compagnie de son frère et y trouve hommes, femmes, enfants et vieillards, soit environ cent cinquante personnes. Remarquons qu’à ce moment précis, les soldats ne les retiennent pas encore, l’école n’ayant pas encore été investie par la troupe. Au cours de la journée, la masse de personnes ne cessera d’augmenter. Parmi tous ces gens, apparaît le nouveau bourgmestre de Tamines, Émile Duculot, ainsi que l’abbé Smal et le curé de Brye, cachés jusqu’alors dans le presbytère.
Vers 16 heures, les premiers soldats investissent les bâtiments scolaires où se sont réfugiés tous ces habitants. Ces soldats, sous les ordres d’un médecin, accompagnent l’ambulance allemande qui s’y installe avec les blessés du combat. À peine arrivés, les Allemands ordonnent la séparation des hommes et des femmes, enfants et vieillards. Ces derniers sont enfermés dans les caves de l’établissement. Les hommes cantonnés dans le réfectoire vont également passer la nuit à cet endroit.
Après avoir déplacé une partie des femmes et des enfants dans un bâtiment voisin, et avoir distribué un peu de nourriture, un chef allemand se présente à l’entrée de l’édifice. Il est environ 19 heures, cet officier interpelle l’abbé Hottlet, second prêtre de la paroisse, relativement âgé. L’officier s’énerve alors contre le vieil homme – qui ne comprend pas les injonctions qui lui sont adressées en allemand – et annonce, selon un autre témoin comprenant l’allemand, qu’ils vont être fusillés. Très peu de temps après, on donne le mot d’ordre : "tous les hommes doivent sortir !"
Ils sont, aux dires des divers témoins, plus ou moins 600 hommes poussés hors de l’église par les soldats allemands. Selon les témoins présents, la scène se passe peu après 19 heures. Afin de mieux plonger dans l’ambiance, il faut imaginer qu’à ce moment précis la moitié des maisons de Tamines sont en flammes et que des débris incandescents jonchent rues et trottoirs. Ces 600 sont donc debout, au milieu des incendies, dans l’ignorance totale de ce qui va leur arriver.
Les soldats donnent l’ordre aux hommes de se mettre en rangs par quatre et distribuent des coups aux retardataires. Le cortège, encadré de tous côtés par des soldats à pieds ou à cheval, commence à descendre la rue de Velaine en direction de la place Saint Martin. Avant d’arriver sur la place, des soldats voyant des jeunes garçons mêlés au cortège leur donnent l’ordre d’en sortir et de retourner à l’église. Les trois prêtres du groupe reçoivent de nombreux coups de crosse et sont injuriés par les soldats formant l’escorte ou par les artilleurs et les cavaliers cantonnés le long du chemin.
Les premiers hommes arrivent sur la place Saint-Martin occupée par les troupes allemandes. Ces hommes venant tous de l’église des Alloux reçoivent l’ordre d’aller se ranger au fond de la place, le long de la Sambre. Les soldats divisent le groupe en deux parties séparées l’une de l’autre par quelques mètres et somment les hommes de s’aligner correctement.
Il s’agit apparemment d’un très long peloton d’exécution avec cinq étages de fusils superposés. Le premier rang de soldats est fortement accroupi et les fusils rasent le sol. Soudain, un officier allemand quitte les rangs et s’avance vers les civils. Il les accuse d’avoir tiré sur les soldats et ajoute qu’en conséquence ils seront fusillés. Il somme certains Taminois de crier « Vive l’Allemagne ! » et « Vive l’empereur ! », ordre auquel certains hommes obtempèrent, poussés par le désespoir et la peur.
Vers 8 heures du soir un coup de sifflet retentit, signal de la première fusillade. Le peloton fait feu sur la masse compacte formée par les hommes. À peine le coup de sifflet est-il émis que tous se jettent par terre. La première fusillade semble en effet, n’avoir fait que très peu de victimes. Les Allemands crient alors aux hommes de se relever immédiatement. Personne ne bouge. Un groupe de soldats s’avance alors vers les hommes couchés à terre qui, effrayés, se relèvent rapidement.
À peine sont-ils debout qu’une seconde salve, plus violente que la première, retentit sur la place. Les soldats sont, aux dires de témoins, secondés par une mitrailleuse placée à l’entrée du pont, fauchant une des extrémités du groupe. À ce moment de la fusillade, de nombreuses personnes sont déjà mortellement blessées, d’autres tombées sur le sol sont recouvertes de cadavres. Les soldats tirent de manière irrégulière sur les hommes encore debout.
De longues minutes s’écoulent durant lesquelles certains, indemnes ou presque, sautent dans la Sambre, puis le peloton se disloque pour laisser place à un groupe de soldats, portant des brassards de la Croix-Rouge, venant de l’église. Accompagnés de soldats, ils se dirigent vers le tas de cadavres et de blessés, munis de leurs fusils avec baïonnette, de gourdins, de haches ou autres armes de fortune. Ils viennent achever les blessés disséminés sur tout le tas. De nombreux blessés, apercevant leur brassard appellent à l’aide. Parmi les premières victimes, le pharmacien Jules Delsauvenière grièvement blessé est d’abord traité de franc-tireur avant d’être blessé à mort.
De nombreuses personnes, indemnes ou blessées par la fusillade vont alors mourir dans d’atroces conditions. L’abbé Donnet témoigne :
« Il y eut dans l’opération, deux parties bien distinctes. Ils se mirent tout d’abord à tuer à tort et à travers, dans le tas. Ils longeaient le monceau, l’escaladaient, passaient sur les morts, sur les blessés, sur les mourants, et s’acharnaient sur tout ce qui paraissait âme vivante. Pour leur terrible besogne, les ambulanciers et les soldats se servaient de toutes sortes d’instruments, d’abord et surtout de la baïonnette : ils l’enfonçaient partout, dans le monceau de chair humaine ; certains ont été transpercés qui étaient en dessous de plusieurs cadavres… Ils frappaient aussi de la crosse des fusils ; certains avaient de grosses bûches de bois, des barres de fer : j’en ai revu et retrouvé le lendemain à côté du carnage, toutes couvertes de chair, de cervelle et de sang. Enfin, j’ai entendu aussi donner sur les blessés des coups de cravache… Nous arrivons ici, si je puis dire au clou de la cruauté. Les soldats opéraient à deux ; ils saisissaient les victimes une par une, examinaient si elles étaient en vie, puis les achevaient à coups violents et répétés de baïonnettes… Après, …, ils les jetaient dans la Sambre. »
98. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 11 décembre 2014, 08:07
1914. Les Atrocités allemandes, sous-titré La Vérité sur les crimes de guerre en France et en Belgique est un livre paru en Irlande en 2001 sous le titre German Atrocities, puis en France en 2005 et en 2011. L’édition de 2011 est parue chez Tallandier, collection Texto. Il a été rédigé par John Horne et Alan Kramer, professeurs d’histoire contemporaine au Trinity college de Dublin. Il a été traduit de l’anglais par Hervé-Marie Benoît.
99. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 11 décembre 2014, 08:18, par Robert Paris
Vous pouvez également lire cet article où la ville de Binche est citée à la page 138 pour des massacres de civils notamment.
100. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 11 décembre 2014, 11:38
Tout cela souligne combien on nous parle beaucoup des victimes militaires des guerres et pas de leurs victimes civiles !!!
101. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 décembre 2014, 18:58, par Robert Paris
On peut également lire cet ouvrage
102. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 décembre 2014, 19:03
Les Saxons de la 111e Armée allemande de von Hausen, furieux de la résistance rencontrée, accusèrent la population civile d’avoir prêté son aide aux armées anglaise et française, et se livrèrent à d’effroyables massacres.
103. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 décembre 2014, 19:10, par Robert Paris
Je vous indique par une carte (située à la fin de ce texte) quels régiments sont passés par Binge.
104. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 décembre 2014, 21:41
Léon Trotsky dans "La guerre et l’Internationale" du 31 octobre 1914 :
Le soulèvement des forces productrices contre leur exploitation sous une forme national-gouvernementale est à la base de chaque guerre.... La guerre de 1914 est la plus grande convulsion économique d’un système qui meurt de ses propres contradictions... Ceux qui s’imaginent que la guerre contre le Japon a motivé la Révolution, ne connaissent pas les faits, les liens existant entre eux et ne les comprennent pas. La guerre a fait s’accélérer la Révolution. Mais elle l’a affaiblie à l’intérieur. Si la Révolution s’était produite à partir de l’accroissement organique de forces intérieures, elle aurait éclaté plus tard, mais elle aurait été plus forte et se serait déroulée suivant un plan. Par conséquent, la Révolution n’avait nullement à gagner la guerre, bien au contraire... De 1912 à 1914 la Russie a connu un grand développement industriel. L’accroissement proportionnel du mouvement révolutionnaire consécutif à celui des masses laborieuses amena le pays à un état de soulèvement et de répression... La guerre, à condition d’une défaite catastrophique de la Russie, peut accélérer l’avènement de la Révolution, mais un affaiblissement intérieur de la première est indispensable. En admettant même que la Révolution prenne le dessus, il se pourrait que les armées des Hohenzollern se retournassent contre elle. Cette perspective ne peut pas ne pas paralyser les forces révolutionnaires en Russie qui savent bien que, derrière les baïonnettes allemandes, marche le prolétariat allemand... De cette façon, l’actuelle mêlée des peuples sous le joug militariste produit de si monstrueuses contradictions que la guerre et les gouvernements ne peuvent les expliquer... La question du rôle historique de la guerre a pour nous, marxistes, une signification fondamentale : est-elle capable de faire progresser, de faire reculer, de freiner le développement des forces productrices, des formes gouvernementales, d’accélérer la concentration des forces du prolétariat. Cette évaluation matérialiste de la guerre n’a aucune relation avec les notions de « défensive » ou d’« offensive ».
105. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 janvier 2015, 22:01, par Robert Paris
Un roman à lire sur la première guerre mondiale en Kabylie : Mouloud Mammeri, « La colline oubliée »…
106. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 21 janvier 2015, 14:54, par Robert Paris
Jack London dans "Le talon de fer" :
« ...Je dois raconter les troubles de l’hiver de 1912….
Cette menace belliqueuse était suspendue comme un sombre nuage, et toute la
scène était disposée pour une catastrophe mondiale ;
car le monde entier était le théâtre de crises, de troubles travaillistes, de
rivalités d’intérêts ; partout périssaient les classes moyennes,
partout défilaient des armées de chômeurs,
partout grondaient des rumeurs de révolution sociale.
L’oligarchie voulait la guerre avec l’Allemagne pour une douzaine de raisons.
Elle avait beaucoup à gagner à la jonglerie d’événements que susciterait
une mêlée pareille, au rebattage des cartes internationales et à la
conclusion de nouveaux traités et alliances.
En outre, la période d’hostilités devait consommer une masse d’excédents
nationaux, réduire les armées de chômeurs qui menaçaient tous les pays,
et donner à l’oligarchie le temps de respirer, de mûrir ses plans et de les
réaliser. »
107. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 6 février 2015, 12:19, par Robert Paris
La première guerre mondiale servit aussi à écraser le mouvement ouvrier révolutionnaire des USA !
En 1912, l’organisation IWW, syndicaliste révolutionnaire prônant la lutte des classes, comptait quelque 50 000 adhérents, principalement concentrés dans le Nord-Ouest, parmi les dockers, les ouvriers agricoles dans les États du Centre, et les régions d’industries textile et minière. Les IWW furent impliqués dans plus de 150 grèves, dont la grève du textile de Lawrence (1912), la grève de la soie de Paterson (1913) et the Mesabi range (1916). Ils furent aussi engagés dans ce qui est connu comme l’Émeute de Wheatland Hop, le 3 août 1913.
Entre 1915 et 1917, l’Organisation des ouvriers agricoles (AWO) de l’IWW regroupa des centaines de milliers d’ouvriers agricoles saisonniers dans tout le Midwest et l’Ouest des États-Unis, les inscrivant et les syndiquant souvent dans les champs, les chemins de fer et les jungles hobo. Durant cette période, les IWW furent pratiquement confondus avec les hobos. Les travailleurs itinérants ne pouvant guère s’offrir d’autres moyens de transport pour rejoindre leur prochain lieu de travail, les wagons de marchandises couverts, appelés par les hobos « side door coaches » (voitures à porte latérale) étaient fréquemment recouverts d’affiches de l’IWW. La carte de membre de l’IWW était considérée comme suffisante pour voyager par le train. Les travailleurs obtinrent souvent de meilleures conditions de travail en utilisant l’action directe sur le lieu de production, et faisant grève "sur le tas", ralentissant consciemment et collectivement leur travail. Les conditions de travail des ouvriers agricoles saisonniers connurent une énorme amélioration grâce au syndicalisme Wobbly.
Tirant parti du succès de l’AWO, le Syndicat des Travailleurs Forestiers Industriels de l’IWW (Lumber Workers Industrial Union) (LWIU) utilisa des procédés similaires pour organiser les bûcherons et autres travailleurs forestiers, tant dans le Sud profond que sur la côte pacifique du Nord-Ouest des États-Unis et du Canada, entre 1917 et 1924. La grève des forestiers de l’IWW en 1917 mena à la journée de travail de 8 heures et améliora grandement les conditions de travail dans le Nord-Ouest, sur la côte pacifique. Même si les historiens du milieu du siècle en attribuent le mérite au gouvernement américain et aux « magnats forestiers visionnaires », c’est une grève de l’IWW qui avait imposé ces concessions.
A partir de 1913, le Syndicat des travailleurs du transport maritime de l’IWW (Marine Transport Workers Industrial Union) montra qu’il constituait une force avec laquelle il fallait compter. Il rivalisa avec les syndicats de l’American Federation of Labor pour prendre l’ascendant dans l’industrie. Étant donné son engagement en matière de solidarité internationale, ses efforts et ses succès dans le domaine ne furent pas surprenants. Local 8, une section du syndicat était dirigée par Ben Fletcher ; il avait recruté principalement des dockers afro-américains sur les quais de Philadelphie et de Baltimore. Il y avait encore d’autres dirigeants, comme l’immigrant suisse Waler Nef, Jack Walsh, E.F. Doree, et le marin espagnol Manuel Rey. L’IWW était également présente sur les quais de Boston, New York, La Nouvelle-Orléans, Houston, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Eureka, Portland, Tacoma, Seattle, Vancouver, ainsi que dans des ports des Antilles, du Mexique, d’Amérique du Sud, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Allemagne et d’autres nations.
Les IWW eurent souvent des difficultés à conserver leurs avantages, là où, comme à Lawrence, ils avaient gagné leurs grèves. En 1912, les IWW dédaignèrent les accords de convention collective, et prônèrent la lutte permanente à l’atelier contre le patron. Il s’avéra cependant difficile de maintenir cette sorte d’élan révolutionnaire contre les employeurs. À Lawrence, les IWW perdirent presque tous leurs membres dans les années qui suivirent la grève, car les employeurs sapèrent petit à petit la résistance de leurs employés, et éliminèrent la plupart des plus farouches supporters du syndicat.
Clarice Stasz, biographe de Jack London note que celui-ci « voyait les Wobblies comme un apport bénéfique à la cause socialiste, bien qu’il ne fût pas aussi radical pour appeler par exemple au sabotage ». Elle mentionne une rencontre personnelle entre London et Big Bill Haywood en 1912.
L’efficacité des tactiques non-violentes des IWW provoqua une réaction violente du gouvernement, des milieux patronaux, et de groupes de « citoyens ». En 1914, Joe Hill (Joel Hägglund) fut accusé de meurtre et, malgré uniquement des preuves indirectes, il fut exécuté par l’État de l’Utah en 1915. Le 5 novembre 1916 à Everett, un groupe d’hommes d’affaires, nommés shérifs-adjoints et menés par le shérif Donald McRae, attaqua des membres du syndicat sur le paquebot Verona, en tuant au moins 5 (6 autres ne furent jamais retrouvés et disparurent probablement dans le Puget Sound). Deux membres de la bande furent tués, et bien que les circonstances exactes demeurent inconnues, on pense que les deux adjoints ont été touchés par des « tirs amis ».
De nombreux membres de l’IWW s’opposèrent à la participation des États-Unis au premier conflit mondial. L’organisation vota une résolution contre la guerre à son congrès de novembre 1916. Ceci rappelle l’opinion exprimée au congrès fondateur de l’IWW, que la guerre constitue une lutte des capitalistes entre eux, dans laquelle le riche s’enrichit, et où bien souvent le pauvre meurt des mains d’autres travailleurs.
Le quotidien des IWW, l’Industrial Worker, écrivait, juste avant l’entrée en guerre des États-Unis : « Capitalistes d’Amérique, nous nous battrons contre vous, pas pour vous ! Il n’existe aucune force au monde qui puisse forcer la classe ouvrière à se battre si elle ne le veut pas. » Pourtant, quand la déclaration de guerre fut votée par le Congrès américain en avril 1917, Bill Haywood, secrétaire général et trésorier des IWW, devint fermement persuadé que l’organisation devait adopter un profil bas, afin d’éviter les menaces perceptibles contre son existence. Elle cessa toute activité anti-guerre, comme l’impression d’affichettes et de documents opposés à la guerre. La propagande contre la guerre ne fit plus partie de la politique officielle du syndicat. Après bien des débats au Directoire Général des IWW, Haywood prônant le profil bas, tandis que Frank Little soutenait la poursuite de l’agitation, Ralph Chaplin trouva un compromis. La déclaration qui en résulta dénonçait la guerre, mais les membres des IWW étaient invités à exprimer leur opposition en utilisant les procédures légales de la conscription. On les conseillait de se faire enregistrer, en indiquant leur demande d’exemption par « IWW, opposé à la guerre ».
Bien que les IWW ait modéré son opposition verbale, la presse traditionnelle et le gouvernement américain réussirent à dresser l’opinion publique contre elle. Frank Little, l’opposant de l’IWW le plus virulent à la guerre, fut lynché à Butte dans le Montana en août 1917, juste quatre mois après la déclaration de guerre.
Le gouvernement saisit l’occasion de la Première Guerre mondiale pour briser l’IWW. En septembre 1917, des agents du département de la justice menèrent des opérations simultanées contre quarante-huit locaux de réunion de l’IWW à travers tout le pays. En 1917, cent soixante-cinq dirigeants du syndicat furent arrêtés pour conspiration visant à entraver la conscription, à encourager la désertion, et intimider les autres dans les cas de conflits du travail, conformément à l’Espionage Act ; cent un passèrent en jugement devant le juge Kenesaw Mountain Landis en 1918. Ils furent tous reconnus coupables---même ceux qui n’appartenaient plus au syndicat depuis des années---et reçurent des peines de prison allant jusqu’à vingt ans. Condamné à de la prison, mais laissé en liberté provisoire sous caution, Haywood s’enfuit en Union soviétique, où il séjourna jusqu’à sa mort.
Dans son livre "The Land That Time Forgot" (traduction du titre : La terre que le temps oublia), publié en 1918, Edgar Rice Burroughs présentait un membre des IWW comme un traître et un vaurien particulièrement méprisable. Cette vague de dénigrement poussa, en de nombreux endroits, des groupes d’auto-défense à attaquer les IWW. À Centralia le 11 novembre 1919, Wesley Everest, membre du syndicat et ancien combattant, fut remis à la foule par les gardiens de la prison. Il eut, tout d’abord, les dents cassées avec une crosse de fusil, puis fut castré et lynché trois fois en trois endroits différents, et enfin son corps fut criblé de balles, avant d’être enterré dans une tombe anonyme16. Le rapport officiel du médecin légiste attribua le décès à un « suicide ».
Après la guerre, la répression continua. Des membres des IWW furent poursuivis pour infraction à différentes lois fédérales et gouvernementales, et les Palmer Raids de 1920 sélectionnaient les membres de l’organisation qui étaient nés à l’étranger. Au milieu des années 1920, le nombre d’adhésions avait déjà décliné en raison de la répression gouvernementale.
108. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 7 février 2015, 09:18, par R.P.
En 1912, les IWW se tournèrent vers l’Est et entreprirent la conquête des travailleurs du textile. Les 25.000 travailleurs inorganisés de l’American Woolen Company (lainages), à Lawrence (Massachussets), cessèrent le travail pour protester contre des salaires de famine. Ils étaient, pour la plupart, des immigrants de fraîche date, appartenant à vingt-huit nationalités différentes. Les Italiens prédominaient. Un des dirigeants des IWW, Joseph Ettor, prit la direction de la grève. Il la mena de main de maître.
La petite ville fut mise en état de siège et Ettor arrêté. Haywood vint le remplacer. Un cortège de 10 à 15 mille grévistes lui fit un accueil triomphal. Il procéda à des innovations hardies. Secondé par une militante de valeur, Elisabeth Gurley Flynn, il organisa la solidarité à l’européenne, dirigeant les enfants des grévistes vers les foyers d’amis et de sympathisants dans d’autres villes. Il fit participer les femmes à la lutte et elles se battirent comme des lions. Il installa autour des usines des piquets intinterrompus, composés de milliers de travailleurs. Il sut attirer l’attention de l’opinion publique en faveur des grévistes. Il s’assura des concours dans la presse. Un comité d’enquête fut constitué à Washington et une délégation de seize enfants, garçons et filles, âgés de moins de seize ans, se rendit dans la capitale fédérale pour décrirer les terribles conditions d’existence à Lawrence. Un de ces enfants traita de menteur Samuel Gompers, venu témoigner contre la grève.
Les employeurs finirent par céder. A l’annonce de leur victoire, les travailleurs (fait très rare aux Etats-Unis) chantèrent l’Internationale, en toutes langues. L’effet de cet événement fut immense et dépassa le cadre de Lawrence. 25.000 ouvriers obtinrent, par contrecoup, une augmentation de salaire.
Une autre grève éclata, au début de 1913, dans l’industrie de la soie, à Paterson (New-Jersey). Elle s’élargit en une grève générale de solidarité. Haywood prit la tête du mouvement. Un cortège de 35.000 travailleurs de toutes nationalités se rendit à un meeting pour l’entendre. Il fut arrêté ; lorsque l’AFL organisa à son tour un meeting, les travailleurs le désertèrent, pour protester contre le refus d’accorder la parole aux leaders de l’IWW.
Haywood, qui avait le génie de la publicité, amena 1200 grévistes à New York, où ils défilèrent dans les rues. Un grand meeting fut tenu à Madison Square Garden, éclairé par un gigantesque transparent lumineux, portant, en rouge, les trois lettres « IWW ». Les grévistes exposèrent eux-mêmes leurs conditions d’existence à Paterson, chantèrent des chants qu’ils avaient composés et jouèrent un spectacle retraçant les péripéties de leur lutte. La presse fit de longs compte-rendus. Haywood, toujours innovant, organisa des meetings d’enfants de grévistes, leur fit constituer un comité de grève, développa leur conscience de classe en leur racontant la fascinante histoire d’une cité d’enfants, sans adultes, sans police, sans prisons, sans banques et sans patrons. Malgré tous ces efforts, la bataille se termina par un échec.
Le soulèvement du textile frappa fortement l’imagination des travailleurs des industries de production de masse, dont l’organisation avait été totalement négligée par l’AFL. En 1913, à Akron (Ohio), la cité du caoutchouc, les travailleurs inorganisés des grandes usines de pneus se soulevèrent spontanément. Les IWW prirent la direction du mouvement. Bientôt 20.000 ouvriers du caoutchouc furent en grève. L’infatiguable Haywood accourut. Aidé de James P. Cannon, le future leader trotskyste, il organisa, comme à Lawrence, des piquets de masses. Ici, l’union des syndicats AFL soutint le mouvement et envisagea de déclencher une grève générale. Mais le mouvement, finalement, échoua. Une des causes de cette défaite fut l’attitude hostile de William Green, de la fédération des Mineurs, futur successeur de Gompers, à la direction de l’AFL. Alors sénateur de l’Ohio et président d’une commission d’enquête législative, il dénonça les leaders IWW, les traitant d’ « agitateurs du dehors ».
De même, à Detroit (Michigan), autre forteresse de la nouvelle grande industrie, les wobblies déclenchèrent une grève, au cours de l’été 1913, dans l’usine Studebaker. 8000 travailleurs, tous inorganisés, débrayèrent durant une semaine. Ils firent preuve d’une remarquable cohésion, mais le mouvement manqua son but. Presque en même temps, les organisateurs IWW concentrèrent leurs efforts sur les usines Ford, qu’ils inondèrent de journaux et de tracts, tandis que des orateurs haranguaient les travailleurs aux portes de l’entreprise. Le bruit courut que les wobblies préparaient une grève chez Ford pour l’été 1914. C’est alors que Ford, se sentant menacé, inaugura sa politique des « hauts salaires ».
Trois ans plus tard, en 1916, les mineurs des gisements de fer de Minnesota, le Mesaba Iron Range, qui extrayaient la matière première nécessaire aux acieries de Pittsburgh et de Chicago, se révoltèrent à leur tour. Ces immigrants de fraîche date, pour la plupart d’origine finlandaise, se cherchèrent une direction. Les IWW répondirent à leur appel. Joseph Ettor et Elisabeth Gurley Flynn se rendirent sur place. La grève devint générale et engloba 16.000 mineurs. Finalement l’US Steel accorda une augmentation de salaire de 10%, la journée de huit heures et de meilleures conditions de travail.
Cependant, après 1914, les IWW dirigèrent à nouveau l’essentiel de leurs efforts vers l’Ouest. Malgré les succès qu’ils avaient remporté dans l’Est, ils n’avaient pas réussi à y constituer une organisation permanente et la crise économique qui sévissait alors réduisit la combativité des ouvriers non qualifiés des régions industrielles de la côte Atlantique. En 1915-1916, ils entreprirent d’organiser les travailleurs agricoles, notamment en Kansas, Okhlahoma, Minnesota. Ils réussirent à syndiquer 18.000 ouvriers migrateurs. Puis ils se tournèrent vers les bûcherons du Nord-Ouest et les mineurs de cuivre de l’Arizona.
En 1917, les IWW atteignirent leur apogée, au moins quant au nombre des adhérents. En un an, ils étaient passés de 40.000 à 100.000. Mais l’entrée en guerre des Etats-Unis déchaîna contre eux une féroce répression. Toutes les forces conjointes du capitalisme, des pouvoirs poublics, des anciens combattants employés à les écraser. Samuel Gompers, heureux d’être enfin débarrassé d’un rival gênant, donna carte blanche au président Wilson. Des milliers de wobblies furent arrêtés, condamnés à de longues années de prison. Le mouvement fut purement et simplement décapité. Il ne s’en releva jamais.
109. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2015, 14:44, par Robert Paris
Que pense la grande bourgeoisie du péril ouvrier en 1914 ? Il suffit de lire le journal bourgeois "La Chronique de la Quinzaine" : voir ici
110. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 février 2015, 10:37, par Robert
Lénine le 28 septembre 1914 :
« Pour duper le prolétariat et détourner son attention de la seule guerre véritablement libératrice, ‑ c’est‑à‑dire de la guerre civile contre la bourgeoisie, celle de « son propre » pays comme celle des pays « étrangers », ‑ pour atteindre ce noble objectif, la bourgeoisie de chaque pays cherche, par des phrases mensongères sur le patriotisme, à exalter la portée de « sa » guerre nationale et assure qu’elle veut triompher de l’ennemi, non pour piller et conquérir des territoires, mais pour « libérer » tous les peuples, sauf le sien. »
111. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 février 2015, 23:52, par Max
"il y avait également les circonstances politiques. En France, toutes les équipes gouvernementales s’étaient archi usées au pouvoir et il devenait impossible de ne pas faire appel à celui qui apparaissait comme un véritable homme d’Etat : Jean Jaurès, sauf qu’on ne savait pas ce qu’il ferait en cas de guerre… Le parti socialiste s’exprimait toujours contre la guerre mais tout le monde savait que, si la guerre était déclarée, il s’alignerait sur la position patriotique et donc sur la défense des intérêts de sa propre bourgeoisie. En Allemagne, également, la bourgeoisie ne peut se contenter de voir le parti social-démocrate gagner en influence politique comme il vient de le faire le 12 janvier 1912 en raflant 34,8 % des suffrages, et 110 sièges au Reichstag où il devient le plus grand parti d’Allemagne. Là aussi, la marche à la guerre assure, au moins momentanément, que la direction du parti social-démocrate bascule vers la défense nationale et s’aligne immédiatement sur les intérêts de la bourgeoisie allemande."
Quand tu dis "tout le monde savait" à propos de la future unité nationale de la SFIO concernant la guerre, as tu des éléments précis qui permettent de le vérifier ?
Il me semble que Lénine ne voulait pas croire au vote des crédits de guerre en allemagne par la sociale démocratie.
112. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 avril 2015, 06:45, par alain
Y avait-il des mouvements insurrectionnels dans les colonies, dans les empires, dans les pays dominés à l’approche de la première guerre mondiale ?
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 avril 2015, 07:04, par Robert Paris
La réponse est oui : il y avait partout une montée des révolutions : dans l’Egypte des années 1900 avec le Mouvement national, dans la Turquie de 1907 avec la révolution « Jeune turc » de 1908 et les révoltes des peuples opprimés, dans la Chine de 1907-1911 avec le mouvement révolutionnaire démocratique de de Sun Yat-sen, dans la Tunisie de 1907, dans l’Iran de 1911, dans l’Inde de 1905 à 1908, dans le Mexique de 1910 à 1917, etc….
113. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 avril 2015, 10:14, par alain
Et y avait-il une montée ouvrière au Japon avant 1914 ?
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 avril 2015, 10:20, par Robert Paris
Trois grandes vagues de grèves ont eu lieu au Japon : l’une qui s’est déroulée sur trois années, de 1896 à 1898, la deuxième sur les deux années 1906 et 1907 et la troisième en 1912.
Soutenue par le syndicat des cheminots, fondé en 1898, la lutte se termina sur une victoire : les grévistes demandaient une meilleure reconnaissance de leur travail et la fin des discriminations qu’ils estimaient subir dans leur entreprise ; la compagnie leur accorda une position équivalente à celle des employés de bureau et remplaça les anciennes dénominations de leurs grades, trop dévalorisantes, par d’autres plus positives. Par contre, les machinistes, qui se mirent à leur tour en grève en 1899 et au début 1900 pour obtenir les mêmes avantages, échouèrent.
Toute l’année 1906 fut ponctuée d’arrêts de travail dans les chantiers navals, civils mais surtout militaires à cause des licenciements consécutifs à la fin de la guerre, dont le motif principal était le relèvement des salaires : en janvier, tous les ouvriers arrêtent le travail dans le chantier de réparations navales d’Ôminato, à Aomori ; du 5 au 7 février, ce sont 750 ouvriers qui font grève dans le chantier naval d’Ishikawajima, près de Tôkyô ; en août, c’est l’arsenal de Kure, dans le sud-ouest du pays, qui est touché ; et en décembre, l’arsenal militaire d’Ôsaka. Ces mouvements se poursuivirent dans les premiers mois de 1907 : 500 menuisiers du chantier naval Mitsubishi de Nagasaki cessent, par exemple, le travail du 16 au 20 février.
Durant toute l’année 1907, les mineurs participèrent à plusieurs grèves quasi insurrectionnelles qui n’avaient pas simplement des revendications salariales pour objet, mais aussi la brutalité de leur exploitation : du 4 au 7 février, les mines de cuivre d’Ashio, situées à 100 kilomètres au nord de Tôkyô, dans la préfecture de Gunma, s’embrasent ; en avril, ce sont les mines de Horonai, dans l’île de Hokkaidô ; en juin, les mines de cuivre de Besshi, dans l’île de Shikoku ; puis les mines d’argent d’Ikuno, près de Kôbe. Seule l’armée réussit à contenir ces mouvements souvent très violents.
La grève à Ashio est celle qui a le plus impressionné les observateurs de l’époque. Tous se plaisent à souligner son importance pour le mouvement ouvrier japonais, quoiqu’on ne sache pas exactement les raisons qui l’ont déclenchée. Les mines d’Ashio avaient déjà défrayé la chronique au début du xxe siècle ; leur nom est lié à l’un des premiers exemples de pollution industrielle au Japon des terres et des rivières alentour. L’extraction de cuivre constituait alors un secteur vital pour le Japon, qui était en 1914 le deuxième exportateur mondial de cette matière première. Les mines d’Ashio appartenaient en outre à la puissante famille des Furukawa, et Hara Takashi (1856-1921), ministre de l’Intérieur en 1907, y possédait des intérêts. Toute interruption de la production dans ces mines constituait donc une menace pour l’Etat.
Le conflit fut d’une rare violence, comme l’a rapporté Félicien Challaye en 1921 : « (...) les ouvriers (...) rouent de coups de bâton l’un des directeurs des travaux, s’emparent des magasins, pillent les provisions, mettent le feu aux bureaux, détruisent les habitations des surveillants, chassent des mines la police. » Les mineurs firent même usage d’explosifs, ce qui était plus une habitude des nihilistes russes que des Japonais, indiquant par là l’influence à cette époque au Japon, malgré la guerre russo-japonaise, des idées et des pratiques venues de Russie.
L’intervention de l’Etat dans ces conflits du travail s’est exprimée, après la première période, de 1896 à 1898, par la Loi de police sur la sécurité publique (Chian keisatsu hô) de 1900, qui restreignait les droits de réunion publique, de grève et d’organisation ; complétée en 1925 par une Loi sur le maintien de l’ordre (Chian iji hô), elle réglera les réglera les relations du travail jusqu’en 1945. Cette loi, qui ne laissait à la classe ouvrière aucun moyen légal d’exprimer ses doléances en soumettant la formation des syndicats et la tenue de réunions publiques au pouvoir discrétionnaire de la police, aboutit à faire naître les grèves violentes qui ont marqué la deuxième période de luttes.
Après les grandes grèves de 1906-1907, l’Etat promulgua en 1911 une Loi sur les fabriques (Kôjôhô) qui accordait un adoucissement des conditions de travail aux ouvriers et une tolérance à créer des syndicats modérés. Cette loi et celle de 1900 ne sont contradictoires qu’en apparence. La Loi de police, on vient de le voir, fut en vigueur dès le moment de sa publication, et jusqu’en 1945. Celle sur les fabriques, par contre, plus une concession aux luttes de la classe ouvrière que l’expression de la position du gouvernement, dut attendre 1916 pour être effectivement appliquée et on n’en parlait déjà plus dans les années 1920, après que de nouvelles luttes eurent forcé les entrepreneurs à accorder plus que la Loi sur les fabriques avait jamais pu promettre. En fait, le seul effet immédiat de la Loi sur les fabriques fut la création du syndicat Yûaikai (Société fraternelle) en 1912.
Le mouvement syndical au Japon n’a commencé à véritablement intervenir dans les conflits du travail qu’après la première guerre mondiale. Ce paragraphe concerne donc, en fait, plus la préhistoire du syndicalisme japonais que son histoire proprement dite. Mais il n’est pas sans intérêt de tracer cette préhistoire parce qu’elle montre en germe le cours suivi par le syndicalisme au Japon depuis les origines, celui d’un syndicalisme de collaboration de classes, à l’image de ce que nous connaissons depuis la fin de la première guerre mondiale dans tous les pays industrialisés.
Il n’y a aucun indice de l’existence d’un syndicalisme révolutionnaire au Japon, sinon les revendications des IWW américains d’avoir des affiliés dans quelques ports japonais, principalement Yokohama. Or, il semble que ces affiliés furent pour la plupart des marins américains venus au Japon avec de la propagande écrite qu’ils distribuaient à un très petit nombre de contacts japonais.
Un aspect intéressant à noter pour l’histoire du syndicalisme au Japon, est que dès l’origine les syndicats ne limitaient pas leur action aux murs de l’usine mais étendaient leur contrôle à l’ensemble de la vie des ouvriers. Le nom du plus important des syndicats cités plus haut, celui des cheminots, la Nihon tetsudô kyôseikai, illustre bien ce propos : le terme kyôsei indique clairement que le but du syndicat était le redressement moral de ses troupes, et non comme on pourrait le croire de corriger les abus faits aux ouvriers par leurs patrons. La lutte quotidienne des militants de cette organisation se faisait surtout contre l’alcoolisme, les paris et les fréquentes bagarres entre travailleurs.
1898
Grèves des cheminots dans le nord-est du Japon.
1902
15-19 juillet : grève au chantier naval militaire de Kure contre un quartier-maître trop sévère.
1906
Août : grève aux chantiers navals militaires de Kure (Kure kaigun kôshô).
Décembre : grève à l’arsenal militaire d’Ôsaka (Ôsaka rikugun zôheishô).
1907
4-7 février : trois jours d’émeutes aux mines d’Ashio, dans la préfecture de Tochigi.
16-20 février : grève des menuisiers du chantier naval Mitsubishi de Nagasaki pour de meilleurs salaires et contre un projet d’allonger leurs heures de travail.
Avril : grève dans les mines de charbon de Horonai (Horonai tankô), Hokkaidô.
Juin : grève dans les mines de cuivre de Besshi, Shikoku.
Juillet : grève dans les mines d’argent d’Ikuno, près de Kôbe.
Une crise industrielle et boursière fait chuter le gouvernement Saionji.
1908
22 juin : « affaire du drapeau rouge » (akahata jiken) : ce jour-là, une manifestation pour célébrer la libération de Yamaguchi Koken (1883-1920), après quatorze mois de prison, dégénère ; une partie des participants à la réunion qui défilent dans la rue avec des drapeaux rouges portant les inscriptions « anarchisme » et « anarcho-communisme » sont sévèrement malmenés, puis condamnés à de lourdes peines de prison.
1912
31 décembre 1911-4 janvier 1912 : grève des chemins de fer municipaux de Tôkyô.
114. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 7 avril 2015, 07:07, par R.P.
« Le Manifeste de Bâle de la IIe Internationale, qui avait porté dès 1912 une appréciation précisément sur la guerre qui devait éclater en 1914, et non sur la guerre en général (il existe différentes sortes de guerres, il en est aussi de révolutionnaires), est resté un monument qui dénonce toute la faillite honteuse, tout le reniement des héros de la IIe Internationale. C’est pourquoi je reproduis ce manifeste en annexe à cette édition, en attirant une fois de plus l’attention des lecteurs sur le fait que les héros de la IIe Internationale évitent soigneusement les passages du manifeste où l’on parle avec précision, de façon claire et explicite, de la liaison entre cette guerre imminente, précisément, et la révolution prolétarienne, sur le fait qu’ils les évitent avec un soin égal à celui que met un voleur à éviter le lieu de son larcin. »
L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine
115. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 7 avril 2015, 07:23, par R.P.
Lénine écrivait :
« Kautsky était encore marxiste, par exemple en 1909, au moment où il écrivait le Chemin du pouvoir, il soutenait précisément l’idée que la guerre rendait la révolution inévitable ; il disait que l’ère des révolutions approchait. Le Manifeste de Bâle, en 1912, fait état expressément et en toute netteté de la révolution prolétarienne par suite de la guerre impérialiste qui justement a éclaté en 1914 entre les groupes allemand et anglais. Or en 1918, lorsque par suite de la guerre, les révolutions ont éclaté, Kautsky, au lieu d’expliquer leur caractère inéluctable, au lieu d’étudier et de méditer à fond la tactique révolutionnaire, les moyens et les méthodes de préparation à la révolution, se met à qualifier d’internationalisme la tactique réformiste des menchéviks. N’est ce pas là une besogne de renégat ? »
116. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 mai 2015, 08:11, par Robert
A partir du 14 avril 1913, la Belgique fut secouée par une grève de masse qui mobilisa jusqu’à 400 000 travailleurs. L’appel à la grève avait été lancé par le Parti socialiste belge, en opposition au "vote plural" qui donnait aux propriétaires fonciers, aux gens instruits et aux riches un plus grand nombre de voix qu’aux gens ordinaires.
Cette grève faisait suite à la victoire électorale des éléments catholiques conservateurs l’année précédente. L’opposition socialiste avait d’abord décidé en juin 1912 d’organiser une grève générale à un moment donné à venir. Mais c’est seulement lorsqu’il devint évident que le roi n’allait pas intervenir pour modifier les lois électorales, et sous la pression croissante des masses, que l’appel à la grève fut lancé.
La Belgique avait une classe ouvrière industrielle hautement concentrée avec une histoire de grèves massives, remontant à 1893. Au moins la moitié de la classe ouvrière industrielle du pays participa à la grève de 1913, paralysant les principales entreprises. Au bout d’un peu plus d’une semaine, cependant, le parti socialiste donnait comme consigne aux ouvriers de mettre fin à l’action de grève, suite à une promesse du premier ministre de créer une commission pour "étudier" la question du vote plural. La grève prit fin officiellement le 22 avril. Le vote plural resta en place tout au long de la Première Guerre mondiale.
La politique de conciliation des socialistes belges fut commentée par un certain nombre de personnalités marxistes sur la scène internationale, dans le cadre de la lutte qui s’intensifiait entre les tendances révolutionnaires et opportunistes dans le mouvement socialiste. Rosa Luxembourg, la représentante la plus déterminée de l’opposition révolutionnaire aux opportunistes et aux tendances conservatrices syndicalistes qui dominaient de plus en plus le mouvement socialiste allemand, fit référence à la grève belge dans un discours sur la "grève politique de masse."
Luxembourg dit que suite à la politique des sociaux-démocrates opportunistes qui s’orientaient vers le libéralisme, "la grève a été abandonnée dès la première concession illusoire faite, une concession qui représentait un gain quasiment nul... Nous voyons donc que la grève de masse, employée en conjonction avec la politique d’une grande coalition, n’aboutit à rien, si ce n’est à des revers." Elle appela la social-démocratie allemande à rejeter la politique opportuniste qui avait conduit à la trahison de la grève en Belgique.
Lénine écrivit que le résultat de la grève démontrait la nécessité d’une rupture avec les libéraux bourgeois, d’un combat pour la conscience socialiste et d’un parti de la classe ouvrière qui soit politiquement indépendant.
117. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 mai 2015, 08:13, par Robert
En 1912, Louis Renault étend le chronométrage, ce qui provoque une grève à partir du 1er Décembre 1912. Les ouvriers réclament principalement la suppression pure et simple de l’organisation scientifique du travail, Renault répond par la conciliation. Finalement, un accord est signé le 5 Décembre ; il autorise les ouvriers à élire deux délégués par atelier pour contrôler les opérations d’établissement des prix par les chronométeurs et augmenter de 20% le temps d’exécution déterminé par ses derniers...Après une période d’apaisement, le conflit rebondit en 1913 : la guerre éclate de nouveau chez Renault. Les ouvriers revendiquent la suppression du chronométrage, le maintien des délégués avec formations d’une commission ouvrière du travail, la suppression des pièces loupées et des outils cassés. Louis Renault accepte les deux dernières revendications, mais rejette la première. Cette grève, qui va durer 44 jours sera finalement un échec. Renault en combinant conciliation et répression a, en effet, été à l’origine d’une certaine division chez les ouvriers. Certains reprenaient le travail ou étaient embauchés pendant que les autres étaient en grève. Ces grèves avaient deux motivations. Tout d’abord l’élite des professionnels était contre l’accélération du rythme de son travail et sa déqualification. Mais il ne s’agit là que de la minorité des grévistes. La majorité qui pensait plus à la baisse du prix des pièces comprend des contremaîtres, des manoeuvres et des ouvriers moyennement qualifiés.
Le 10 février 1913, débutait dans les usines Renault la deuxième grève du chronométrage…
Les Renault ne sont pas les seuls en grève en 1913. Les boulangers le sont par exemple aussi…
N’ayant pas abouti à la révision de leur salaire par des réclamations et des interventions multiples, et après avoir vainement attendu une proposition raisonnable de la part des patrons, trois mille ouvriers boulangers se mirent en grève à Paris. Leur action corporative justifiée par le fait que depuis 1903 (période des dernières grèves de la boulangeries (1903-1906), ils n’avaient reçu aucune augmentation de salaire, que le repos hebdomadaire n’était pas appliqué et que le nombre d’heures de travail était illimité.
Ils revendiquaient un salaire fixe de 48 francs par semaine et 2 francs de prime pour chaque journée supplémentaire, la limitation des heures de travail, l’application du repos hebdomadaire et la suppression du travail de nuit.
Mais les patrons repoussèrent toutes les revendications, sans vouloir en discuter avec les ouvriers. Devant la mauvaise volonté évidente des patrons, les travailleurs boulangers recouvrirent à leur seul moyen de combat : la grève.
Extrait de l’étude du poème « Le musicien de Saint-Merry » de Guillaume Apollinaire par Mr Poupon (cahiers de l’Association Internationale des études françaises-volume 23- page 212) :
« Or, ce quartier [le Marais] occupait la une des journaux de 1913. Deux drames passionnels, l’un près de Saint-Merry le 11 mai (Titre : « L’amour qui tue », l’autre le 17, rue Simon-Le-Franc : « William Leroux tue Augustine Tessan. Mais je retiens surtout les échauffourées dues à la grève des boulangers, grève qui s’est poursuivie pendant une bonne partie du mois.
La corporation des boulangers se tenait depuis le moyen-âge rue Brise-Miche. Les grévistes se réunissaient non loin de là, au manège Saint-Paul. Pendant ce temps deux boulangeries étaient ouvertes rue de la Verrerie. Des gens venus de tous les horizons faisaient la queue pour avoir du pain.
Mais les grévistes décidèrent de mener une expédition punitive contre les « renards » (nous dirions « les jaunes »).
L’Intransigeant écrit a la date du 16 mai : « Trois ouvriers boulangers qui avaient défoncé des panneaux et brisé des glaces dans les boulangeries de la rue de la Verrerie et de la rue Vieille du Temple ont été appréhendés et envoyés au dépôt. »
En novembre 1913, c’est une grande grève des mineurs du Nord qui démarre…
Le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, qui produit 67 % du charbon national, est en grève depuis plusieurs jours. La cause du mécontentement provient d’un sous-effectif endémique qui allonge la durée de travail et porte atteinte à la journée de huit heures, vieille revendication ouvrière. Rien qu’à Lens, par exemple, il manquerait 1800 ouvriers. Le mouvement s’étend au département du Nord et prend de l’ampleur.
Soi-disant afin d’éviter les débordements et les violences, le gouvernement a appelé la troupe. A la Chambre, le député socialiste Jean Jaurès tonne :
« Pourquoi envoie-t-on des forces militaires dans le bassin minier du Pas-de-Calais ? Y-a-t-il la moindre menace de désordre ? Le syndicat des mineurs a fait appel au calme. Que signifie ce déploiement de forces ? Le risque est plus grand de violence et d’agitation, par l’envoi des troupes, car, les compagnies peuvent y voir un encouragement aux mesures d’intimidation. Que demandent les ouvriers ? Ils protestent contre le régime des longues coupes qui les épuisent. La Chambre avait abaissé à trente heures par an la durée des coupes. Le Sénat a porté ce chiffre à 150 heures. C’est une dérogation au principe de la journée de huit heures que le Sénat, lui-même, a commise en se déjugeant (…) »
Un journal fait la liste des grèves du Forez en 1913 :
« L’année débuta à Firminy par une grève dans l’usine Verdié, faisant suite au renvoi de sept ouvriers.
A Charlieu, renommée pour son andouille, les patrons bouchers et charcutiers ont fait grève pour protester contre le nouveau règlement de l’abattoir.
Les platriers-peintres de Saint-Etienne observèrent une longue grève, d’au moins 34 jours. Les charpentiers de Rive-de-Gier et les maçons de Panissières se mirent aussi en grève.
Les ouvrières garnisseuses en chapeau de paille de Chazelles (Ets Ferrier et Hardy) réclamaient une augmentation de salaire. Leur grève suivit de peu celle des ouvrières de la Société Manufacturière de chapeaux feutre et laine, à Chazelles toujours.
A Unieux, dans les Aciéries Holtzer, un ouvrier fut mis à pied trois jours. A son retour, il était informé de son renvoi définitif. Ce qui causa un vif émoi. A une délégation ouvrière, la direction annonça que le renvoi serait limité à trois semaines mais qu’ "une amende serait infligée à tous les ouvriers pour n’être pas rentrés à l’heure du travail". La grève se généralisa le 11 avril. Elle concerna jusqu’à 150 ouvriers. »
voir ici
Episode aujourd’hui oublié, les casernes françaises ont été touchées, en mai 1913, par une forte agitation. En cause : le refus de la loi de trois ans de service militaire, pièce maîtresse de la militarisation du pays à la veille de la Grande Guerre. L’événement va provoquer une répression furieuse contre les mutins, mais aussi contre les syndicalistes révolutionnaires et les anarchistes, accusés d’avoir fomenté les troubles. C’est également le point de départ d’une crise ouverte à la CGT.
118. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 mai 2015, 08:14, par Robert
Aux USA, les grèves se développent en 1912…
11 janvier : grève dans les usines textile de l’American Wollen Company à Lawrence (Massachusetts). Les 25.000 travailleurs inorganisés de l’American Woolen Company (lainages), à Lawrence (Massachussets), cessèrent le travail pour protester contre des salaires de famine. Ils étaient, pour la plupart, des immigrants de fraîche date, appartenant à vingt-huit nationalités différentes. Les Italiens prédominaient. L’IWW organise des défilés et des rassemblements qui réunissent 50 000 personnes. Après des affrontements avec la police qui font un mort (Anna LoPizzo, 28 janvier), la loi martiale est décrétée. Un des dirigeants des IWW, Joseph Ettor, prit la direction de la grève. Il la mena de main de maître. La petite ville fut mise en état de siège et Ettor arrêté. Haywood vint le remplacer. Un cortège de 10 à 15 mille grévistes lui fit un accueil triomphal. Il procéda à des innovations hardies. Secondé par une militante de valeur, Elisabeth Gurley Flynn, il organisa la solidarité à l’européenne, dirigeant les enfants des grévistes vers les foyers d’amis et de sympathisants dans d’autres villes. Il fit participer les femmes à la lutte et elles se battirent comme des lions. Il installa autour des usines des piquets intinterrompus, composés de milliers de travailleurs. Il sut attirer l’attention de l’opinion publique en faveur des grévistes. Il s’assura des concours dans la presse. Un comité d’enquête fut constitué à Washington et une délégation de seize enfants, garçons et filles, âgés de moins de seize ans, se rendit dans la capitale fédérale pour décrirer les terribles conditions d’existence à Lawrence. Un de ces enfants traita de menteur Samuel Gompers, venu témoigner contre la grève. Les employeurs finirent par céder. A l’annonce de leur victoire, les travailleurs (fait très rare aux Etats-Unis) chantèrent l’Internationale, en toutes langues. L’effet de cet événement fut immense et dépassa le cadre de Lawrence. 25.000 ouvriers obtinrent, par contrecoup, une augmentation de salaire.
En avril 1913, des grèves ont lieu dans le Colorado.
Grève des mines du charbon du Colorado. Les grévistes de Colorado Fuel & Iron Corporation, propriétés de la famille Rockefeller, sont expulsés des logements qu’ils occupent dans les villes possédées par la compagnie minière. Soutenus par la United Mine Workers Union, ils établissent des campements de tentes dans les collines voisines et maintiennent les piquets de grève. Les hommes de l’agence Baldwin-Felt detective effectuent des raids armés sur leurs campements et des grévistes sont assassinés. Le gouverneur du Colorado fait appel à la garde nationale, qui introduit des briseurs de grève de nuit et réprime les manifestations, aboutissant au massacre de Ludlow le 20 avril 1914.
Puis en 1914…
Grève des mines du charbon du Colorado. 20 avril : la grève des mines de charbon du Colorado, commencé en septembre 1913, culmine avec le massacre de Ludlow : le campement de grévistes de Ludlow est attaqué au fusil-mitrailleur par la garde nationale. Treize personnes sont abattues dans leur fuite. Les cadavres carbonisés de onze enfants et de deux femmes sont retrouvés dans une fosse le lendemain. La nouvelle provoque une grande agitation dans tout le pays et les mineurs prennent les armes. Les troupes fédérales sont prêtes à intervenir quand la grève s’essouffle. Malgré la mort de 66 personnes, aucun milicien ou surveillant des mines ne sera inculpé pour meurtre. Les grévistes de Colorado Fuel & Iron Corporation, propriétés de la famille Rockefeller, sont expulsés des logements qu’ils occupent dans les villes possédées par la compagnie minière. Soutenus par la United Mine Workers Union, ils établissent des campements de tentes dans les collines voisines et maintiennent les piquets de grève. Les hommes de l’agence Baldwin-Felt detective effectuent des raids armés sur leurs campements et des grévistes sont assassinés. Le gouverneur du Colorado fait appel à la garde nationale, qui introduit des briseurs de grève de nuit et réprime les manifestations, aboutissant au massacre de Ludlow le 20 avril 1914. Le massacre de Ludlow fait référence à une action de représailles de la Colorado National Guard durant laquelle 26 grévistes trouvèrent la mort, à Ludlow dans le Colorado le 20 avril 1914. Ce massacre fait suite à un long affrontement entre les grévistes, au nombre de 1 200, et les soldats de la garde nationale et les hommes de l’agence Baldwin-Felt Detective au service de la Colorado Fuel & Iron Company. Le campement des mineurs et de leurs familles est attaqué à la mitrailleuse par deux compagnies de la garde nationale, les grévistes répondent à coup de fusil. Les affrontements durent toute la journée, à la tombée de la nuit les gardes nationaux mettent le feu au camp, treize mineurs sont tués. Le lendemain on découvre dans les restes du camp, les cadavres calcinés de onze enfants et deux femmes dans une fosse, les mineurs avaient creusés des fosses sous leurs tentes pour échapper aux tirs
119. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 mai 2015, 08:15, par Robert
L’Afrique du sud entre en lutte au même moment...
En 1913, une grève générale des mineurs blancs (rejoints par des travailleurs africains) connaît le succès, forçant les Randlords1 à s’asseoir à la table de négociations, après que des manifestations de rue à Johannesburg ont conduit à de violents affrontements et à la mort de 30 ouvriers. Une deuxième grève en 1914 est interdite par la loi martiale. En 1913, les mineurs africains suivent la grève des mineurs blancs, mais la leur est réprimée par l’armée.
Face à la réduction massive des salaires et à la dégradation de leurs conditions de travail, les mineurs entrèrent massivement en lutte. En effet, courant 1913, une grève fut lancée par les ouvriers d’une mine contre les heures supplémentaires que l’entreprise voulait leur imposer. Et il n’en fallut pas plus pour généraliser le mouvement à tous les secteurs avec des manifestations de masse, lesquelles furent néanmoins brisées violemment par les forces de l’ordre. Au final on compta (officiellement) une vingtaine de morts et une centaine de blessés.
Doris Lessing rapporte la montée révolutionnaire en Afrique du sud en 1913 dans « Les enfants de la violence » :
« Le comité de grève transféra son quartier général de Benoni à Johannesburg. Pendant ce temps, le gouvernement armait la bourgeoisie terrifiée en groupes de milice spéciale. Des troupes continuaient à arriver, armées jusqu’aux dents… Des pièces d’artillerie étaient installées dans les espaces dégagés… Les dragons commençèrent à tirer dans la foule… C’était en juillet 1913. S’il n’y avait pas eu la guerre l’année suivante, on les aurait battus, on aurait eu le socialisme en Afrique du sud. »
Le 19 juin 1913, pour faire face à la montée ouvrière, apparaissaient les premières lois d’apartheid en Afrique du Sud. Ségrégation à l’égard des Noirs : le Natives Land Act (en) no 27 fixe la part des terres réservé à chaque communauté en Union sud-africaine6. Les Noirs se voient attribuer 8 % des terres cultivables, alors qu’ils forment plus de 67 % de la population. Il leur est interdit de posséder et d’acheter des terres hors des réserves. Plus d’un million d’entre eux sont expulsés des terres qu’ils cultivaient. Dépossédés de leurs terres, les Noirs vont travailler dans les mines et les plantations européennes.
Au début de 1914 éclata une série de grèves aussi bien chez les mineurs de charbon que chez les cheminots contre la dégradation des conditions de travail. Mais ce mouvement de lutte se situa dans un contexte particulier, celui des terribles préparatifs de la première boucherie impérialiste généralisée. Dans ce mouvement, on put remarquer la présence de la fraction afrikaner, mais à l’écart de la fraction anglaise. Bien entendu toutes deux bien encadrées par leurs syndicats respectifs dont chacun défendait ses propres "clients ethniques".
Dès lors le gouvernement s’empressa d’instaurer la loi martiale sur laquelle il s’appuya pour briser physiquement la grève et ses initiateurs et en emprisonnant ou en déportant un grand nombre de grévistes dont on ignore encore le nombre exact des victimes. Par ailleurs, nous tenons à souligner ici le rôle particulier des syndicats dans ce mouvement de lutte. En effet, ce fut dans ce même contexte de répression des luttes que les dirigeants syndicaux et du Parti Travailliste votèrent les "crédits de guerre" en soutenant l’entrée en guerre de l’Union Sud-Africaine contre l’Allemagne.
Si la classe ouvrière fut muselée globalement durant la guerre 1914/18, en revanche quelques éléments prolétariens purent tenter de s’y opposer en préconisant l’internationalisme contre le capitalisme.
Puis, en 1917, une affiche fleurit sur les murs de Johannesburg, convoquant une réunion pour le 19 juillet : « Venez discuter des points d’intérêt commun entre les ouvriers blancs et indigènes. » Ce texte est publié par l’ International Socialist League (ISL), une organisation syndicaliste révolutionnaire influencée par les IWW américains2 et formée en 1915 en opposition à la Première Guerre mondiale et aux politiques racistes et conservatrices du parti travailliste sud-africain et des syndicats de métier. Comptant au début surtout des militants blancs, l’ISL s’oriente très vite vers les ouvriers noirs, appelant dans son journal hebdomadaire, l’ International, à construire un « nouveau syndicat qui surmonte les limites des métier, des couleurs de peau, des races et du sexe pour détruire le capitalisme par un blocage de la classe capitaliste ».
Dès 1917, l’ISL organise des ouvriers de couleur. En mars 1917, elle fonde un syndicat d’ouvriers indiens (Indian Workers Industrial Union) à Durban. En 1918, elle fonde un syndicat des travailleurs du textile (se déclarant aussi plus tard à Johannesburg) et un syndicat des conducteurs de cheval à Kimberley, ville d’extraction de diamant. Au Cap, une organisation sour, l’ Industrial Socialist League, fonde la même année un syndicat des travailleurs des sucreries et confiseries. Le premier syndicat des ouvriers africains La réunion du 19 juillet 1917 est un succès et constitue la base de réunions hebdomadaires de groupes d’études menés par des membres de l’ISL (notamment Andrew Dunbar, fondateur de l’IWW en Afrique du Sud en 1910). Dans ces réunions, on discute du capitalisme, de la lutte des classes et de la nécessité pour les ouvriers africains de se syndiquer afin d’obtenir des augmentations de salaires et de supprimer le système du droit de passage. Le 27 septembre suivant, les groupes d’étude se transforment en un syndicat, l’ Industrial Workers of Africa (IWA), sur le modèle des IWW. Son comité d’ organisation est entièrement composé d’Africains. Les demandes du nouveau syndicat sont simples et intransigeantes : elles se résument dans son slogan : Sifuna Zonke ! (« Nous voulons tout ! »).
En 1918, une vague sans précédent de grèves contre le coût de la vie et pour des augmentations de salaire, rassemblant ouvriers blancs et de couleur, submerge le pays. Lorsque le juge McFie fait jeter en prison 152 ouvriers municipaux africains en juin 1918, les enjoignant à continuer « d’effectuer le même travail auparavant » mais maintenant « depuis la prison sous surveillance d’une escorte armée », les progressistes blanc et africains sont outragés. Le TNC appelle à un rassemblement de masse des ouvriers africains à Johannesburg le 10 juin.
120. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 mai 2015, 08:19, par Robert
Rosa Luxemburg écrit en 1913 :
« La grève générale belge ne mérite pas seulement, en tant que manifestation remarquable des efforts et des résultats de la masse prolétarienne en lutte, la sympathie et l’admiration de la social-démocratie internationale, elle est aussi éminemment propre à devenir pour cette dernière un objet de sérieux examen critique et, par suite, une source d’enseignements. La grève d’avril, qui a duré dix jours, n’est pas seulement un épisode, un nouveau chapitre dans la longue série des luttes du prolétariat belge pour la conquête de l’égalité et de l’universalité du droit de vote, luttes qui durent depuis le commencement de la dernière décennie du XIX° siècle et qui, selon toute apparence, sont encore très éloignées de leur fin. Si donc nous ne voulons pas, à la manière officielle, applaudir toujours et à toute occasion tout ce que fait et ne fait pas le Parti social-démocrate, il nous faut, en face de ce nouvel assaut remarquable du Parti Ouvrier Belge, dans ses luttes pour le droit électoral, nous poser la question suivante : Cette grève générale signifie-t-elle un pas en avant sur la ligne générale de combat ? Signifie-t-elle en particulier une nouvelle forme de lutte, un nouveau changement tactique qui serait appelé à enrichir, à partir de maintenant, les méthodes de combat du prolétariat belge, et peut-être aussi du prolétariat international ?
Cette dernière question est d’autant plus justifiée que les chefs du Parti belge – quelle que soit leur position tactique – opposent, avec beaucoup de vigueur, la grève d’avril aux précédents grèves belges concernant le droit électoral, ainsi qu’aux grèves de masses qui se sont produites dans d’autres pays, et la louent comme une nouvelle arme dans l’arsenal du prolétariat en lutte. Dans la petite revue mensuelle de Herstal, La Lutte de Classe, de Brouckère écrivait en mars :
« C’est pour la troisième fois que nous ferons une grève pour l’égalité du droit de vote et, dans d’autres pays, on a déjà fait grève dans le même but. La grève du 19 avril n’en représente pas moins un événement nouveau aussi bien par sa durée probable que par l’esprit dans lequel elle a été préparée. Cette grève ne doit ressembler ni aux rafales de 1893 et 1902, ni aux courtes grèves politiques en Suède et en Autriche, pas plus qu’aux grèves révolutionnaires de Russie. Ce sera la première tentative pour guider une grève politique d’après les principes mêmes qui rendent si efficaces les mouvements syndicaux ou, si l’on veut, une tentative pour élargir l’action syndicale jusqu’à la conquête de l’égalité politique. »
Les chefs du Parti, au congrès du 24 avril qui a décidé la cessation de la grève générale, ont souligné également, à plusieurs reprises, son caractère particulier. Vandervelde, lui aussi, écrit dans son article du Vorwärts, le 28 avril :
« Contrairement aux précédents mouvements similaires en Belgique et ailleurs, il s’est agi, cette fois, non plus d’une grève improvisée et impétueuse, mais d’une grève longue, préparée patiemment et méthodiquement. »
Il s’agit donc avant tout de comparer l’efficacité de cette nouvelle tentative de caractère particulier aux tentatives précédentes du prolétariat belge. Si l’on considère uniquement le résultat immédiat et palpable, on ne pourra certes pas écarter la conclusion que la nouvelle expérience du Parti belge a infiniment moins rapporté que son premier assaut d’il y a vingt ans. En 1891, la première courte grève de masse, avec ses 125.000 ouvriers, a suffi pour imposer l’institution de la commission pour la réforme du droit de vote. En avril 1893, il a suffi d’une grève spontanée de 250.000 ouvriers pour que la Chambre se prononce, en une seule longue séance, sur la réforme du droit de vote qui croupissait depuis deux ans dans la commission. Cette fois, la grève de 400.000 ouvriers, après neuf moins de préparation, après des sacrifices et des efforts matériels exceptionnels de la part de la classe ouvrière, a été brisée au bout de huit jours, sans avoir obtenu autre chose que la promesse, sans engagement, qu’une commission sans mandat et sans droit à légiférer recherchera une « formule d’unité » concernant le droit électoral.
Nos camarades belges ne se font aucune illusion sur le caractère vague et confus du résultat ; ils comprennent que ce n’est pas là une brillante victoire et qu’en tout cas, elle ne répond pas du tout aux efforts, aux sacrifices et aux préparatifs formidables qui ont été faits. Aucun des chefs du Parti n’a essayé, au Congrès du 24 avril, de présenter la résolution du Parlement sur ladite commission comme une victoire politique notable. Au contraire, ils se sont tous efforcés de porter le centre de gravité du bilan de la lutte de ces dix jours non sur le résultat parlementaire, mais sur le cours de la grève générale elle-même et sur son importance morale. « Trois points de vue, a dit Vandervelde (d’après le compte rendu du Vorwärts), se sont fait jour dans l’appréciation de la grève générale. Le premier, le point de vue parlementaire, est le moins important. » Mais les deux autres sont : le résultat politique, qui consiste dans la conquête de l’opinion publique, et le point de vue social, qui réside dans le déploiement de forces du prolétariat et dans le caractère pacifique de la grève générale : « Maintenant – s’est écrié Vandervelde – nous connaissons le moyen que le prolétariat peut employer lorsque le pouvoir veut le priver de son droit. » Jules Destrée est allé jusqu’à traiter toute la question du résultat direct de la grève de « futilités parlementaires » :
« Pourquoi ne pas se hausser, au dessus des futilités parlementaires et des nuances des déclarations ministérielles, jusqu’au principal ? Considérons donc le principal, que tout le monde peut voir : l’enthousiasme magnifique, le courage, la discipline de notre mouvement. »
Or, l’attitude excellente de la masse ouvrière belge dans la dernière grève générale, fut loin d’être une surprise. L’enthousiasme, la cohésion, la ténacité de ce prolétariat, se sont affirmés si fréquemment dans les vingt dernières années, en particulier dans l’emploi de l’arme de la grève générale, que le déclenchement et le cours de la grève d’avril, loin d’être une nouvelle conquête, ne sont qu’une preuve de plus de cette ancienne combativité. Evidemment, l’importance de chaque grève de masse réside, en grande partie, dans son déclenchement même, dans l’action politique qui s’y exprime, dans la mesure où il s’agit de manifestations spontanées ou qui éclatent sur l’ordre du Parti, qui durent peu de temps et manifestent un esprit combatif. Lorsqu’au contraire, la grève a été préparée de longue main, de façon tout à fait méthodique et systématique, dans le but politique déterminé de mettre en mouvement la question du droit de vote immobilisé depuis vingt ans, il apparaît assez étrange de célébrer la grève, en quelque sorte, comme un but en soi et de traiter son objectif propre, le résultat parlementaire, comme une bagatelle.
Cette façon de déplacer l’appréciation de la situation s’explique aussi par l’état de gêne dans lequel s’est trouvé notre parti frère belge au bout d’une semaine et demie de grève générale. De toute la situation et de tous les discours du congrès de Bruxelles, il ressort clairement que la grève générale ne fut pas brisée au 24 avril parce qu’on s’imaginait avoir remporté une victoire notable. Au contraire, on s’empressa de saisir la première apparence de « concession » de la part du Parlement, pour désarmer la grève générale, parce qu’on avait, dans les milieux dirigeants, le sentiment net que la continuation de la grève générale amènerait à une situation sans issue et ne donnerait aucun résultat appréciable.
Faut-il en vouloir aux chefs du parti belge d’avoir saisi la première occasion pour arrêter la grève générale, alors que sa prolongation leur paraissait incertaine et sans chance de succès ? Ou faut-il leur faire grief de n’avoir pas cru à la force victorieuse de la grève méthodique, prolongée indéfiniment et « jusqu’à la victoire » ? C’est exactement le contraire qu’il faut dire : longtemps déjà avant le début de la grève d’avril, par la seule façon dont cette grève fut préparée, vu les épreuves et la tactique de la lutte pour le droit électoral en Belgique dans les dix dernières années, tout observateur attentif ne pouvait que douter fortement de l’efficacité de cette nouvelle expérience. Aujourd’hui, où la preuve par l’exemple a été faite et où nos camarades belges pensent avoir ajouter en tout cas, et pour longtemps, une nouvelle arme à leur arsenal, il est temps d’examiner cette arme elle-même. Il est nécessaire de se poser cette question : La grève d’avril, en raison de son organisation, ne portait-elle pas en elle-même les germes de sa stérilité, et l’expérience qui vient d’être tentée n’est-elle pas faite pour nous encourager à la révision de cette tactique plutôt qu’à l’imiter ? »
Leipziger Volkszeitung, 15 mai 1913
121. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 mai 2015, 08:20, par Robert
Rosa Luxemburg rajoute :
Il est hors de doute que dans de telles grèves de masse se dégage une forte étincelle révolutionnaire ; que, dans une atmosphère chargée, dans une situation où la tension des antagonismes a acquis une certaine acuité elles peuvent amener de véritables collisions avec les pouvoirs publics. Mais il n’est pas moins sûr que c’est précisément la pression de telles grèves qui exerce le plus rapidement son effet et qui contraint généralement les classes dominantes à céder avant qu’on arrive aux dernières extrémités, avant qu’une rencontre générale avec la force publique soit amenée par la situation. Le cours des grèves belges de 1891 et de 1893 en est la confirmation complète. De même, en 1905, il suffit au prolétariat autrichien de suivre l’exemple contagieux des combattants révolutionnaires russes et d’entreprendre son mouvement spontané pour contraindre les détenteurs du pouvoir à céder avant qu’un règlement de comptes violent fût nécessaire. La même preuve est fournie par de nombreux autres cas tirés de la pratique du prolétariat international dans les cinquante dernières années : ce n’est pas l’emploi de la force physique, mais bien la résolution révolutionnaire des masses de ne pas se laisser effrayer, le cas échéant, dans leur action de grève par les conséquences les plus extrêmes de la lutte et de faire tous les sacrifices nécessaires qui confèrent à cette action une puissance si irrésistible qu’elle peut souvent amener dans un court laps de temps de notables victoires.
A la base de la grève d’avril en Belgique, au contraire, il y a l’idée d’éviter toute situation révolutionnaire, tout défaut de calcul, tout tournant imprévu de la lutte, en un mot, d’écarter préalablement tout risque et tout danger et de fixer, presque une année à l’avance, toute la campagne. Mais de ce fait, les camarades belges ont enlevé à leur grève générale toute sa valeur de choc. L’énergie révolutionnaire des masses ne se laisse pas mettre en bouteille et une grande lutte populaire ne se laisse pas conduire comme une parade militaire. De deux choses l’une : ou bien on provoque un assaut politique des masses, ou plus exactement, comme un tel assaut ne se provoque pas artificiellement, on laisse les masses excitées partir à l’assaut, et il leur faut alors tout faire pour rendre cet assaut encore plus impétueux, plus formidable, plus concentré, mais alors on n’a pas le droit, juste au moment où l’assaut se déclenche, de le retarder pendant neuf mois afin de lui préparer, dans l’intervalle, son ordre de marche. Ou bien, on ne veut pas d’assaut général, mais alors une grève de masse est une partie perdue d’avance. Si, en avril, ainsi que les chefs l’ont assuré au congrès, on devait seulement faire une démonstration de la discipline et de la volonté unique de la classe ouvrière, il n’était point besoin de dix jours de grève pour cela, et c’était payer trop cher une préparation de neuf mois. Les prolétaires belges étaient depuis fort longtemps déjà prêts à une telle démonstration et s’y étaient déjà plusieurs fois préparés. Mais si ce devait être une grève de combat, la façon dont on l’exécuta était peu propre à en faire une grève victorieuse.
Il est clair, en tout cas – et c’est ce que confirme l’histoire des grèves de masses dans les différents pays – que plutôt une grève politique tombe rapidement et inopinément sur la tête des classes dirigeantes, plus l’effet en est grand et les chances de victoire considérables. Lorsque le Parti Ouvrier annonce, trois trimestres à l’avance, son intention de déclencher une grève politique, ce n’est pas seulement lui, mais aussi la bourgeoisie et l’Etat qui gagnent tout le temps nécessaire pour se préparer matériellement et psychologiquement à cet événement.
D’ailleurs, les longs et laborieux efforts d’épargne des prolétaires belges, si admirables dans leur idéalisme, eurent l’inconvénient de toucher fortement, pendant toute leur durée, les intérêts économiques de la petite bourgeoisie, des boutiquiers et des commerçants, de cette couche dont les sympathies sont les premières à aller à la classe ouvrière. Grâce à la longue préparation de la grève, la grande bourgeoisie put esquiver, dans une large mesure, le coup que toute grève spontanée des masses lui porte à elle d’abord.
L’efficacité de toute grève politique de combat dépend aussi de la collaboration du personnel occupé dans les services publics. Lorsque les camarades belges – ainsi qu’il ressort de leur intention de faire une grève longue et pacifique – ont renoncé à arrêter les services publics, ils ont certes enlevé à leur grève tout « caractère illégal », mais en même temps ils l’ont privée de son efficacité en tant que moyen de contrainte rapide et d’intimidation de l’opinion publique et de l’Etat.
En un mot, toutes les qualités de la grève d’avril qui, suivant les intentions du parti belge, devaient lui donner le caractère méthodique d’une action syndicale, lui ont enlevé par cela même, dans une large mesure, son efficacité de grève politique.
Bien plus, nous avons vu dans l’histoire de la lutte pour le droit électoral en Belgique que les chefs du parti interdisaient réellement, depuis quinze ans environ, la grève de masse, et qu’ils cherchent constamment à la reculer, à l’empêcher. Finalement, cette tactique a eu cependant, chose curieuse, le résultat contraire à celui qu’elle poursuivait. La grève continuellement ajournée au moment où elle devait se déchaîner impétueusement, est devenue maintenant non seulement pour la réaction, mais aussi pour le parti, une véritable épée de Damoclès. Depuis neuf mois déjà, le parti belge est sous la hantise des préparatifs de la grève de masse. Une fois que la grève a été brisée en avril à la première ombre de concession, le parti, au congrès du 24 avril, a dû évidemment la faire rentrer dans ses nouvelles perspectives. La tactique même qui interdisait toute rencontre impétueuse de la masse avec la réaction, a fait de la menace de la grève générale quelque chose de chronique.
122. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 3 mai 2015, 08:20, par Robert
L’Irlande ouvrière et populaire s’enflamme en 1913…
En août 1913, 40 puis 300 ouvriers sont licenciés, accusés d’appartenir au syndicat. Le patronat, mené par Murphy, fait venir des ouvriers britanniques et irlandais originaires d’autres comtés, pour remplacer les licenciés. On les surnomment les Scabs. C’est le grand Lock Out.
La Grande Grève de Dublin éclate. D’abord au sein de la compagnie des tramways de Murphy puis dans les filatures à travers toute la ville. A l’appel de Jim Larkin, les Dublinois descendent dans la rue, soutenus par certains intellectuels irlandais nationalistes (WB Yeat, Bernard Shaw). Dublin est totalement paralysé.
La police dublinoise (britannique) charge les manifestants et des victimes tombent. Une milice est alors formée pour protéger les ouvriers. Ce sera l’Irish Citizen Army, qui prendra activement part à l’insurrection de 1916 pour l’indépendance de l’Irlande.
Le début de la Première guerre mondiale en 1914, l’hiver rigoureux et le manque cruel de nourriture dans la capitale mettront fin à cette première grève sociale irlandaise.
Le conflit marquera les esprits à un point tel que, depuis cette date, le patronat irlandais a toujours cherché la négociation plutôt que le conflit avec les ouvriers et les employés.
Tout avait commencé avec l’arrivée à Dublin de James « Big Jim » Larkin. « God sent Larkin in 1913, a labor man with a union tongue / He raised the workers and gave them courage ; he was their hero, the worker’s son », chanteront les Irlandais en sa mémoire. Il crée un syndicat de masse pour les ouvriers, l’Irish transport and general workers union (ITGWU). Face à lui, William Murphy, le très catholique et indépendantiste dirigeant du patronat dublinois, réagit radicalement : renvoi des ouvriers arborant le badge de l’ITGWU et obligation pour tous les travailleurs de signer un document par lequel ils s’engagent à ne jamais adhérer au syndicat. La grève éclate, d’abord dans les tramways dirigés par Murphy, puis sur les docks et gagne, par solidarité, rapidement les filatures… toute la ville. Jusqu’à la fin de l’année, Dublin est complètement paralysée.
Tous les grévistes ne partagent pas les idéaux révolutionnaires de Larkin ! C’est la défense des ouvriers licenciés et le refus de se soumettre au diktat de Murphy qui animent les premières revendications. Un meeting était interdit ? Les grévistes occupaient la rue et l’organisaient quand même, défiant le pouvoir, le patronat et les charges policières qui laissent derrières elles de nombreuses victimes.
C’est toute la société irlandaise qui se retrouve coupée en deux selon une ligne de fracture toute nouvelle : d’un côté pour les ouvriers en grève, de l’autre pour l’ordre et William Murphy. Indépendantistes ou unionistes, catholiques ou anglicans, irlandais ou anglo-irlandais, se retrouvent dans les deux camps, entre ceux prêts à mourir pour leur cause et ceux prêts à les affamer.
D’ailleurs, le pain devient très vite le nerf de la guerre. Des comités d’aide aux grévistes, souvent animés par les femmes issues des mouvements nationalistes et féministes, comme l’actrice Maud Gonne ou Constance – « la Comtesse Rouge » – Markievicz, organisent des soupes populaires « rouges » ou de « charité ». Des chargements de nourriture sont envoyés par les syndicats anglais. Et c’est là que l’Église catholique réveille son vieux démon : cette charité internationaliste ressemble trop à un complot pour convertir ses ouailles aux diaboliques athéisme et pire, protestantisme. Avec le projet des syndicalistes d’envoyer en Angleterre les enfants affamés de Dublin pour les sauver, la coupe est pleine ! Walsh, l’évêque de Dublin, dira : « Elles ne méritent plus le nom de mères catholiques si elles oublient leur devoir au point d’envoyer leurs enfants dans un pays étranger… » L’Église reçoit le soutien de quelques grands noms de la cause nationaliste comme Arthur Griffith, fondateur du Sinn Féin.
Finalement, c’est l’hiver 1913-1914 et ses rigueurs qui auront raison du mouvement. Vaincus par la faim, le découragement et la violence de la campagne anti-gréviste menée par les catholiques, les travailleurs retournent à leurs postes tandis que Larkin part pour les U.S.A. La relève sera assurée par son camarade James Connolly qui allie dans un même mouvement socialisme révolutionnaire et nationalisme irlandais, autour de l’Irish Citizen Army (ICA), créée et armée à l’origine pour défendre les grévistes de 1913. Aux côtés des nationalistes conservateurs, Connolly dirigera l’insurrection de Pâques 1916 à l’issue sanglante.
123. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 mai 2015, 09:23, par Robert Paris
Les années qui précèdent la première guerre mondiale sont celles d’une montée gréviste et révolutionnaire en Russie.
Le 1er mai 1912, la grève fut ainsi portée par près de 400 000 ouvriers.
Pour la première fois, lors des élections parlementaires, sur les 9 députés de la « curie ouvrière », 6 étaient des bolcheviks.
Fin 1912 et en 1913, des luttes ouvrières radicales démarrent…
Il y a une remontée des mouvements de grève ; entre 725.000 et un million de prolétaires seront en grève en 1912, ce qui revient aux chiffres d’un million d’ouvriers en grève en 1906 et de 740.000 en 1907. En 1913 les chiffres seront compris entre 861.000 et 1.272.000, et lors des six premiers mois de 1914 les grévistes auront été 1,5 million.
Par exemple, à l’usine Grisov à Moscou en 1913, une grève a éclaté parce que “l’attitude de l’administration de l’usine est révoltante. Il s’agit ni plus ni moins que de la prostitution”. Les grévistes revendiquaient entre autres choses de la politesse envers les ouvrières, et l’interdiction des gros mots.
La journée internationale des femmes est introduite en Russie le 23 février 1913 et elle a du succès parmi les ouvrières (rappelons que ce sera la journée internationale des femmes qui démarrera la révolution de 1917).
En juin 1913, ce sont des mouvements de grèves en Russie (1,75 million de grévistes de juin à juillet 1914).
Les grèves se généralisaient, dans la première partie de 1914, il y avait 1,5 million de grévistes. A l’usine Oboukhov de Pétersbourg, la grève dura plus de deux mois ; celle de l’usine Lessner, près de trois mois. La répression était proportionnelle ; rien qu’en mars 1914, à Saint-Pétersbourg, 70 000 ouvriers furent renvoyés en un seul jour.
En juillet 1914, la situation se transforma en crise de grande ampleur, comme un écho de 1905. Toutes les usines étaient en ébullition ; meetings et manifestations se déroulaient partout. On en vint même à dresser des barricades, comme à Bakou et à Lodz. En plusieurs endroits, la police tira sur les ouvriers et pour écraser le mouvement, le gouvernement décréta des mesures d’ « exception » ; la capitale avait été transformée en camp retranché. La Pravda fut interdite.
C’est alors que la guerre impérialiste fut déclarée, le régime en profitant pour écraser les révoltes pour lancer une campagne de nationalisme.
124. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 mai 2015, 11:15, par Robert Paris
Si la guerre mondiale impérialiste de 1914-1918, si le coup d’Etat de Kornilov en Russie en 1917 ou le coup d’Etat de Franco ont été des occasions de ripostes révolutionnaires prolétariennes d’ampleur, c’est d’abord parce que ces attaques contre les peuples et les travailleurs avaient elles-mêmes été causées par la montée des menaces révolutionnaires prolétariennes.
Il n’a jamais existé, dans la société bourgeoise, de grande guerre, de guerre mondiale, de grand massacre, de génocide, de fascisme ou de dictature violente qui ne soit motivée par la crainte des classes dirigeantes et cette crainte est bel et bien l’éloge du vice à la vertu, la reconnaissance par les bourgeois des risques que représentent les exploités….
Jamais ces bourgeoisies n’auraient lancé le génocide des Juifs ou des Arméniens, la « guerre civile » algérienne, le génocide rwandais, ni les fascismes italien, allemand, français, espagnol, portugais, grec ou chilien, ni les dictatures militaires latino-américaines sans les menaces révolutionnaires prolétariennes qui menaçaient à court terme ces bourgeoisies.
Jamais elles n’auraient lancé les guerres mondiales sans cette menace révolutionnaire prolétarienne liée aux crises économiques mondiales.
Bien des commentateurs ne relient la première guerre mondiale qu’à la concurrence coloniale ou à celle concernant les ressources minières mais les grandes puissances pouvaient tout à fait continuer à se combattre et à négocier sur les différents territoriaux sans prendre le risque de mettre le monde à feu et à sang en risquant d’ailleurs exactement ce qui allait se passer : que la guerre mondiale provoque la révolution mondiale ! Ces classes dirigeantes ne pouvaient prendre ce risque que si la révolution prolétarienne mondiale était déjà là si elles n’entraient pas en guerre…
La guerre, la guerre civile, la dictature, le fascisme, le génocide ont été des moyens de faire face à la menace de déstabilisation sociale en faisant basculer toute la société dans la barbarie massive pour éviter que les prolétaires ne menacent la classe possédante.
125. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 7 mai 2015, 07:05, par Robert Paris
N’oublions pas que la guerre impérialiste est la tentative ultime de la bourgeoisie d’éviter momentanément la révolution sociale. En 1914-1918 comme en 1939-1945, des millions d’êtres humains sont morts non seulement parce que les bourgeoisies s’affrontent mais parce qu’elles sont mortellement ennemis de la classe prolétarienne. Voilà ce que ne vous diront jamais les historiens officiels, voilà ce que ne vous diront jamais les partis réformistes ou les partis opportunistes qui se disent révolutionnaires. La guerre, c’est la lutte des classes exacerbée, violente. La guerre mondiale, c’est la lutte des classes parvenue au point d’une violence la plus extrême. Les questions nationales n’ont jamais et nulle part effacé la lutte des classes, dans une guerre moins que dans toute autre situation. Si les classes dirigeantes jettent le monde dans une violence intense, c’est en proportion des craintes qu’elles ont du prolétariat révolutionnaire. C’est un point dont on ne peut sous-estimer l’importance pour la compréhension des situations actuelles. La violence développée en Ukraine, en Syrie ou en Palestine ne s’expliquent qu’ainsi. Plus le monde capitaliste est tombé dans une crise inexorable, plus il développe la violence aux quatre coins de la planète et n’attend que le prochain effondrement financier qu’il ne pourra pas gérer pour la généraliser en guerre mondiale.
126. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 9 mai 2015, 06:51
la révolution sociale, cause la première guerre mondiale, ce n’est pas très classique, non ?
on a eu tout mais pas ça….
On a eu les alliances, les Balkans, le terrorisme, l’archiduc assassiné, l’Alsace et la Lorraine, les colonies, la course aux armements, l’Allemagne, la Russie, l’Autriche, la France. On a même eu la nature humaine, la faute des chefs d’Etat, la mentalité des peuples, le militarisme, les intérêts de l’armement, ceux des trusts et des banques, la concurrence mondiale, les crises, la violation de la neutralité, belge, l’impérialisme, le partage du monde, le blocs, les rancoeurs, le chauvinisme, etc. Mais la crainte des montées révolutionnaires suite aux crises comme cause des guerres mondiales, je ne m’en souviens pas. C’est neuf ?
127. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 9 mai 2015, 06:53, par Robert Paris
Pas tout à fait. C’est ce que pensaient les révolutionnaires marxistes avant la première guerre mondiale mais ensuite, ils ont surtout insisté sur le fait que la guerre avait aussi produit la révolution.
Aujourd’hui, on trouve des écrits en ce sens comme ceux de Jacques Pauwels.
Aux éditions EPO vient de paraître, en néerlandais, son livre De Groote Klassenoorlog. 1914-1918 (« 1914-1918, la Grande Guerre des classes », qui sortira en français le 20 septembre, aux éditions Aden ; il sera donc en vente à ManiFiesta), un ouvrage incontournable sur la Première Guerre mondiale. Il voit deux causes principales à cette guerre : d’un côté, l’impérialisme ; ensuite, la peur de la révolution.
« Les grandes puissances industrielles, les grandes banques et les grandes entreprises voulaient de nouvelles colonies – ou des semi-colonies sur lesquelles elles auraient exercé un contrôle indirect pour leurs matières premières, leur main-d’œuvre bon marché et leurs possibilités d’investissement. Ici réside certainement l’une des principales raisons de la guerre. »
« Vers les années 1900 régnait parmi l’élite une « peur de la masse », la masse dangereuse qui connaissait une montée irrésistible. Pour endiguer ce danger, la guerre était une solution. L’élite voulait revenir au temps des seigneurs qui commandaient, et des esclaves qui obéissaient. Inconditionnellement. Le but était d’anéantir les idées révolutionnaires. Le retour en arrière. Précisément le genre de situation que l’on a dans l’armée : pas de discussion, pas de démocratie et un bel uniforme pour tout le monde. On voulait militariser la société. Il fallait donc une guerre. Et le plus tôt serait le mieux. Cet attentat à Sarajevo n’a pas été la raison de la guerre, c’était le prétexte pour enfin s’y lancer. Plus encore : en attendant trop longtemps, il se pouvait que, quelque part, les socialistes remportent les élections, et là, l’élite craignait la révolution. Les Britanniques et les Français, par exemple, ne pouvaient pas attendre trop longtemps, car ils craignaient qu’en Russie la révolution n’éclate. Dans ce cas, ils auraient perdu cet allié et n’auraient certainement plus pu être victorieux. À un moment donné, on ne put plus attendre. Cet attentat à Sarajevo n’a pas été la raison de la guerre, c’était le prétexte pour enfin s’y lancer. Tout comme la violation de la neutralité belge n’avait pas été une raison de partir en guerre contre l’Allemagne. Ils avaient besoin d’un prétexte… L’élite estimait qu’elle se trouvait tout en haut de l’échelle sociale, qu’elle était composée des meilleurs une fois pour toutes. Ils rationalisaient toute cette violence et tous ces morts : il y avait trop de monde et une guerre tomberait à point pour faire un peu de nettoyage, pour élaguer les classes inférieures. »
A propos du livre « Le mythe de la bonne guerre » de Pauwells :
Ces guerres étaient le meilleur moyen pour l’élite occidentale de faire face à la croissance des mouvements révolutionnaires et démocratiques, alimentés par des conditions économiques désastreuses et menaçant l’ordre établi.
Pauwels raconte que selon Nietzsche par exemple, « la guerre était la solution contre la révolution, car, dans une guerre, il n’y a pas de discussions, comme c’est le cas en démocratie. Dans une guerre, la minorité, l’élite, décide et la majorité, les prolétaires, obéissent. »
128. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 14 mai 2015, 14:38, par R.P.
« Chansons de la guerre » de José Germain :
« Nous composâmes. Les chansons furent mauvaises. Ou bien elles manquaient de tenue, ou bien elles manquaient de sel. Mais ce fut bien pis quand le gouvernement voulut s’en mêler. Comme à chaque intervention de l’Etat, l’insuccès fut notoire. Le concours de chansons du soldat produisit 12.000 manuscrits pour le rebut, tous plus plats les uns que les autres. Pas une chanson chantable. On comprit enfin que le refrain de route était une fleur sauvage, spontanément surgie, un jour, on ne sait lequel, sur le bord d’un fossé poussiéreux, on ne sait où. Et l’on n’insista pas… Las ! la guerre allait détruire par l’expérience toutes nos illusions. Où étais-tu théorie du service en campagne, quand nous sûmes que l’art de se battre était l’art de se cacher ?... La seule qui nous avait semblé irréfutable, celle des chansons de route, allait elle-même recevoir de la vraie guerre, le pire des démentis. On ne chanta pas pour monter aux tranchées… D’ailleurs, dès l’entrée dans les boyaux, l’ordre était de se taire pour ne pas provoquer le barrage allemand. Et, auparavant, sur la route montante, l’homme sans joie songeait aux huit jours de détresse qui l’attendaient. Le chanteur eût été mal vu. On l’eût pris pour un insulteur de la grande peine des hommes. Avec sérénité, on ruminait son testament. Nous tentâmes parfois de chasser ainsi le cafard, en Artois, en Champagne et à Verdun, les trois pires secteurs. Peine perdue. Le lanceur de refrain était accueilli comme un piqué. « Au fou ! » criait la colonne. Le chant doit être spontané. Quand les musiques militaires que nous détestions, comme des embusqués, recevaient l’ordre de nous distraire officiellement et de nous remonter le moral au cantonnement, elles furent systématiquement boycottées. Le soldat fit la grève perlée. On dut, dans certains régiments, l’obliger à la présence, ce qui allait à l’encontre des désirs du commandement. »
Et l’auteur, qui est l’un des compositeurs de chansons de soldats de la guerre de 1914-18 est pourtant très loin d’être un antimilitariste. C’est même un officier de la légion d’honneur.
129. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 14 mai 2015, 14:47, par Robert
Anatole France, lettre à Richtenberg de 1917 :
« Faire la paix ?... Nous ne sommes pas pressés ! La guerre ne fait perdre à la France que dix mille hommes par jour… »
« Je crois bien, quoi qu’il arrive, que la fin de la guerre ne ferme pas l’ère de la violence. »
130. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 14 mai 2015, 14:48, par Robert
Anatole France dans « Dernière pages » :
« La guerre s’est signalée en Europe et dans le monde par d’innombrables bienfaits. Mais c’est par la prospérité économique qu’elle s’est surtout manifestée. Elle a multiplié la richesse et créé une situation financière admirable en payant les ouvriers en papier et les soldats en gloire. »
131. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 15 mai 2015, 08:46, par Robert
« Le peuple allemand ne veut pas la guerre. On ne dit pas la vérité quand on prétend qu’il la veut… »
Anatole France, décembre 1904
132. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 15 mai 2015, 08:50, par Robert
« A vous de faire la guerre à la guerre, une guerre à mort… Tuez-la. Ne dites pas que c’est impossible et qu’elle durera autant que l’espèce humaine puisque les nations seront toujours ennemies. Qu’elles le soient tant qu’elles existeront, c’est possible. Mais les nations n’existeront pas toujours. »
Anatole France, lettre aux dames de la « Good Will Delegation »
133. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 16 mai 2015, 08:09, par Robert
Anatole France :
« La guerre mondiale fut essentiellement l’oeuvre des hommes d’argent ; que ce sont les hauts industriels des différents Etats de l’Europe qui, tout d’abord, la voulurent, la rendirent nécessaire, la firent, la prolongèrent. Ils en firent leur état, mirent en aile leur fortune, en tirèrent d’immenses bénéfices et s’y livrèrent avec tant d’ardeur, qu’ils ruinèrent l’Europe, se ruinèrent eux-mêmes et disloquèrent le monde. [...] Ainsi, ceux qui moururent dans cette guerre ne surent pas pourquoi ils mourraient. Il en est de même dans toutes les guerres. Mais non pas au même degré. Ceux qui tombèrent à Jemmapes ne se trompaient pas à ce point sur la cause à laquelle ils se dévouaient. Cette fois, l’ignorance des victimes est tragique. On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour les industriels.
Ces maîtres de l’heure possédaient les trois choses nécessaires aux grandes entreprises modernes : des usines, des banques, des journaux. Michel Corday nous montre comment ils usèrent de ces trois machines à broyer le monde. »
134. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 16 mai 2015, 08:09, par Robert
Anatole France :
« Que notre espèce soit destinée à s’entre-détruire jusqu’à sa fin, ou proche ou lointaine, que la guerre dure autant que l’humanité, rien ne le prouve, et la considération du passé donne à croire, au contraire, que la guerre n’est pas une des conditions essentielles de la vie sociale. »
135. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 mai 2015, 06:27, par R.P.
Peu avant la première guerre mondiale, l’empire ottoman est particulièrement menacé par les multiples révoltes et révolutions, à la fois sociales et politiques, au même titre que l’empire russe qui l’est à la fois par la révolution prolétarienne, par la révolte paysanne et des nationalités opprimées par l’empire, prison des peuples.
Avant 1914 et la guerre mondiale, on compte de multiples révoltes et révolutions :
– en avril 1903, c’est la révolte macédonienne
– en 1904-1911, c’est la révolution « jeune turque » qui va jusqu’à déposer Abdul-ul-Hamid et à prendre le pouvoir.
– en 1904-1911, c’est la révolte arabe et albanaise
– en 1907, c’est la révolte yéménite
– en 1907, c’est la jacquerie paysanne en Roumanie, écrasée militairement avec 10.000 morts.
– en octobre 1909, c’est la révolte crétoise
– puis les deux guerres balkaniques et la guerre italo-ottomane
– en 1910-1915, c’est l’armement de la population civile arménienne jusqu’aux massacres de 1915 par l’empire ottoman
Et il faut encore y rajouter la révolte grecque, la révolte bulgare, la révolte serbe et yougoslave, etc…
Se cumulent le nationalisme arabe, le nationalisme panslave, le nationalisme islamique, le nationalisme turc, les nationalismes des nationalités opprimées et le soulèvement social des travailleurs des villes et des campagnes, le mécontentement de la petite bourgeoisie.
Comme la Russie, l’empire ottoman est une bombe prête à exploser. Les rivalités des impérialismes amènent ceux-ci à attiser tous les conflits au lieu de les désamorcer.
136. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 mai 2015, 17:44
Fernand Braudel disait : « On a le droit d’affirmer que l’Occident, en 1914, AUTANT QU’AU BORD DE LA GUERRE, SE TROUVE AU BORD DU SOCIALISME. Celui-ci est sur le point de se saisir du pouvoir et de fabriquer une Europe moderne (...). En quelques jours, en quelques heures, la guerre aura ruiné ces espoirs. » La guerre fut la victoire des capitalistes sur les révolutionnaires et sur le prolétariat.
137. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 25 mai 2015, 11:06
1914-1918, La grande guerre des classes
[Jacques Pauwels]
Et si la Première Guerre mondiale était avant tout la suite meurtrière de la lutte entre ceux d’en haut et ceux d’en bas initiée dès 1789 ? C’est la thèse magistrale du nouveau livre de Jacques Pauwels qui revisite à sa façon les thèses officielles de l’histoire.
L’historien démontre ici que les grandes puissances mondiales voulaient depuis longtemps cette guerre pour s’approprier colonies et autres richesses et écraser les idées révolutionnaires qui gagnaient de plus en plus l’Europe.
édition : décembre 2014
Pour l’acheter voir ici le catalogue de la librairie La Brèche à Paris.
138. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 mai 2015, 11:13, par Robert Paris
En juillet 1917, Louis Guilloux écrit dans la revue Empédocle :
« Les temps étaient encore tout proches des grandes mutineries, et j’avais vu, de mes yeux vu autour de la gare, des scènes d’émeutes. Je savais, et tout le mone savait, comment les permissionnaires dételaient les locomotives, quels chants, quels cris, ils poussaient : « N’allez pas là-bas ! », et j’avais encore dans l’oreille ce grand cri de révolte que les hommes descendant des lignes lançaient à ceux qui y remontaient, et que les mutins avaient partout répandu… Quand la grande nouvelle de la victoire des bolcheviks est arrivée, en pleine guerre, c’était nos rêves qui se réalisaient. »
139. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 mai 2015, 11:29, par Robert Paris
En mai 1917, ce sont les grandes mutineries de l’armée française…
Lors de l’offensive Nivelle d’avril 1917, l’Etat-Major avait promis aux soldats une victoire rapide et le retour des troupes dans leurs foyers. Le résultat a été tout autre : 40.000 morts…
L’offensive ayant été enrayée face aux fortifications allemandes, puis terminée sur ordre du gouvernement fin avril, la déception et la colère grondent : les soldats ont l’impression que la bataille a été mal préparée.
Or début mai, l’ordre est donné de reprendre l’offensive dans les mêmes conditions sur un terrain toujours aussi désavantageux pour les Français. Face à l’entêtement de l’état-major qui souhaite poursuivre cette offensive à outrance, des mutineries éclatent et gagnent progressivement toutes les armées le long du front pendant 8 semaines. Par leur paroxysme, elles touchent 68 divisions sur les 110 qui composent l’Armée française.
Les mutineries se manifestèrent essentiellement par des refus de certains soldats de plusieurs régiments de monter en ligne. Ces soldats acceptaient de conserver les positions, mais refusaient de participer à de nouvelles attaques ne permettant de gagner que quelques centaines de mètres de terrain sur l’adversaire et demandaient des permissions. Ces refus d’obéissance s’accompagnèrent de manifestations bruyantes, au cours desquelles les soldats exprimaient leurs doléances et criaient de multiples slogans dont le plus répandu est « À bas la guerre ».
Le 4 mai 1917, 40.000 soldats font acte de désobéissance. Le 15 mai, le générale Nivelle est démis de ses fonctions et remplacé par Pétain qui réprime. 554 soldats sont condamnés à mort…
Toutefois, le pic d’intensité des mutineries se situe entre le 20 mai et le 10 juin, soit après la nomination du général Pétain (15 mai 1917). Les mesures prises par celui-ci pour mettre fin aux mutineries mettent donc environ un mois à faire leur effet.
Environ 3 500 condamnations, en rapport avec ces mutineries, furent prononcées par les conseils de guerre avec une échelle de peines plus ou moins lourdes. Il y eut entre autres 1381 condamnations aux travaux forcés ou à de longues peines de prison et 554 condamnations à mort dont 49 furent effectives parmi lesquelles 26 l’ont été pour actes de rébellion collective commise en juin ou juillet 1917.
Le nombre des exécutions de 1917, souvent mis en avant lorsque l’on parle des fusillés pour l’exemple reste relativement faible rapporté au nombre de fusillés des derniers mois de 1914 (près de 200) ou de l’année 1915 (environ 260).
Les morts ne se limitent pas aux exécutés ni les condamnations aux seules exécutions. Il ya eu des soldats fusillés au front et des soldats envoyés au front ou en patrouille pour y mourir… Le traitement des mutineries par la hiérarchie a comporté bien d’autres mesures : soldats dégradés, emprisonnés, envoyés à une mort certaine dans des assauts impossibles…
Peut-être les soldats français ont-ils été influencés par l’exemple des soldats russes qui combattaient à leurs côtés. En effet, les survivants des 20 000 soldats de deux brigades russes, venues sur le front français en mars 1916, refusent de continuer le combat après l’offensive Nivelle et de nombreuses pertes.
Prudemment, l’état-major français les confine dans un camp à l’arrière où ils vont fêter le 1er mai. Puis, expédiés dans le camp de La Courtine dans la Creuse, les mutins russes décident de renvoyer leurs officiers et de s’autogérer notamment en élisant leurs représentants. Ceux-ci vont mener pendant trois mois les négociations avec les autorités russes du gouvernement provisoire qui refusent leur retour vers leur pays.
Finalement, l’assaut est donné le 16 septembre par des troupes françaises contre les soldats russes insurgés. Les combats font près de 200 morts chez les insurgés. Les brigades russes révoltées seront dissoutes et leurs dirigeants arrêtés. Après la Révolution d’Octobre et la Paix de Brest-Litovsk, il est encore moins question de les rapatrier. On leur ordonne d’intégrer des compagnies de travail. Ceux qui refusent seront envoyés dans des camps disciplinaires en Algérie. Les premiers soldats ne rentrent en Russie que fin 1919.
Une mutinerie comptant jusqu’à 1000 soldats a duré quelques jours dans le camp d’Étaples sur le littoral français du Pas-de-Calais, et a été vite réprimée en 1917. Ce camp a accueilli jusqu’à 80 000 soldats anglais et du Commonwealth pour les préparer aux rigueurs du front. Un sous-officier a été fusillé pour son rôle dans la mutinerie, un des trois soldats britanniques fusillés pour cette infraction dans le front de l’Ouest pendant la guerre. L’armée britannique et française conviendront de garder le secret sur cette affaire jusqu’en 2017, date à laquelle les archives britanniques devraient être ouvertes.
140. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 31 mai 2015, 07:06, par R.P.
Jean Jaurès lit au congrès du parti socialiste du 16 juillet 1914 la motion dont voici un extrait :
« Les guerres ne cesseront complètement qu’avec la disparition de la société capitaliste […]. Entre tous les moyens employés pour prévenir et empêcher la guerre et pour imposer aux gouvernements le recours à l’arbitrage, le Congrès considère comme particulièrement efficace, la grève générale ouvrière simultanément et internationalement organisée dans les pays intéressés, ainsi que l’agitation et l’action populaire sous les formes les plus actives. »
141. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er juin 2015, 08:14, par Robert Paris
La trahison de 1914, ce n’est pas seulement celle de la social-démocratie.
Les syndicats portent une lourde part de responsabilité dans la grande trahison de 1914 lorsque la social-démocratie a soutenu la Première Guerre mondiale. Ils ont aussi rejeté le soulèvement de novembre 1918 et la Révolution russe d’Octobre 1917. Plus tard, ils utilisèrent les crimes des staliniens pour justifier leur anticommunisme et leur soutien au capitalisme, alors que ce dernier n’avait pas attendu la naissance de l’Etat ouvrier des soviets.
142. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 juin 2015, 07:44
Août 1914,
Comme une traînée de poudre, un mot terrible passe de bouche en bouche : « La guerre ! ».
Les petites affiches de mobilisation sont collées sur les murs des mairies et des bureaux de postes, les cloches sonnent à toute volée, les tambours des appariteurs battent dans les villages.
C’est la guerre !
Triste nouvelle pour les familles ouvrières, mais bonne aubaine pour d’autres.
La guerre, c’est la naissance de fortunes fabuleuses, c’est la production d’engins de mort vendus au prix fort.
La guerre, c’est le « patriotisme » d’affaires, les combines malpropres, les millions récoltés dans le sang ; ce sont les champs de Javel où l’on voit se dresser une usine formidable qui fabriquera journellement 20.000 obus, l’usine Citroën.
La guerre, c’est pour Renault l’occasion de se hisser jusqu’aux cimes de la production française.
Dix-huit ans d’exploitation ouvrière avaient fait prospérer le modeste atelier de 300 mètres carrés.
Il y avait maintenant sept usines couvrant un espace d’environ 10 hectares. La plus-value produite par les milliers d’ouvriers avait permis à Renault d’agrandir son exploitation dans une proportion de 34%.
La situation des ouvriers avait-elle « prospéré » en proportion ?
Non ! Au contraire, la puissance d’achat des salaires avait diminué, les vivres augmenté. Parallèlement à l’accroissement de la fortune et du bénéfice du « Seigneur de Billancourt », nous assistons à l’aggravation des conditions des ouvriers.
Au début du mois d’août 1914, les usines Renault fermaient leurs portes. Elles ne gardaient que le personnel de maîtrise (contremaîtres, chefs d’atelier, directeurs de service).
143. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 juin 2015, 07:46
Ouvriers et employés mobilisables durent répondre à l’ordre de mobilisation.
Ces départs eurent pour Renault un grand avantage : ils lui permirent une transformation radicale de son personnel, tel qu’il n’aurait même pas osé le concevoir au moment où il faisait des coupes sombres.
Après quelques jours, les usines ouvrirent à nouveau leurs portes.
La journée de huit heures fut appliquée, mais… les salaires furent fortement rognés. En temps de guerre, n’est-ce pas, les ouvriers doivent savoir faire des « sacrifices » ! Le travail aux pièces fut remplacé par le travail à l’heure avec un minimum de production. Et là où les manœuvres spécialisés gagnaient 1 fr. à 1 fr.10, ils ne devaient plus gagner (en faisant le même travail) qu’un salaire horaire de 0 fr.50.
Il en fut de même pour les professionnels. Leurs salaires, qui étaient de 1 fr.20, 1 fr.40, tombèrent à 0 fr.75, à 1 franc.
Les ouvriers furent mis à la disposition de Renault par l’autorité militaire. Les salaires remontèrent un peu. Les manœuvres spécialisés gagnèrent 0 fr. 75 ; les professionnels 1 franc. Par contre, la journée de huit heures disparut comme par enchantement. Les journées de travail furent longues et pénibles. Il n’était pas rare de travailler onze, douze et même quatorze heures par jour !
Une plus grande proportion de main-d’œuvre féminine fut embauchée. Elle était surtout composée de femmes ou filles d’ouvriers mobilisés.
La rentrée aux usines Renault
Ces femmes durent exécuter le travail de manœuvres spécialisés pour un salaire bien au-dessous de celui que touchaient ceux qu’elles remplaçaient. Elles étaient payées 0 fr. 35 à 0 fr. 50 de l’heure, et, vers la fin de 1916, leur salaire atteignit environ 0 fr. 70 de l’heure.
Le coût de la vie avait par contre augmenté considérablement. Les marchandises étaient hors de prix, il fallait se sous-alimenter pour vivre et envoyer quelques sous au mari, qui se trouvait dans les tranchées.
Cela dura jusqu’à la grève des bras croisés dans la métallurgie parisienne, en septembre 1917. L’objectif de cette grève fut l’augmentation des salaires. Elle fut de courte durée.
Les journaux firent autour d’elle une conspiration du silence, et ce ne fut que lorsqu’elle fut liquidée qu’un unique article indiquant la fin du conflit paru dans divers journaux.
Pendant ce temps, les bénéfices s’accumulaient, s’enflaient démesurément.
Un officier de contrôle des fabrications de guerre affirma, en 1918, que les bénéfices nets accusés par la direction s’élevaient à 280.000 francs par jour, soit 104 millions dans l’année. Encore faut-il, pour avoir le chiffre exact, ajouter le prix des travaux neufs, l’outillage exécuté ou acquis au cours de l’année, ainsi que les amortissements.
Les usines continuèrent à se développer.
En 1914, à l’ouverture de la guerre impérialiste, nous avons vu qu’elles s’étendaient sur 10 hectares.
En 1919, elles atteignaient 60 hectares. Elles avaient quintuplé en cinq ans !
Les différentes usines avaient été groupées en une seule, à la suite de la fermeture de plusieurs rues de la ville. Renault avait obtenu pour cette affaire le concours du social-chauvin Albert Thomas, qui dirigeait pour le compte de l’impérialisme français, la fabrication des munitions sur le territoire.
Cette opération de regroupement des usines fut faite en juin 1917. Quelques jours avant sa réalisation, un immense bâtiment en ciment armé, charpente métallique, haut de trois étages, s’effondrait.
Le nombre des victimes ouvrières fut considérable. Mais la presse aux ordres du capital se tut, et la justice ne poursuivit personne, ni Renault ni le constructeur du bâtiment.
Retranché derrière ses capitaux accumulés, la boutonnière ornée du chiffon rouge, couleur du sang des prolétaires tués sur le champ de carnage ou sous l’amas de béton et de ferraille de l’usine écroulée, M. Louis Renault pouvait penser que pour lui la guerre était une bonne chose, une excellente affaire.
HENAVENT
144. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 26 juin 2015, 10:51, par R.P.
« Tout le mouvement ouvrier est impliqué dans le mot d’ordre de guerre à la guerre, impliqué à la hauteur de sa force et de son influence. (…) N’est-il pas clair comme la vie que nulle insurrection de la classe ouvrière, nulle grève générale, nul soulèvement généralisé de la classe ouvrière européenne n’occasionnerait ou n’entraînerait un plus grand massacre de socialistes que ne le fera leur participation comme soldats aux campagnes des armées de leurs pays respectifs. Chaque obus qui explose au milieu d’un bataillon allemand tuera des socialistes ; chaque charge de cavalerie autrichienne laissera sur le sol les corps tordus d’agonie de socialistes serbes ou russes ; chaque navire russe, autrichien ou allemand envoyé par le fond ou explosé jusqu’au ciel signifie chagrin et deuil dans les foyers de camarades socialistes. Si ces hommes doivent mourir, ne vaudrait-il pas mieux qu’ils meurent dans leur pays en combattant pour la liberté de leur classe, et pour l’abolition de la guerre, que d’aller dans des pays étrangers mourir en massacrant et massacré par ses frères pour que puissent vivre des tyrans et des profiteurs ? »
James Connoly, lors de la déclaration de la première guerre mondiale, « Une révolution à l’échelle d’un continent », 15 août 1914
145. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 27 juin 2015, 08:41, par R.P.
« Quand un fantassin français vide le chargeur de son fusil meurtrier dans les rangs de la ligne d’attaque allemande, pourra-t-il se réconforter de la probabilité que ses balles tuent et mutilent des camarades qui encore l’année dernière se rassemblaient dans les « hourras ! » et les « bravo ! » pour l’éloquent Jaurès, venu à Berlin pour plaider en faveur de la solidarité internationale ? (…) N’est-il pas limpide comme une chose naturelle de la vie qu’aucune insurrection de la classe ouvrière, aucune grève générale, aucun soulèvement des forces du mouvement ouvrier en Europe, ne pourrait impliquer et susciter un plus grand massacre de socialistes que ne le fera leur participation en tant que soldats aux campagnes des armées de leur pays respectifs ? (…) Croyant, comme je le fais, que serait justifiée toute action qui mettrait fin à ce crime colossal que l’on perpètre aujourd’hui, je me sens obligé d’exprimer l’espoir qu’avant peu nous pourrons lire que les services de transport auront été paralysés sur le continent, même si cette paralysie nécessite l’érection de barricades socialistes et de mutineries des soldats et des marins socialistes, comme cela s’est produit en Russie en 1905. Même une tentative sans succès de révolution sociale par la force des armes, entraînant la paralysie de la vie économique du militarisme, serait moins désastreuse pour la cause socialiste que le fait que des socialistes se permettent d’être utilisés dans le massacre de leurs frères pourtant engagés dans une cause commune. »
James Connolly, dans le journal Forward, 15 août 1914.
146. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 6 juillet 2015, 15:45
Petite chronologie de Renault pendant la première guerre mondiale :
1912-1913 : Premières grèves contre l’introduction du chronométrage
1914-1918 : Première Guerre Mondiale.
Renault se convertit à l’industrie de guerre
25 août 1914 : Devant la menace allemande sur Paris, les usines Renault sont déménagées à Lyon, dans des locaux loués à Rochet-Schneider, 50 ouvriers sont maintenus à Billancourt pour produire les moteurs d’avions destinés à l’Armée, le reste de l’usine est fermé
1 août 1915 : Les ouvriers tronçonneurs, mécontent des baisses de 0,12 f des salaires horaires manifestent. Les trois délégués sont licenciés
1916 : Trente-huit ouvriers entament une grève pour demander une augmentation de salaire. Licenciement de trente-cinq grévistes.
25 juin 1916 : Des ouvriers militaires obtiennent un jour de repos par semaine au lieu d’un jour par mois
1 mai 1917 : Un restaurant géré par la coopérative pour la consommation des usines Renault est ouvert rue du Point du Jour
29 mai 1917 : Une partie des femmes employées chez Salmson (rue du Point du Jour) envahissent les usines Renault et débauchent la moitié des femmes. La perturbation durera jusqu’au 11 juin
13 juin 1917 : Un côté du bâtiment C4 s’effondre, tuant soixante personnes et blessant soixante autres. Cinq jours de grèves s’en suivent
9 au 18 mai 1918 : Grève dans les usines Renault
1 août 1918 : Parution du bulletin des Usines Renault destiné aux Agents de maîtrise
1924 : Première implantation d’une cellule du Parti Communiste
1925 : La première usine Renault est installée sur l’Ile Séguin
12 février 1934 : Renault est en grève. Deux ouvriers sont tués lors de l’intervention des forces de police à Billancourt
1 mai 1936 : Fermeture de l’usine pour cause de grève
28 mai 1936 : Grève et occupation des usines. Le travail reprend le 2 juin pour cesser à nouveau le 4. Le retour au travail s’opère le 13 juin
17 juillet 1936 : Nationalisation des ateliers de chars Renault
24 novembre 1938 : Occupation des usines en grèves. Mille huit cents ouvriers sont licenciés
147. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 juillet 2015, 12:07
La guerre c’est la dictature… même dans les pays dits démocratiques.
Citons des exemples…
Le soldat Berspt est le symbole de cette effroyable justice militaire qui ’fusillait pour avoir refusé de mettre un pantalon sale.
Citons-en un au hasard qui s’est retrouvé sous le ciel de feu de Cayenne, est sous le joug de la chiourme, sans même savoir bien pourquoi c’est Cheikhou Cissé, tirailleur sénégalais, deux fois blessé, croix de guerre. Un jour de novembre 1916 en plein Soudan, sa compagnie refuse de travailler lés terres de grands propriétaires elle se mutine, veut revenir dans son pays, Gheikou est condamné à mort la peine commuée en détention perpétuelle, il est jeté au bagne. d’Alger, puis transporté à Cayenne « par erreur », devait écrire le ministre des colonies Envoyé à Nouméa, l’autre bout du monde,
Il y a aussi les condamnés de la guerre. Les uns sont à Cayenne. Certains mènent une vie de bêtes, traquées dans tous les pays d’Europe. Et cependant les noms de Souain, de Vingré, de Flirey n’ont pas été totalement oubliés. Les. lieutenants Harduin et Millan sont réhabilités. Après avoir été fusillés sans jugement.
148. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 29 juillet 2015, 11:58, par alex
Sur les causes de la guerre 1914-1918, la caracterisation de Karl Liebknecht dans sa declaration au Reichstag le 2 decembre 1914 (motivant son refus de voter les credits de guerre) me parait s’appliquer aussi a la situation d’aujourd’hui :
Le texte complet et d’autres textes se trouvent dans le Cahier du CERMTRI numero 153.
149. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 15 septembre 2015, 05:31, par Robert
On a dit aux peuples qu’en entrant dans la guerre mondiale, ils luttaient pour la démocratie, pour leur propre défense derrière des frontières (la "défense nationale"), pour la paix et que l’Etat les lançait dans cette guerre dans leur propre intérêt.
Rappelons-nous tous ces mensonges grossiers car ils vont bientôt recommencer.
La guerre n’est qu’une expression du caractère violent de la lutte des classes suit à la crise du système capitaliste. Le bain de sang est choisi par les classes dirigeantes pour détourner de la révolution sociale et tenter de l’éviter.
En période de grands bouleversements subis par le système d’exploitation, il n’y a qu’une alternative : révolution sociale ou guerre.
150. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 septembre 2015, 08:05
Lire ici :
Un exemple de la propagande militariste française anti-allemande
151. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er novembre 2015, 06:24, par R.P.
Lénine écrit dans sa Résolution pour la Conférence internationale des femmes socialistes, Berne 26-28 mars 1915 :
« Non seulement cette guerre ne sert pas les intérêts des ouvriers, mais elle est une arme dont usent les classes dirigeantes pour briser la solidarité prolétarienne internationale, et pour affaiblir le mouvement ouvrier et la lutte de classe à l’intérieur de chaque pays. »
Et Lénine rajoute :
« En prenant l’initiative d’organiser des manifestations révolutionnaires, en marchant la main dans la main avec le prolétariat, les ouvrières ont la possibilité d’ouvrir une nouvelle ère dans la lutte prolétarienne, au cours de laquelle le prolétariat des pays avancés parviendra à la conquête du socialisme, et celui des pays arriérés à la conquête de la république démocratique. »
On remarquera que c’est exactement ce qui s’est produit en Octobre 1917 !...
152. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 21 février 2016, 12:43
Il y a cent ans, c’était l’enfer à Verdun et pas que là !!!
153. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er mars 2016, 09:57
" Sans s’exagérer la puissance de la Seconde Internationale à partir de 1901, on a le droit d’affirmer que l’Occident, en 1914, autant qu’au bord de la guerre, se trouve au bord du socialisme. Celui-ci est sur le point de se saisir du pouvoir, de fabriquer une Europe aussi moderne, et plus peut-être qu’elle ne l’est actuellement. En quelques jours, en quelques heures, la guerre aura ruiné ces espoirs. C’est une faute immense pour le socialisme européen de cette époque que de n’avoir pas su bloquer le conflit."
Fernand Braudel
154. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er mars 2016, 09:59
« A partir de l’automne de 1914, en dépit de toutes les prédictions officielles, nous répétâmes, de jour en jour, dans notre journal, que la guerre durerait à n’en plus finir et que toute l’Europe en sortirait brisée. Des dizaines de fois nous écrivîmes, dans Naché Slovo, que, même en cas de victoire des Alliés, la France, après la guerre, lorsque les fumées et les gaz se seraient dissipés, se trouverait, sur l’arène internationale, dans la situation d’une grande Belgique, simplement. Nous prévîmes avec certitude la dictature mondiale des États-Unis qui s’annonçait. "L’impérialisme, écrivions-nous pour la centième fois, le 5 septembre 1916, par cette guerre, mise sur les forts ; c’est à eux qu’appartiendra le monde."
Paris se vidait de plus en plus. Les horloges de la ville s’arrêtaient les unes après les autres. Le Lion de Belfort avait, on ne savait pourquoi, de la paille sale dans la gueule. La guerre continuait à s’enterrer dans les tranchées. Sortir de là, sortir des trous, du marasme, de l’immobilité, - tel était le cri des patriotes. Du mouvement ! du mouvement ! C’est ainsi qu’on en arriva aux terribles folies des batailles de Verdun. En ces journées-là, me démenant sous les foudres de la censure de guerre, j’écrivis dans Naché Slovo :
"Si grande que soit l’importance militaire des combats de Verdun, leur portée politique est infiniment plus grande. A Berlin et en d’autres lieux (sic) on a voulu du "mouvement" : ils l’auront. Chut ! Sous Verdun, on forge notre journée de demain." »
Trotsky, Ma Vie
155. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er mars 2016, 10:01
" La guerre mondiale fut essentiellement l’œuvre des hommes d’argent ; que ce sont les hauts industriels des différents États de l’Europe qui, tout d’abord la voulurent, la rendirent nécessaire, la firent, la prolongèrent. Ils en firent leur état, mirent en elle leur fortune, en tirèrent d’immenses bénéfices et s’y livrèrent avec tant d’ardeur, qu’ils ruinèrent l’Europe, se ruinèrent eux-mêmes et disloquèrent le monde."
" Ainsi, ceux qui moururent dans cette guerre ne surent pas pourquoi ils mouraient. Il en est de même dans toutes les guerres. Mais non pas au même degré. Ceux qui tombèrent à Jemmapes ne se trompaient pas à ce point sur la cause à laquelle ils se dévouaient. Cette fois, l’ignorance des victimes est tragique. On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels.
Ces maîtres de l’heure possédaient les trois choses nécessaires aux grandes entreprises modernes : des usines, des banques, des journaux. »
Lettre d’Anatole France dans l’Humanité du 18/07/1922
156. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er mars 2016, 10:04
« 14-18, c’était déjà une guerre du fric. Non seulement chez les « méchants » (Allemagne, Autriche), mais aussi chez les « gentils (France, Angleterre, Belgique...), le véritable enjeu était :quelle puissance dominera le monde et contrôlera ses richesses ? C’était aussi une guerre des classes dominantes contre les pauvres, contre leurs propres travailleurs exterminés froidement. »
Jacques Pauwels, 14-18, une guerre de classe
157. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er mars 2016, 12:38
" Cinq mois se sont écoulés depuis la Conférence de Zimmerwald où nous, socialistes d’Europe, avons lancé un cri d’indignation et d’appel. Cinq nouveaux mois de guerre ont passé, l’un après l’autre, sur l’humanité, et chacun de ces mois a vu les peuples acharnés à poursuivre leur propre extermination, leur propre ruine au milieu des carnages, supportant sans révolte l’œuvre hideuse d’un militarisme déchaîné qui ne peut plus être maîtrisé par les mains sanglantes des maîtres actuels des nations d’Europe. L’extermination automatique de la fleur des peuples a poursuivi sa voie durant ces longs mois. De nouveaux milliards, par dizaines, extraits de la richesse collective par des emprunts de guerre ont été engloutis, consacrés exclusivement à la destruction de vies humaines et des conquêtes de la civilisation.
Si le cerveau humain travaille encore dans ce cercle infernal, ce n’est plus pour perfectionner et inventer des engins d’extermination. Le problème qui préoccupe actuellement les dirigeants, les savants, les inventeurs de tous les pays, consiste à trouver le moyen d’anéantir des armées entières au moyen de gaz empoisonnés. Mais les porte‑parole des classes dirigeantes stupidement obstinées ou ivres de sang, ne cessent de répéter que la guerre doit être menée « jusqu’au bout », jusqu’à la victoire complète, jusqu’à ce que la guerre ait trouvé la solution de toutes les questions qui l’ont provoquée. Cependant, en fait, la solution définitive s’éloigne de plus en plus, les opérations militaires s’étendent sur de nouveaux fronts et sur de nouveaux territoires, et chaque nouveau développement a pour conséquence et pour caractéristique l’enchevêtrement de problèmes nouveaux en même temps qu’il ravive d’anciennes plaies."
Léon Trotsky
"Projet de manifeste pour la Conférence de Kienthal" - Janvier 1916
158. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 8 mars 2016, 15:57
Dans la Grammaire des Civilisations (1963), Fernand Braudel écrit :
« On a le droit d’affirmer que l’Occident, en 1914, AUTANT QU’AU BORD DE LA GUERRE, SE TROUVE AU BORD DU SOCIALISME. Celui-ci est sur le point de se saisir du pouvoir et de fabriquer une Europe moderne (...). En quelques jours, en quelques heures, la guerre aura ruiné ces espoirs. »
1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er avril 2016, 12:31, par Marcel
Bonjour je cherche des réponces que je ne connais pas sur la premiere guerre mondiale alors pouvez-vous m’aidez sil vous plais ?Merci
Bonne journée
2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er avril 2016, 14:04, par Robert Paris
sans problème mais quelles sont les questions ?
159. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 20 septembre 2016, 12:54, par R.P.
Lire aussi : La théorie marxiste et les origines de la Première Guerre mondiale
160. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 20 septembre 2016, 12:56, par R.P.
Lire encore : 1914-1918 : La Grande Guerre des classes
161. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 4 novembre 2016, 05:58
François Hollande et la première guerre mondiale : lire ici
162. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 6 février 2017, 09:08
Le "pourquoi" de la guerre inter-impérialiste est resté longtemps caché !
« Dans toute question d’importance, il y a des aspects que personne ne souhait aborder. »
George Orwell
163. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 25 mars 2017, 06:26
Aussi longtemps que resteront intacts les fondements des rapports sociaux actuels, c’est-à-dire bourgeois, la guerre impérialiste ne peut conduire qu’à une paix impérialiste, c’est-à-dire à renforcer, à étendre et intensifier l’oppression des nations et des pays faibles par le capital financier, qui a grandi d’une façon prodigieuse non seulement avant, mais aussi pendant cette guerre. Le contenu objectif de la politique poursuivie avant et pendant la guerre par la bourgeoisie et les gouvernements des deux groupes de grandes puissances mène au renforcement de l’oppression économique, de l’asservissement national, de la réaction politique. C’est pourquoi la paix qui terminera cette guerre, quelle qu’en soit l’issue, ne peut que consacrer cette aggravation de la situation économique et politique des masses, pour autant que subsiste le régime social bourgeois.
Admettre qu’une paix démocratique puisse découler d’une guerre impérialiste, c’est, sur le plan théorique, substituer une platitude à l’étude historique de la politique pratiquée avant et pendant cette guerre ; et c’est, sur le plan pratique, tromper les masses populaires en obscurcissant leur conscience politique, en camouflant et exaltant la politique réelle des classes dominantes qui prépare la paix à venir, en dissimulant aux masses l’essentiel, à savoir : l’impossibilité d’une paix démocratique sans une série de révolutions.
Lénine
164. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 avril 2017, 11:53
Oui, souvenons-nous des horreurs, de la boucherie du chemin des dames, mais pas à la manière de Hollande qui en tire comme le leçon qu’il ne faut condamner personne, même pas les criminels qui ont ordonné ça, même pas les classes dirigeantes européennes qui ont programmé la tuerie générale !!!
165. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 8 juin 2017, 15:37, par R.P.
Oui, le mouvement ouvrier montait avant 1914…
Sur la grève de masse en Grande-Bretagne et en Irlande (1910-1914) : lire ici
Sur la grève Renault de 1913 : Lire ici
Sur la grande grève de Dublin en 1913 : Lire ici
Sur la grève générale belge de 1913 : Lire ici
Grève à Liège
Sur la révolution Mexicaine en 1913 (tentative contre-révolutionnaire de Huerta) : Lire ici
Russie : 1912 grèves de la Lena, grèves en juin 1913 et en 1914 des mouvements massifs de grèves en Russie (1,75 million de grévistes), radicalisation en faveur des Bolcheviks
Sur la grève du charbon du Colorado en 1913-1914 aux USA : Lire ici
En 1913, les femmes sont partout en lutte, radicale, et en Norvège, les femmes obtiennent le droit de vote : Lire ici
etc, etc....
166. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 4 septembre 2017, 09:15
Les révolutionnaires de la social-démocratie face à la première guerre mondiale :
Lénine
Trotsky
Rosa Luxemburg
167. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 4 décembre 2017, 06:43
Lire aussi : guerre à la guerre
en cliquant ici
168. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 26 janvier 2018, 07:29
Explication de Trotsky au troisième Congrès de l’Internationale communiste (troisième internationale) :
« Le capitalisme est entré dans une période de dépression profonde et prolongée. A proprement parler, cette époque aurait dû commencer – dans la mesure où l’on peut prophétiser à propos du passé – dès 1913, lorsque le marché mondial, à la suite de vingt années de développement tumultueux, était déjà devenu inadéquat pour le développement du capitalisme allemand, anglais et nord-américain. »
169. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 30 janvier 2018, 17:36, par Robert Paris
La première guerre mondiale n’était nullement un événement inattendu, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle avait été préparée et même plusieurs fois, par les classes dirigeantes, à la fois sur le terrain social, politique et militaire :
– 1907 : panique boursière aux USA, crise qui s’étend mondialement
– 1907 : guerre des USA au Honduras
– 1907 : Grandes grèves ouvrières au Chili, au Mexique, émeute paysanne en Roumanie et grève estudiantine au Portugal
– 1907 : vague de grèves au Japon
– 1907 : révolte yéménite
– 1908 : la révolution monte en Turquie et en Iran
– 1908 : guerre coloniale de la France en Côte d’Ivoire
– 1908-1909 : confrontation coloniale franco-allemande sur le Maroc
– 1908-1909 : confrontation entre puissances européennes à propos de la possession de la Bosnie-Herzégovine
– 1909 : annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie
– 1909 : massacres d’Arméniens de Cilicie par l’empire Ottoman
– 1909 : guerre entre troupes coloniales espagnoles et guérilla du Rif
– 1909-1910 : séries de grandes grèves (cheminots, postiers, dockers…) en France
– 1910 : vague de grèves en Allemagne (mines, bâtiment, etc.)
– 1910 : montée ouvrière en Espagne
– 1910-1914 : vagues successives de grèves massives en Grande Bretagne et en Irlande
– 1911 : révolte ouvrière contre la vie chère en Autriche
– 1911 : grève générale insurrectionnelle à Liverpool (Grande Bretagne)
– 1911 : révolution et guerre au Mexique
– 1911 : guerre américaine au Honduras
– 1911-1912 : grèves en France
– 1911-1912 : guerre italo-ottomane
– 1911-1912 : première guerre balkanique, 75.000 morts
– 1911 : expédition coloniale italienne en Tripolitaine (Libye)
– 1911-1912 : révolution chinoise
– 1912 : guerre civile en Irlande
– 1912 : grève générale et émeutes à Budapest
– 1912 : Monténégro, Bulgarie, Serbie, Grèce déclarent la guerre à l’empire Ottoman
- 1912 : massacre d’ouvriers en Russie
– 1912 : guerre du Contestado au Brésil
– 1912 : grève générale au Portugal
– 1912 : soulèvement au Nicaragua
– 1912-1913 : grandes grèves aux USA
– 1912-1913 : deuxième guerre balkanique
– 1912 : grève « contre la guerre » menée par la CGT en France
– 1913 : grandes grèves ouvrières en Russie
– 1913 : grève générale en Belgique
– 1913 : la Bulgarie attaque la Serbie et la Grèce
– 1913 : grandes grèves aux USA
– 1913 : grandes grèves ouvrières et préparation de l’insurrection indépendantiste en Irlande
– 1913-1914 : grève générale des mineurs et des cheminots en Afrique du sud
– 1913-1914 : grandes grèves aux USA (Lawrence, Colorado, etc.)
– 1914 : guerre au Mexique
– juin-Juillet 1914 : grèves massives en Russie, avant que ne commence la guerre…
– 1913-1914 : montée ouvrière et débuts révolutionnaires en Italie avant la guerre mondiale
170. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 février 2018, 08:27
« Les conditions de la guerre déforment et obscurcissent l’action des forces intérieures de la révolution. Mais son cours n’en restera pas moins déterminé par ces mêmes forces intérieures, c’est-à-dire les classes. La révolution, qui montait depuis 1912, a vu, dans un premier temps, son élan brisé par la guerre, mais ensuite, grâce à l’intervention héroïque d’une armée exaspérée, elle s’est accélérée dans la combativité sans précédent. »
Léon Trotsky, La farce du double pouvoir, Izvestia, 3 juin 1917, Vperiod, 8 juin 1917
171. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 19 février 2018, 08:29
Léon Trotsky, expliqua la signification historique de la guerre :
« La Guerre proclame la chute de l’Etat nation. Et pourtant, dans le même temps, elle proclame la chute du système d’économie capitaliste...
La Guerre de 1914 est l’effondrement, le plus colossal de l’histoire, d’un système économique détruit par ses propres contradictions internes….
Le capitalisme a crée les conditions matérielles d’un nouveau système économique socialiste. L’impérialisme a conduit les nations capitalistes au chaos historique. La guerre de 1914 montre la voie pour sortir de ce chaos, en poussant avec violence le prolétariat sur la voie de la Révolution. »
172. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 10 mars 2018, 08:02
Au-dessus de la mêlée de Romain Rolland :
lire ici
173. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 30 septembre 2018, 08:57
Il y a 100 ans, l’offensive Meuse-Argonne commençait en France.
174. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er décembre 2018, 07:28
Clemenceau écrit en câble à Rockefeller en 1918 :
"Une goutte de sang vaut une goutte de pétrole."
175. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er décembre 2018, 07:33
Clemenceau à la Chambre des députés en 1918 :
« Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique étrangère ? Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Je cherche à me maintenir en confiance avec nos alliés. La Russie nous trahit ? Je continue à faire la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler ? Je continue à faire la guerre... »
La bourgeoisie a ce type de dirigeants plongeant leurs mains dans le sang et en étant fiers.
Tous les dirigeants actuels de la France impérialiste ont les yeux fixés sur leur ligne "ligne bleu des Vosges" que représente Clemenceau le sanglant !!!!
176. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er décembre 2018, 07:35
Principes élémentaires de propagande de guerre diffusés en 1914-1918
Il faut faire croire :
que notre camp ne veut pas la guerre
que l’adversaire en est responsable
qu’il est moralement condamnable
que la guerre a de nobles buts
que l’ennemi commet des atrocités délibérées (pas nous)
qu’il subit bien plus de pertes que nous
que Dieu est avec nous
que le monde de l’art et de la culture approuve notre combat
que l’ennemi utilise des armes illicites (pas nous)
que ceux qui doutent des neuf premiers points sont soit des traitres, soit des victimes des mensonges adverses (car l’ennemi, contrairement à nous qui informons, fait de la propagande).
177. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 1er décembre 2018, 07:39
La guerre, c’est toujours d’abord la guerre intérieure, la guerre de classes, entre bourgeoisie et prolétariat, celle qui commande d’utiliser la guerre pour museler toute réaction.
Dès le 2 août 1914, tous les départements français (y compris ceux d’Algérie) sont soumis à l’état de siège : les maires et préfets perdent immédiatement leurs pouvoirs de police au profit des autorités militaires. L’armée française peut ainsi interdire les réunions, pratiquer des perquisitions de domicile et faire comparaître des civils devant des tribunaux militaires (avec une procédure très simplifiée et une exécution immédiate de la sentence). La loi du 5 août 1914 prolonge l’état de siège jusqu’à la fin de la guerre, tandis que celle du 27 avril 1916 encadre les crimes passible des tribunaux militaires[12].
Les élections sont suspendues, la majorité du corps électoral, y compris quelques députés, étant sous l’uniforme (les femmes et les militaires n’ont pas le droit de vote sous la Troisième République). La liberté et le secret de la correspondance n’existent plus : le courrier des militaires, systématiquement en retard (rendant inexploitables les indiscrétions éventuelles), est vérifié avant expédition, les lettres pessimistes, défaitistes ou donnant des informations précises sont saisies ou caviardées (lignes raturées) par les services de censure postale.
La liberté de la presse est atteinte par la censure. Sont interdits « les articles de fond attaquant violemment le Gouvernement ou les chefs de l’armée » et ceux « tendant à l’arrêt ou à la suppression des hostilités ». La presse est contrôlée avant impression, les articles jugés peu patriotiques sont interdits à la publication, laissant parfois la place à des rectangles blancs. Et cela jusqu’au 12 octobre 1919.
Interdire les réactions ouvrières, tel est le premier but de la guerre ! Ils font d’abord la guerre à... la révolution sociale !!!
178. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 5 juillet 2019, 05:27
Ce n’était pas la der des der et c’est même la perspective actuelle...
Les bruits de bottes et de canons s’accroissent à mesure que la crise économique se profile et que les prédictions la disent sous forme d’effondrement…
Vladimir Poutine a promulgué ce mercredi une loi autorisant la Russie à s’affranchir du traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI) conclu en 1987. Il ne fait que suivre les Etats-Unis qui ont cessé de le respecter depuis février dernier, Trump en accusant Moscou de l’avoir violé en se dotant d’un nouveau missile, le Novator 9M729 (SSC-8 pour l’Otan), et doivent le dénoncer le 2 août.
179. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 16 septembre 2021, 04:40, par alain
La théorie marxiste et les origines de la Première Guerre mondiale
http://revueperiode.net/la-theorie-marxiste-et-les-origines-de-la-premiere-guerre-mondiale/
180. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 25 octobre 2021, 07:22, par alain
"The Economist" (août – septembre/octobre 1914) prévoyait déjà qu’à la suite de la guerre, dans les pays impliqués, il y aurait un mouvement révolutionnaire social.
181. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 30 octobre 2021, 04:11, par Laurence
Bien avant "the economist", pour Marx, Engels, la première guerre mondiale en Europe n’était nullement une surprise :
https://www.matierevolution.fr/spip.php?article3399