Accueil > 02 - Livre Deux : SCIENCES > Le mathématicien Grothendieck est mort
Le mathématicien Grothendieck est mort
vendredi 14 novembre 2014
Grothendieck raconté par lui-même
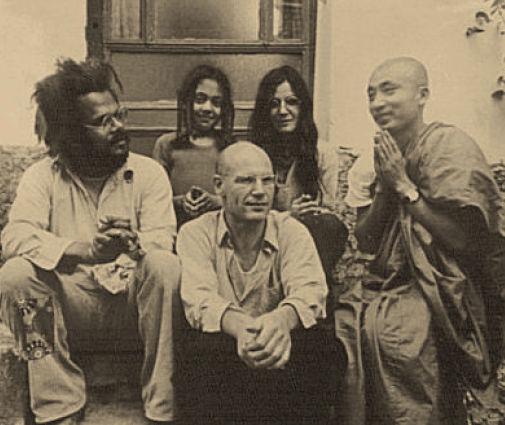
Les dérives de la « science officielle »
Je suis sensible à l’honneur que me fait l’Académie royale des sciences de Suède en décidant d’attribuer le prix Crafoord pour cette année, assorti d’une somme importante, en commun à Pierre Deligne (qui fut mon élève) et à moi-même. Cependant je suis au regret de vous informer que je ne souhaite pas recevoir ce prix (ni d’ailleurs aucun autre), et ceci pour les raisons suivantes.
1) Mon salaire de professeur, et même ma retraite à partir du mois d’octobre prochain, est beaucoup plus que suffisant pour mes besoins matériels et pour ceux dont j’ai la charge ; donc je n’ai aucun besoin d’argent. Pour ce qui est de la distinction accordée à certains de mes travaux de fondements, je suis persuadé que la seule épreuve décisive pour la fécondité d’idées ou d’une vision nouvelle est celle du temps. La fécondité se reconnaît à la progéniture, et non par les honneurs.
2) Je constate par ailleurs que les chercheurs de haut niveau auxquels s’adresse un prix prestigieux comme le prix Crafoord sont tous d’un statut social tel qu’ils ont déjà en abondance et le bien-être matériel et le prestige scientifique, ainsi que tous les pouvoirs et prérogatives qui vont avec. Mais n’est-il pas clair que la surabondance des uns ne peut se faire qu’aux dépens du nécessaire des autres ?
3) Les travaux qui me valent la bienveillante attention de l’Académie royale datent d’il y a vingt-cinq ans, d’une époque où je faisait partie du milieu scientifique et où je partageais pour l’essentiel son esprit et ses valeurs. J’ai quitté ce milieu en 1970 et, sans renoncer pour autant à ma passion pour la recherche scientifique, je me suis éloigné intérieurement de plus en plus du milieu des scientifiques.
Or, dans les deux décennies écoulées l’éthique du métier scientifique (tout au moins parmi des mathématiciens) s’est dégradée à un degré tel que le pillage pur et simple entre confrères (et surtout aux dépens de ceux qui ne sont pas en position de pouvoir se défendre) est devenu quasiment une règle générale, et qu’il est en tout cas toléré par tous, y compris dans les cas les plus flagrants et les plus iniques.
Dans ces conditions, accepter d’entrer dans le jeu des prix et des récompenses serait aussi donner ma caution à un esprit et à une évolution, dans le monde scientifique, que je reconnais comme profondément malsains, et d’ailleurs condamnés à disparaître à brève échéance tant ils sont suicidaires spirituellement, et même intellectuellement et matériellement.
C’est cette troisième raison qui est pour moi, et de loin, la plus sérieuse. Si j’en fais état, ce n’est nullement dans le but de critiquer les intentions de l’Académie royale dans l’administration des fonds qui lui sont confiés. Je ne doute pas qu’avant la fin du siècle des bouleversements entièrement imprévus vont transformer de fond en comble la notion même que nous avons de la « science », ses grands objectifs et l’esprit dans lequel s’accomplit le travail scientifique. Nul doute que l’Académie royale fera alors partie des institutions et des personnages qui auront un rôle utile à jouer dans un renouveau sans précédent, après une fin de civilisation également sans précédent…
Je suis désolé de la contrariété que peut représenter pour vous-même et pour l’Académie royale mon refus du prix Crafoord, alors qu’il semblerait qu’une certaine publicité ait d’ores et déjà été donnée à cette attribution, sans l’assurance au préalable de l’accord des lauréats désignés. Pourtant, je n’ai pas manqué de faire mon possible pour donner à connaître dans le milieu scientifique, et tout particulièrement parmi mes anciens amis et élèves dans le monde mathématique, mes dispositions vis-à-vis de ce milieu et de la « science officielle » d’aujourd’hui.
Il s’agit d’une longue réflexion, Récoltes et Semailles, sur ma vie de mathématicien, sur la création (et plus particulièrement la création scientifique) en général, qui est devenue en même temps, inopinément, un « tableau de mœurs » du monde mathématique entre 1950 et aujourd’hui. Un tirage provisoire (en attendant sa parution sous forme de livre), fait par les soins de mon université en deux cents exemplaires, a été distribué presque en totalité parmi mes collègues mathématiciens, et plus particulièrement parmi les géomètres algébristes (qui m’ont fait l’honneur de se souvenir de moi). Pour votre information personnelle, je me permet de vous en envoyer deux fascicules introductifs, sous une enveloppe séparée.
Alexandre Grothendieck
Article du journal Le Monde du 4 mai 1988.
Comment je suis devenu militant
Il est assez peu courant que des scientifiques se posent la question du rôle de leur science dans la société. J’ai même l’impression très nette que plus ils sont haut situés dans la hiérarchie sociale, et plus par conséquent ils se sont identifiés à l’establishment, ou du moins contents de leur sort, moins ils ont tendance à remettre en question cette religion qui nous a été inculquée dès les bancs de l’école primaire : toute connaissance scientifique est bonne, quelque soit son contexte ; tout progrès technique est bon. Et comme corollaire : la recherche scientifique est toujours bonne. Aussi les scientifiques, y compris les plus prestigieux, ont-ils généralement une connaissance de leur science exclusivement “de l’intérieur”, plus éventuellement une connaissance de certains rapports administratifs de leur science avec le reste du monde. Se poser une question comme : « La science actuelle en général, ou mes recherches en particulier, sont-elles utiles, neutres ou nuisibles à l’ensemble des hommes ? » ‑ cela n’arrive pratiquement jamais, la réponse étant considérée comme évidente, par les habitudes de pensée enracinées depuis l’enfance et léguées depuis des siècles. Pour ceux d’entre-nous qui sommes des enseignants, la question de la finalité de l’enseignement, ou même simplement celle de son adaptation aux débouchés, est tout aussi rarement posée.
Pas plus que mes collègues, je n’ai fait exception à la règle. Pendant près de vingt-cinq ans, j’ai consacré la totalité de mon énergie intellectuelle à la recherche mathématique, tout en restant dans une ignorance à peu près totale sur le rôle des mathématiques dans la société, id est pour l’ensemble des hommes, sans même m’apercevoir qu’il y avait là une question qui méritait qu’on se la pose ! La recherche avait exercé sur moi une grande fascination, et je m’y étais lancé dès que j’étais étudiant, malgré l’avenir incertain que je prévoyais comme mathématicien, alors que j’étais étranger en France. Les choses se sont aplanies par la suite : j’ai découvert l’existence du CNRS et j’y ai passé huit années de ma vie, de 1950 à 1958, toujours émerveillé à l’idée que l’exercice de mon activité favorite m’assurait en même temps la sécurité matérielle, plus généreusement d’ailleurs d’année en année. Depuis 1959, j’ai été professeur à l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) qui est un petit institut de recherche pure créé à ce moment, subventionné à l’origine uniquement par des fonds privés (industries). Avec mes quelques collègues, j’y jouissais de conditions de travail exceptionnellement favorables, comme on en trouve guère ailleurs qu’à l’Institute for Advanced Study, à Princeton, qui avait d’ailleurs servi de modèle à l’IHES. Mes relations avec les autres mathématiciens (comme, dans une large mesure, celles des mathématiciens entre-eux) se bornaient à des discussions mathématiques sur des questions d’intérêts commun, qui fournissaient un sujet inépuisable. N’ayant eu d’autre enseignement à donner qu’au niveau de la recherche, avec des élèves préparant des thèses, je n’avais guère eu l’occasion d’être directement confronté aux problèmes de l’enseignement ; d’ailleurs, comme la plupart de mes collègues, je considérais que l’enseignement au niveau élémentaire était une diversion regrettable dans l’activité de recherche, et j’étais heureux d’en être dispensé.
Heureusement, il commence à y avoir une petite minorité de scientifiques qui se réveillent plus ou moins brutalement de l’état de quiétude parfaite que je viens de décrire. En France, le mois de Mai 1968 a été dans ce sens un puissant stimulant sur beaucoup de scientifiques ou d’universitaires. Le cas de C. Chevalley est à ce sujet particulièrement éloquent. Pour moi, ces événements m’ont fait prendre conscience de l’importance de la question de l’enseignement universitaire et de ses relations avec la recherche, et j’ai fait partie d’une commission de travail à la Faculté des Sciences d’Orsay, chargée de mettre au point des projets de structure (nos conclusions tendant à une distinction assez nette entre le métier d’enseignant et celui de chercheur ont été d’ailleurs battues en brèche avec une rare unanimité par les assistants et les professeurs, et les rares étudiants qui se sont mêlés aux débats…). Cependant, n’étant pas enseignant, ma vie professionnelle n’a été en rien modifiée par le grand brassage idéologique de Mai 68.
Néanmoins, depuis environ une année, j’ai commencé à prendre conscience progressivement de l’urgence d’un certain nombre de problèmes, et depuis fin juillet 1970 je consacre la plus grande partie de mon temps en militant pour le mouvement Survivre, fondé en juillet à Montréal. Son but est la lutte pour la survie de l’espèce humaine, et même de la vie tout court, menacée par le déséquilibre écologique croissant causé par une utilisation indiscriminée de la science et de la technologie et par des mécanismes sociaux suicidaires, et menacée également par des conflits militaires liés à la prolifération des appareils militaires et des industries d’armement. Les questions soulevées dans le petit tract qui a annoncé la réunion d’aujourd’hui font partie de la sphère d’intérêt de Survivre, car ils nous semblent liées de façon essentielle à la question de notre survie. On m’a suggéré de raconter ici comment s’est faite la prise de conscience qui a abouti à un bouleversement important de ma vie professionnelle et de la nature de mes activités.
Pour ceci, je devrais préciser que dans mes relations avec la plupart de mes collègues mathématiciens, il y avait un certain malaise. Il provenait de la légèreté avec laquelle ils acceptaient des contrats avec l’armée (américaine le plus souvent), ou acceptaient de participer à des rencontres scientifiques financées par des fonds militaires. En fait, à ma connaissance, aucun des collègues que je fréquentais ne participait à des recherches de nature militaire, soit qu’ils jugent une telle participation comme répréhensible, soit que leur intérêt exclusif pour la recherche pure les rendent indifférents aux avantages et au prestige qui est attaché à la recherche militaire. Ainsi, la collaboration des collègues que je connais avec l’armée leur fournit un surplus de ressources ou des commodités de travail supplémentaires, sans contre partie apparente — sauf la caution implicite qu’ils donnent à l’armée.
Cela ne les empêche d’ailleurs pas de professer des idées “de gauche” ou de s’indigner des guerres coloniales (Indochine, Algérie, Vietnam) menées par cette même armée dont ils recueillent volontiers la manne bienfaisante. Ils donnent généralement cette attitude comme justification de leur collaboration avec l’armée, puisque d’après eux cette collaboration “ne limitait en rien” leur indépendance par rapport à l’armée, ni leur liberté d’opinion. Ils se refusent à voir qu’elle contribue à donner une auréole de respectabilité et de libéralisme à cet appareil d’asservissement, de destruction et d’avilissement de l’homme qu’est l’armée.
Il y avait là une contradiction qui me choquait. Cependant, habitué depuis mon enfance aux difficultés qu’il y a à convaincre autrui sur des questions morales qui me semblent évidentes, j’avais le tord d’éviter les discussions sur cette question importante, et je me cantonnais dans le domaine des problèmes purement mathématiques, qui ont ce grand avantage de faire aisément l’accord des esprits.
Cette situation a continué jusqu’au mois de décembre 1969, où j’appris fortuitement que l’IHES était depuis trois ans financé partiellement par des fonds militaires. Ces subventions d’ailleurs n’étaient assorties d’aucune condition ou entrave dans le fonctionnement scientifique de IHES, et n’avaient pas été portées à la connaissance des professeurs par la direction, ce qui explique mon ignorance à leur sujet pendant si longtemps. Je réalise maintenant qu’il y avait eu négligence de ma part, et que vu ma ferme détermination à ne pas travailler dans une institution subventionnée pas l’armée, il m’appartenait de me tenir informé sur les sources de financement de l’institution où je travaillais.
Quoi qu’il en soit, je fis aussitôt mon possible pour obtenir la suppression des subventions militaires de l’IHES. De mes quatre collègues, deux étaient en principe favorables au maintien de ces subventions, un autre était indifférent, un autre hésitant sur la question de principe.
Tout compte fait, tous quatre auraient préféré la suppression des subventions militaires plutôt que mon départ. Ils firent même une démarche en ce sens auprès du directeur de l’IHES, contredites peu après par des démarches contraires de deux de ces collègues. Aucun d’eux n’était disposé à appuyer à fond mon action, ce qui aurait certainement suffit à obtenir gain de cause. Il est inutile d’entrer ici dans le détail des péripéties qui ont abouti à me convaincre qu’il était impossible d’obtenir une quelconque garantie que l’IHES ne serait pas subventionnée par des fonds militaires à l’avenir. Cela m’a conduit à quitter cet institut au mois de septembre 1970. Pour l’année académique 1970/71, je suis professeur associé au Collège de France.
Après quelques semaines d’amertume et de déception, j’ai réalisé qu’il est préférable pour moi que l’issue ait été telle que je l’ai décrite. En effet, lorsqu’il semblait à un moment donné que la situation “allait s’arranger”, je me disposais déjà à retourner entièrement à des efforts purement scientifiques. C’est de m’être vu dans une situation où j’ai dû abandonner une institution dans laquelle j’avais donné le meilleur de mon œuvre mathématique (et dont j’avais été le premier, avec J. Dieudonné, à fonder la réputation scientifique), qui m’a donné un choc d’une force suffisante pour m’arracher à mes intérêts purement spéculatifs et scientifiques, et pour m’obliger, après des discussions avec de nombreux collègues, à prendre conscience du principal problème de notre temps, celui de la survie, dont l’armée et les armements ne sont qu’un des nombreux aspects. Ce dernier m’apparaît encore comme le plus flagrant du point de vue moral, mais non comme le plus fondamental pour l’analyse objective des mécanismes qui sont en train d’entraîner l’humanité vers sa propre destruction.
Alexandre Grothendieck
Survivre et Vivre n°6 – Janvier 1971.
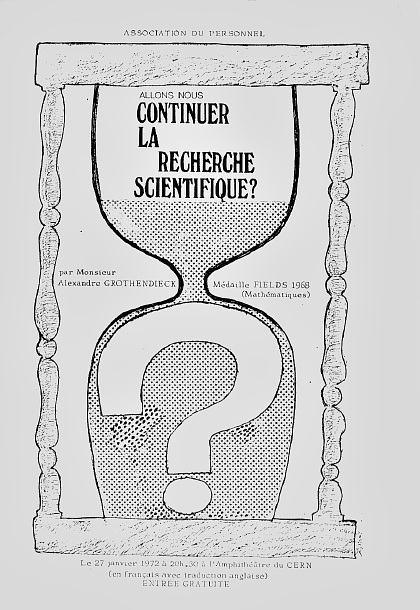
Allons-nous continuer la recherche scientifique ?
Mesdames et messieurs, bonsoir.
— Dans nos cycles de conférences, depuis dix ans que nous les organisons, nous avons périodiquement demandé à des scientifiques de venir nous faire des réflexions sur la science, sur la responsabilité du savant et je crois que c’est particulièrement nécessaire de le faire parce que nous avons un peu tendance au CERN à nous prendre pour des gens extraordinaires qui font des choses théoriques pas dangereuses du tout, au sein d’une collaboration européenne exceptionnelle. Alors, toujours pris par ces belles idées, on a un peu trop tendance peut-être à s’en satisfaire et à ne pas se poser de questions plus profondes. C’est justement pour aller un peu plus loin qu’il est utile d’avoir des conférenciers comme Monsieur Grothendieck que nous avons ce soir et auquel je cède immédiatement la parole.
Alexandre Grothendieck :
— Je suis très content d’avoir l’occasion de parler au CERN. Pour beaucoup de personnes, dont j’étais, le CERN est une des quelques citadelles, si l’on peut dire, d’une certaine science, en fait d’une science de pointe : la recherche nucléaire. On m’a détrompé. Il paraît qu’au CERN — le Centre Européen de Recherches Nucléaires —, on ne fait pas de recherches nucléaires. Quoiqu’il en soit, je crois que dans l’esprit de beaucoup de gens, le CERN en fait.
La recherche nucléaire est indissolublement associée, pour beaucoup de gens également, à la recherche militaire, aux bombes A et H et, aussi, à une chose dont les inconvénients commencent seulement à apparaître : la prolifération des centrales nucléaires. En fait, l’inquiétude qu’a provoqué depuis la fin de la dernière guerre mondiale la recherche nucléaire s’est un peu effacée à mesure que l’explosion de la bombe A sur Hiroshima et Nagasaki s’éloignait dans le passé. Bien entendu, il y a eu l’accumulation d’armes destructives du type A et H qui maintenait pas mal de personnes dans l’inquiétude. Un phénomène plus récent, c’est la prolifération des centrales nucléaires qui prétend répondre aux besoins croissants en énergie de la société industrielle. Or, on s’est aperçu que cette prolifération avait un certain nombre d’inconvénients, pour employer un euphémisme, « extrêmement sérieux » et que cela posait des problèmes très graves. Qu’une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l’humanité, une menace même à la vie tout court sur la planète, ce n’est pas une situation exceptionnelle, c’est une situation qui est de règle. Depuis un ou deux ans que je commence à me poser des questions à ce sujet, je me suis aperçu que, finalement, dans chacune des grandes questions qui actuellement menacent la survie de l’espèce humaine, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle, la menace à la survie ne se poserait pas, si l’état de notre science était celle de l’an 1900, par exemple. Je ne veux pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science. Il y a bien entendu, une conjonction de plusieurs choses ; mais la science, l’état actuel de la recherche scientifique, joue certainement un rôle important.
Tout d’abord, je pourrais peut-être dire quelques mots personnels. Je suis un mathématicien. J’ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique. En ce qui concerne la recherche mathématique, celle que j’ai faite et celle qu’on fait les collègues avec lesquels j’ai été en contact, elle me semblait très éloignée de toute espèce d’application pratique. Pour cette raison, je me suis senti pendant longtemps particulièrement peu enclin à me poser des questions sur les tenants et les aboutissants, en particulier sur l’impact social, de cette recherche scientifique. Ce n’est qu’à une date assez récente, depuis deux ans que j’ai commencé comme cela, progressivement, à me poser des questions à ce sujet. Je suis arrivé ainsi à une position où, depuis un an et demi en fait, j’ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. à l’avenir, je n’en ferai que le strict nécessaire pour pouvoir subvenir à mes besoins puisque, jusqu’à preuve du contraire, je n’ai pas d’autre métier que mathématicien. Je sais bien que je ne suis pas le seul à m’être posé ce genre de question. Depuis une année ou deux, et même depuis les derniers mois, de plus en plus de personnes se posent des questions clés à ce sujet. Je suis tout à fait persuadé qu’au CERN également beaucoup de scientifiques et de techniciens commencent à se les poser. En fait, j’en ai rencontré. En outre, moi-même et d’autres connaissons des personnes, au CERN par exemple, qui se font des idées « extrêmement sérieuses » au sujet des applications dites pacifiques de l’énergie nucléaire ; mais qui n’osent pas les exprimer publiquement de crainte de perdre leur place. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une atmosphère qui serait spéciale au CERN. Je crois que c’est une atmosphère qui prévaut dans la plupart des organismes universitaires ou de recherche, en France, en Europe, et même, dans une certaine mesure, aux États-Unis où les personnes qui prennent le risque d’exprimer ouvertement leurs réserves, même sur un terrain strictement scientifique, sur certains développements scientifiques, sont quand même une infime minorité.
Ainsi, depuis un an ou deux, je me pose des questions. Je ne les pose pas seulement à moi-même. Je les pose aussi à des collègues et, tout particulièrement depuis plusieurs mois, six mois peut-être, je profite de toutes les occasions pour rencontrer des scientifiques, que ce soit dans les discussions publiques comme celle-ci ou en privé, pour soulever ces questions. En particulier : « Pourquoi faisons-nous de la recherche scientifique ? ». Une question qui est pratiquement la même peut-être, à longue échéance du moins, que la question : « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? ». La chose extraordinaire est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En fait, pour la plupart d’entre eux, cette question est simplement si étrange, si extraordinaire, qu’ils se refusent même des l’envisager. En tout cas, ils hésitent énormément à donner une réponse quelle qu’elle soit. Lorsqu’on parvient à arracher une réponse dans les discussions publiques ou privées, ce qu’on entend généralement c’est, par ordre de fréquence des réponses : « La recherche scientifique ? J’en fais parce que ça me fait bien plaisir, parce que j’y trouve certaines satisfactions intellectuelles. » Parfois, les gens disent : « Je fais de la recherche scientifique parce qu’il faut bien vivre, parce que je suis payé pour cela. »
En ce qui concerne la première motivation, je peux dire que c’était ma motivation principale pendant ma vie de chercheur. Effectivement, la recherche scientifique me faisait bien plaisir et je ne me posait guère de questions au delà. En fait, si cela me faisait plaisir, c’était en grande partie parce que le consensus social me disait que c’était une activité noble, positive, une activité qui valait la peine d’être entreprise ; sans du tout d’ailleurs, détailler en quoi elle était positive, noble, etc. évidement, l’expérience directe me disait que, avec mes collègues, nous construisions quelque chose, un certain édifice. Il y avait un sentiment de progression qui donnait une certaine sensation d’achievement… de plénitude disons et, en même temps, une certaine fascination dans les problèmes qui se posaient.
Mais tout ceci, finalement, ne répond pas à la question : « à quoi sert socialement la recherche scientifique ? » Parce que, si elle n’avait comme but que de procurer du plaisir, disons, à une poignée de mathématiciens ou d’autres scientifiques, sans doute la société hésiterait à y investir des fonds considérables — en mathématiques ils ne sont pas très considérables ; mais dans les autres sciences, ils peuvent l’être. La société hésiterait aussi sans doute, à payer tribut à ce type d’activité ; tandis qu’elle est assez muette sur des activités qui demandent peut-être autant d’efforts, mais d’un autre type, comme de jouer aux billes ou des choses de ce goût-là. On peut développer à l’extrême certaines facilités, certaines facultés techniques, qu’elles soient intellectuelles, manuelles ou autres, mais pourquoi y a-t-il cette valorisation de la recherche scientifique ? C’est une question qui mérite d’être posée.
En parlant avec beaucoup de mes collègues, je me suis aperçu au cours de l’année dernière qu’en fait cette satisfaction que les scientifiques sont censés retirer de l’exercice de leur profession chérie, c’est un plaisir… qui n’est pas un plaisir pour tout le monde ! Je me suis aperçu avec stupéfaction que pour la plupart des scientifiques, la recherche scientifique était ressentie comme une contrainte, comme une servitude. Faire de la recherche scientifique, c’est une question de vie ou de mort en tant que membre considéré de la communauté scientifique. La recherche scientifique est un impératif pour obtenir un emploi, lorsqu’on s’est engagé dans cette voie sans savoir d’ailleurs très bien à quoi elle correspondait. Une fois qu’on a son boulot, c’est un impératif pour arriver à monter en grade. Une fois qu’on est monté en grade, à supposer même qu’on soit arrivé au grade supérieur, c’est un impératif pour être considéré comme étant dans la course. On s’attend à ce que vous produisiez. La production scientifique, comme n’importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est considérée comme un impératif en soi. Dans tout ceci, la chose remarquable est que, finalement, le contenu de la recherche passe entièrement au second plan. Il s’agit de produire un certain nombre de “papiers”. Dans les cas extrêmes, on va jusqu’à mesurer la productivité des scientifiques au nombre de pages publiées. Dans ces conditions, pour un grand nombre de scientifiques, certainement pour l’écrasante majorité, à l’exception véritablement de quelques uns qui ont la chance d’avoir, disons, un don exceptionnel ou d’être dans une position sociale et une disposition d’esprit qui leur permette de s’affranchir de ces sentiments de contrainte, pour la plupart la recherche scientifique est une véritable contrainte qui tue le plaisir que l’on peut avoir à l’effectuer.
C’est une chose que j’ai découvert avec stupéfaction parce qu’on en parle pas. Entre mes élèves et moi, je pensais qu’il y avait des relations spontanées et égalitaires. En fait, c’est une illusion dans laquelle j’étais enfermé ; sans même que je m’en aperçoive, il y avait une véritable relation hiérarchique. Les mathématiciens qui étaient mes élèves ou qui se considéraient comme moins bien situés que moi et qui ressentaient, disons, une aliénation dans leur travail, n’auraient absolument pas eu l’idée de m’en parler avant que, de mon propre mouvement, je quitte le ghetto scientifique dans lequel j’étais enfermé et que j’essaie de parler avec des gens qui n’étaient pas de mon milieu ; ce milieu de savants ésotériques qui faisaient de la haute mathématique.
Pour illustrer ce point, j’aimerais donner ici un exemple très concret. Je suis allé, il y a deux semaines, faire un tour en Bretagne. J’ai eu l’occasion, entre autres, de passer à Nantes où j’ai vu des amis, où j’ai parlé dans une Maison de Jeunes et de la Culture (MJC) sur le genre de problèmes que nous abordons aujourd’hui. J’y étais le lundi. Comme les collègues de l’Université de Nantes étaient avertis de ma venue, ils avaient demandé in extremis que je vienne, le lendemain après-midi, pour faire une causerie sur des sujets mathématiques avec eux. Or il s’est trouvé que, le jour même de ma venue, un des mathématiciens de Nantes, M. Molinaro, s’est suicidé. Donc, à cause de cet incident malheureux, la causerie mathématique qui était prévue a été annulée. Au lieu de ceci, j’ai alors contacté un certain nombre de collègues pour demander s’il était possible que l’on se réunisse pour parler un peu de la vie mathématique à l’intérieur du département de mathématiques à l’Université et pour parler également un peu de ce suicide. Il y a eu une séance extrêmement révélatrice du malaise général, cette après-midi là à Nantes, où manifestement tout le monde présent — avec une exception je dirais — sentait bien clairement que ce suicide était lié de très très près au genre de choses que, précisément, on discutait la veille au soir à la MJC.
En fait, je donnerai peut-être un ou deux détails. Il s’est trouvé que Molinaro avait deux thésards auxquels il faisait faire des thèses de troisième cycle — je crois que ce n’était pas des thèses d’état. Or, ces thèses furent considérées comme n’étant pas de valeur scientifique suffisante. Elles furent jugées très sévèrement par Dieudonné qui est un bon collègue à moi et avec lequel j’ai écrit un gros traité de géométrie algébrique. Je le connais donc très bien, c’est un homme qui a un jugement scientifique très sûr, qui est très exigeant sur la qualité d’un travail scientifique. Ainsi, alors que ces thèses étaient discutées par la Commission pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de l’Enseignement Supérieur, il les a saqués et l’inscription a été refusée. Ceci, bien entendu, a été ressenti comme une sorte d’affront personnel par Molinaro qui avait déjà eu des difficultés auparavant et il s’est suicidé sur ces circonstances. En fait, j’ai eu un ami mathématicien, qui s’appelait Terenhöfel qui s’est également suicidé. Je connais un certain nombre de mathématiciens — je parle surtout ici de mathématiciens puisque c’est le milieu que j’ai le mieux connu — qui sont devenus fous.
Je ne pense pas que cela soit une chose propre aux mathématiques. Je pense que le genre, disons, d’atmosphère qui prévaut dans le monde scientifique, qu’il soit mathématique ou non, une sorte d’atmosphère à l’air extrêmement raréfié, et la pression qui s’exerce sur les chercheurs sont pour beaucoup dans l’évolution de ces cas malheureux.
Ceci concernant le plaisir que nous prenons à faire de la recherche scientifique. Je crois qu’il peut y avoir plaisir, mais je suis arrivé à la conclusion que le plaisir des uns, le plaisir des gens haut placés, le plaisir des brillants, se fait aux dépends d’une répression véritable vis-à-vis du scientifique moyen.
Un autre aspect de ce problème qui dépasse les limites de la communauté scientifique, de l’ensemble des scientifiques, c’est le fait que ces hautes voltiges de la pensée humaine se font au dépends de l’ensemble de la population qui est dépossédée de tout savoir. En ce sens que, dans l’idéologie dominante de notre société, le seul savoir véritable est le savoir scientifique, la connaissance scientifique, qui est l’apanage sur la planète de quelques millions de personnes, peut-être une personne sur mille. Tous les autres sont censés “ne pas connaître” et, en fait, quand on parle avec eux, ils ont bien l’impression de “ne pas connaître”. Ceux qui connaissent sont ceux qui sont là-haut, dans les hautes sciences : les mathématiciens, les scientifiques, les très calés, etc.
Donc, je pense qu’il y a pas mal de commentaires critiques à faire sur ce plaisir que nous retourne la science et sur ses à-côtés. Ce plaisir est une sorte de justification idéologique d’un certain cours que la société humaine est en train de prendre et, à ce titre, je pense même que la science la plus désintéressée qui se fait dans le contexte actuel, et même la plus éloignée de l’application pratique, a un impact extrêmement négatif.
C’est pour cette raison que, personnellement, je m’abstiens actuellement, dans toute la mesure du possible, de participer à ce genre d’activités. Je voudrais préciser la raison pour laquelle au début j’ai interrompu mon activité de recherche : c’était parce que je me rendais compte qu’il y avait des problèmes si urgents à résoudre concernant la crise de la survie que ça me semblait de la folie de gaspiller des forces à faire de la recherche scientifique pure. Au moment où j’ai pris cette décision, je pensais consacrer plusieurs années à faire de la recherche, à acquérir certaines connaissances de base en biologie, avec l’idée d’appliquer et de développer des techniques mathématiques, des méthodes mathématiques, pour traiter des problèmes de biologie. C’est une chose absolument fascinante pour moi et, néanmoins, à partir du moment où des amis et moi avons démarré un groupe qui s’appelle “Survivre”, pour précisément nous occuper des questions de la survie, à partir de ce moment, du jour au lendemain, l’intérêt pour une recherche scientifique désintéressée s’est complètement évanoui pour moi et je n’ai jamais eu une minute de regrets depuis.
Il reste la deuxième motivation : la science, l’activité scientifique, nous permet d’avoir un salaire, nous permet de vivre. C’est en fait la motivation principale pour la plupart des scientifiques, d’après les conversations que j’ai pu avoir avec un grand nombre d’entre-eux. Il y aurait aussi pas mal de choses à dire sur ce sujet. En particulier, pour les jeunes qui s’engagent actuellement dans la carrière scientifique, ceux qui font des études de sciences en s’imaginant qu’ils vont trouver un métier tout prêt qui leur procurera la sécurité. Je crois qu’il est généralement assez bien connu qu’il y a là une grande illusion. à force de produire des gens hautement qualifiés, on en a produit vraiment de trop depuis le grand boom dans la production de jeunes savants, depuis le Spoutnik il y a une quinzaine d’années, et il y a de plus en plus de chômage dans les carrières scientifiques. C’est un problème qui se pose de façon de plus en plus aigüe pour un nombre croissant de jeunes, surtout de jeunes scientifiques. Aux États-Unis, on doit fabriquer chaque année quelque chose comme 1000 ou 1500 thèses rien qu’en mathématiques et le nombre de débouchés est à peu près de l’ordre du tiers de cela *.
D’autre part, il n’en reste pas moins que lorsque la science nous permet d’avoir un salaire et de subvenir à nos besoins, les liens entre notre travail et la satisfaction de nos besoins sont pratiquement tranchés, ce sont des liens extrêmement abstraits. Le lien est pratiquement formé par le salaire, mais nos besoins ne sont pas directement reliés à l’activité que nous exerçons. En fait, c’est cela la chose remarquable, quand on pose la question : « à quoi sert socialement la science ? », pratiquement personne n’est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous faisons ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos proches, de gens que nous puissions connaître. Il y a aliénation parfaite entre nous-même et notre travail.
Ce n’est pas un phénomène qui soit propre à l’activité scientifique, je pense que c’est une situation propre à presque toutes les activités professionnelles à l’intérieur de la civilisation industrielle. C’est un des très grand vice de cette civilisation industrielle.
En ce qui concerne les mathématiques plus particulièrement, depuis quelques mois, j’essaie vraiment de découvrir une façon dont la recherche mathématique, celle qui s’est faite depuis quelques siècles — je ne parle pas nécessairement de la recherche mathématique la plus récente, celle dans laquelle j’étais encore impliqué moi-même à date assez récente — pourrait servir du point de vue de la satisfaction de nos besoins. J’en ai parlé avec toute sorte de mathématiciens depuis trois mois. Personne n’a été capable de me donner une réponse. Dans des auditoires comme celui-ci ou des groupes de collègues plus petits, personne ne sait. Je ne dirais pas qu’aucune de ces connaissances ne soit capable, d’une façon ou d’une autre, de s’appliquer pour nous rendre heureux, pour nous permettre un meilleur épanouissement, pour satisfaire certains désirs véritables, mais jusqu’à maintenant je ne l’ai pas trouvé. Si je l’avais trouvé, j’aurais été beaucoup plus heureux, beaucoup plus content à certains égards, du moins jusqu’à une date récente. Après tout, je suis mathématicien moi-même et cela m’aurait fait plaisir de savoir que mes connaissances mathématiques pouvaient servir à quelque chose de socialement positif. Or, depuis deux ans que j’essaie de comprendre un petit peu le cours que la société est en train de prendre, les possibilités que nous avons pour agir favorablement sur ce cours, en particulier les possibilités que nous avons pour permettre la survie de l’espèce humaine et pour permettre une évolution de la vie qui soit digne d’être vécue, que la survie en vaille la peine, mes connaissances de scientifique ne m’ont pas servi une seule fois.
Le seul point sur lequel ma formation de mathématicien m’ait servi, ce n’est pas tellement par ma formation de mathématicien en tant que telle ni mon nom de mathématicien, c’était que, puisque j’étais un mathématicien connu, j’avais la possibilité de me faire inviter par pas mal d’universités un peu partout. Ceci m’a donné la possibilité de parler avec beaucoup de collègues, d’étudiants, de gens un peu partout. Cela s’est produit pour la première fois au printemps dernier où j’ai fait un tour au Canada et aux états-Unis. En l’espace de trois semaines, j’ai visité une vingtaine de campus. J’ai retiré un bénéfice énorme de ces contacts ; mes idées, ma vision des choses ont énormément évolués depuis ce moment là. Mais c’est donc de façon tout-à-fait incidente que ma qualité de mathématicien m’a servi ; en tous cas, mes connaissances de mathématiciens y étaient vraiment pour rien.
Je pourrais ajouter que j’ai pris l’habitude, depuis le printemps dernier, lorsque je reçois une invitation pour faire des exposés mathématiques quelque part, et lorsque je l’accepte, c’est en explicitant que cela ne m’intéresse que dans la mesure où un tel exposé me donne l’occasion de débattre de problèmes plus importants, tels que celui dont on est en train de parler maintenant ici. En général, cela me donne aussi l’occasion de parler avec des non-mathématiciens, avec des scientifiques des autres disciplines, et également avec des non-scientifiques. C’est pourquoi je demande à mes collègues mathématiciens qu’au moins une personne du département s’occupe de l’organisation de tels débats. Cela a été le cas, par exemple, pour toutes les conférences que j’ai faites au Canada et aux états-Unis. Jusqu’à maintenant, personne n’a refusé une seule fois cette proposition d’organiser des débats non-techniques, non purement mathématiques, en marge de l’invitation mathématique au sens traditionnel. D’ailleurs, depuis ce moment là, j’ai également modifié un peu ma pratique en introduisant également des commentaires, disons, préliminaires, dans les exposés mathématiques eux-mêmes pour qu’il n’y ait pas une coupure trop nette entre la partie mathématique de mon séjour et l’autre.
Donc, non seulement j’annonce le débat public plus général qui a lieu ensuite, mais également je prend mes distances vis-à-vis de la pratique même d’inviter des conférenciers étranger pour accomplir un certain rituel — à savoir, faire une conférence de haute volée sur un grand sujet ésotérique devant un public de cinquante ou cent personnes dont peut-être deux ou trois peuvent péniblement y comprendre quelque chose, tandis que les autres se sentent véritablement humiliés parce que, effectivement, ils sentent une contrainte sociale posée sur eux pour y aller. La première fois que j’ai posé la question clairement, c’était à Toulouse, il y a quelques mois, et j’ai senti effectivement une espèce de soulagement du fait que ces choses là soient une fois dites. Pour la première fois depuis que je faisais ce genre de conférence, spontanément, sans que rien n’ait été entendu à l’avance, après la conférence mathématique qui était effectivement très ésotérique et qui, en elle-même était très pénible et pesante — j’ai eu à m’excuser plusieurs fois au cours de la conférence parce que, vraiment, c’était assez intolérable — ; eh bien, immédiatement après, s’est instauré une discussion extrêmement intéressante et précisément sur le thème : « à quoi sert ce genre de mathématiques ? » et « à quoi sert ce genre de rituel qui consiste à faire des conférences devant des gens qui ne s’y intéressent rigoureusement pas ? ».
Mon intention n’était pas de faire une sorte de théorie de l’anti-science. Je vois bien que j’ai à peine effleuré quelques-uns des problèmes qui sont liés à la question « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? », même parmi ceux qui étaient indiqués sur ce tract dont j’ai vu une copie. Par exemple, sur les possibilités de développer une pratique scientifique entièrement différente de la pratique scientifique actuelle et sur une critique plus détaillée de cette pratique.
J’ai parlé plutôt en termes assez concrets de mon expérience personnelle, de ce qui m’as été transmis directement par d’autres, pendant une demi-heure. C’est probablement suffisant ; peut-être sera-t-il préférable que d’autres points soient traités un peu plus en profondeur au cours d’une discussion générale.
Je voudrais simplement indiquer, avant de terminer mon petit laïus introductif, que j’ai ramené ici quelques exemplaires d’un journal que nous éditons qui s’appelle Survivre et Vivre. Il s’agit du groupe dont j’ai parlé au début et qui a changé de nom depuis quelques mois. Au lieu de Survivre, après un certain changement d’optique assez important, assez caractéristique, il est devenu Survivre et Vivre. Au début, nous avions démarré sous la hantise d’une possible fin du monde où l’impératif essentiel, pour nous, était l’impératif de la survie. Depuis lors, par un cheminement parallèle chez beaucoup d’entre-nous et d’autres ailleurs hors du groupe, nous sommes parvenus à une autre conclusion. Au début, nous étions si l’on peut dire overwhelm, écrasés, par la multiplicité des problèmes extrêmement enchevêtrés, de telle façon qu’il semblait impossible de toucher à aucun d’eux sans, en même temps, amener tous les autres. Finalement, on se serait laissé aller à une sorte de désespoir, de pessimisme noir, si on n’avait pas fait le changement d’optique suivant : à l’intérieur du système de référence habituel où nous vivons, à l’intérieur du type de civilisation donné, appelons-là civilisation occidentale ou civilisation industrielle, il n’y a pas de solution possible ; l’imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifiques, si vous voulez, est telle qu’il n’y a pas d’issues possibles.
Au début, nous pensions qu’avec des connaissances scientifiques, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux appréhender une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d’un supplément de connaissances scientifiques, d’un supplément de techniques, mais qu’elle proviendra d’un changement de civilisation. C’est en cela que consiste le changement d’optique extrêmement important. Pour nous, la civilisation dominante, la civilisation industrielle, est condamnée à disparaître en un temps relativement court, dans peut-être dix, vingt ou trente ans… une ou deux générations, dans cet ordre de grandeur ; parce que les problèmes que posent actuellement cette civilisation sont des problèmes effectivement insolubles.
Nous voyons maintenant notre rôle dans la direction suivante : être nous-mêmes partie intégrante d’un processus de transformations, de ferments de transformations d’un type de civilisation à un autre, que nous pouvons commencer à développer dès maintenant. Dans ce sens, le problème de la survie pour nous a été, si l’on peut dire, dépassé, il est devenu celui du problème de la vie, de la transformation de notre vie dans l’immédiat ; de telle façon qu’il s’agisse de modes de vie et de relations humaines qui soient dignes d’être vécues et qui, d’autre part, soient viables à longue échéance et puissent servir comme point de départ pour l’établissement de civilisations post-industrielles, de cultures nouvelles.
Pour les abonnements, on peut écrire à mon adresse : 21, avenue Kennedy, 91 Massy ; les conditions sont indiquées dans le journal.
Discussion
Question :
— J’aimerais beaucoup savoir ce qui, selon vous, rend la vie digne d’être vécue.
Réponse :
— En fait, jusqu’à présent, l’activité, la vie que j’ai eue, je la considérais tout à fait digne d’être vécue. J’avais le sentiment d’un certain type d’épanouissement personnel qui me satisfaisait. Maintenant, avec le recul, j’envisage ma vie passée sous un jour très différent ; en ce sens que je me rends compte que cet épanouissement était en même temps une mutilation. En effet, il s’agit d’une activité extrêmement intense, mais dans une direction excessivement étroite. De telle façon que toutes les autres possibilités d’épanouissement de la personne ne sont pas touchées. Pour moi, il n’y a absolument plus de doute possible à ce sujet. Le genre d’activité que j’ai actuellement est infiniment plus satisfaisant, plus enrichissant, que celui que j’ai eu pendant vingt ou vingt-cinq années de mon travail de chercheur mathématique. Ceci est un point tout-à-fait personnel, en ce qui concerne ma propre vie.
Mais, d’autre part, quand je parle d’une vie qui est digne d’être vécue, il ne s’agit pas seulement de ma vie à moi, il s’agit de la vie de tous. Et je me rends compte que l’épanouissement que j’ai pu réaliser dans une direction très limitée se faisait au dépends des possibilités d’épanouissement d’autres personnes. Si certaines personnes se sont trouvées sous une pression psychologique si forte qu’elles en sont parfois venues au suicide, c’est bien à cause d’un consensus dominant qui faisait que la valeur de la personne était jugée, par exemple, d’après sa virtuosité technique à démontrer des théorèmes, c’est-à-dire à effectuer des opérations excessivement spécialisées — alors que, précisément, tout le reste de la personne était complètement laissée dans l’ombre. C’est une chose que j’ai expérimenté maintes fois. Quand on parle d’une certaine personne et que je demande « Qui est-ce ? », on me répond « C’est un con. » En voulant dire par là, entre mathématiciens, que c’est un type qui soit démontre des théorèmes qui ne sont pas très intéressants, soit démontre des théorèmes qui sont faux, ou bien ne démontre pas de théorèmes du tout.
Donc, là, j’ai défini un peu négativement ce que j’entends par une vie qui soit digne d’être vécue. Je pense que, pour tout le monde, il y a possibilité d’épanouissement sans que nous soyons jugés par les autres, par des critères aussi étroits, aussi étriqués. En fait, je pense que cette échelle de valeurs a un effet directement mutilant sur les possibilités d’épanouissement. Enfin, c’est un des aspects, je ne prétends pas répondre ici à la question soulevée qui est très vaste ; mais dans l’optique où nous nous plaçons ici, en partant de la pratique scientifique, c’est ce que je vois de plus immédiat à répondre.
Question :
— Quelles sont vos opinions sur la structure de la recherche scientifique dans la République Populaire de Chine ?
Réponse :
— Jusqu’à une date assez récente, disons jusqu’à il y a environ trois mois, j’étais assez fermé à toutes les informations qui nous venaient de Chine parce qu’elles s’enveloppaient dans un jargon tel qu’on avait envie, a priori, de les mettre en doute — on n’avait pas envie de les prendre au sérieux. Le jargon, disons, d’un culte effréné de la personnalité de Mao Tsé Toung, une sorte de hagiographie qui l’accompagnait, faisait que je lisais ces publications assez souvent, mais qu’elles me tombaient des mains de découragement : ça ne passait pas. Alors, il y a trois mois, j’ai rencontré les Nouveaux Alchimistes [1] qui m’ont fait comprendre la possibilité d’une pratique scientifique entièrement différente de celle qui prévaut actuellement dans toutes les sciences qui sont professées à l’université et dans les instituts de recherche. à partir de ce moment là, effectivement, j’ai attaché un intérêt renouvelé à ce qui se passe en Chine et j’ai eu la motivation nécessaire pour dépasser, disons, les fioritures du style et pour essayer de voir le fond des choses. Ainsi, je me suis convaincu qu’il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent également en Chine, précisément en direction du développement d’une science nouvelle. En tout cas, la Chine est le seul pays dans lequel le mythe de l’expert soit officiellement battu en brèche, dans lequel on dit aux gens « ne vous fiez pas aux experts », « n’attendez pas que le gouvernement vous envoie des types compétents pour les résoudre vous-même », « résolvez-les vous-même avec les moyens du bord, avec les moyens que vous trouvez sur place ».
Que nous soyons des professeurs d’université, des ouvriers ou des paysans, nous sommes tous capables d’initiatives créatrices, nous sommes tous capables d’inventer quelque chose. Je crois que la façon la plus frappante dont ces… appelons-les “mots d’ordre” ou ce mouvement nouveau se soient matérialisés, c’est dans le développement de la médecine chinoise. Tout particulièrement depuis la Révolution Culturelle. C’est un exemple où, précisément, la science sort des mains d’une certaine caste pour devenir la science de tous et ce n’est qu’en devenant la science de tous qu’elle peut devenir la science pour tous. En fait, pratiquement n’importe qui peut devenir médecin, quelle que soit sa formation culturelle. Ce vaste mouvement de « médecins aux pieds nus » a mobilisé un nombre impressionnant de gens — mais je suis mauvais en statistiques et je ne saurai pas dire combien — qui parcourent les campagnes pour toutes sortes d’interventions médicales simples qui ne seraient admises qu’après des années et des années d’études médicales dans un contexte social comme le nôtre. Alors que là-bas, après quelques mois de préparation, on peut exercer certaines activités médicales.
On remarque tout particulièrement le développement sensationnel de l’acupuncture chinoise, qui a permis de guérir certaines affections dans des cas tout-à-fait insoupçonnés jusqu’à maintenant, ou d’être, par exemple, auxiliaire de certaines techniques médicales. On connaît le rôle que joue actuellement l’acupuncture chinoise dans l’anesthésie. L’acupuncture permet également de guérir toutes sortes d’affections, y compris des affections aussi banales que les rhumes, mais aussi, par exemple, des affections très sérieuses comme des descentes de matrice à des états très avancés. J’ai eu récemment la traduction d’un article d’un journal chinois à ce sujet qui nous éclaire bien sur les différences entre, disons, la pratique scientifique et en particulier la pratique médicale dans les pays occidentaux comme la France ou la Suisse et la pratique en Chine où une technique entièrement nouvelle de guérison d’une descente de matrice très avancée a été trouvée par une jeune femme médecin qui avait très peu d’études derrière elle, mais qui était fortement motivée pour guérir un cas précis. D’autre part, elle se trouvait dans un climat culturel où il n’est pas considéré comme inadmissible, comme impensable, qu’une personne ayant peu de connaissances, n’ayant pratiquement pas de diplômes, puisse développer des techniques nouvelles. Elle a fait des essais sur elle-même en faisant des piqûres sur ses propres vertèbres inférieures puisqu’elle savait, d’après le peu de choses élémentaires qu’elle avait apprises, qu’il y avait des liens nerveux directs entre la matrice et ces vertèbres et à force d’expérimentation sur elle-même, elle a fini par trouver un point qui lui a causé une réaction extrêmement forte qui lui a fait remonter la matrice à l’intérieur de son ventre. Sur ce, ayant la conviction qu’elle avait trouvé le point correct, elle a fait la même opération sur la malade qu’elle avait en vue et cette malade a été guérie. Depuis lors, d’après ce journal, une cinquantaine d’autres cas auraient été traités avec quarante cinq cas de guérison.
On peut voir ici la différence fondamentale entre cette sorte de pratique et de découvertes scientifiques et celle qui prévalent dans les pays occidentaux. Tout d’abord le malade n’est plus un objet entre les mains du médecin ; ce n’est plus le médecin qui est le sujet qui sait et qui applique son savoir sur l’objet malade. Ici, dans l’investigation scientifique, le médecin est en même temps l’objet de l’expérimentation, ce qui, en même temps, lui permet de surmonter cette…
……… PASSAGE INAUDIBLE ………
…du point de vue intolérable pour le malade d’être précisément un objet sans volonté, sans personnalité, entre les mains du médecin et, en même temps, qui permet, je crois, une connaissance beaucoup plus directe, beaucoup plus intense de ce qui se passe.
Lorsqu’on ressent la recherche scientifique dans sa propre chair, lorsqu’on ressent soi-même les réactions du corps, c’est une connaissance tout-à-fait différente que si l’on fait quelque chose sur un objet malade et que quelques aiguilles, ou autres, enregistrent des réactions de façon purement quantitative. Je pense qu’il y a là un ensemble de facteurs où les facultés rationnelles de la personne ne sont plus séparées les unes des autres, où elles ne sont plus séparées, par exemple, de l’expérience sensorielle directe, ou des motivations affectives, idéologiques, appelez-les comme vous voudrez.
Donc, je pense qu’il y a là véritablement intégration de nos différentes facultés cognitives, de nos facultés de connaissance, qui fait véritablement défaut dans la pratique scientifique dominante, occidentale. Ici, au contraire, nous faisons tout pour séparer coûte que coûte les facultés purement rationnelles et tout le reste de nos possibilités de connaissance. Ceci est, entre autre, un des facteurs qui a abouti à cette espèce de délire technologique qui fait que les savants sont capables de fasciner sur des problèmes techniques, comme ceux posés par la construction de missiles intercontinentaux ou d’autres choses analogues, sans du tout se poser la question des implications atroces de l’utilisation éventuelle de ce qu’ils sont en train de construire.
Question :
— D’après vous, il faudrait changer la société en une société post-industrielle dans dix ou vingt ans. Je vous accorde même cinquante ans. Je vous demande la chose suivante : supposez qu’une fée vous accorde un pouvoir illimité de persuader tout le monde de faire ce que vous pensez qu’il faille faire. Que ferez vous sans provoquer une grande catastrophe, disons, de famine, etc. ?
Réponse :
— Je crois qu’il y a déjà un malentendu de base. Je n’ai pas dit qu’il faut que qui que ce soit, de particulier, ou quelqu’un d’autre, moi par exemple, transforme la société industrielle, comme ça, dans les dix, vingt ou trente années qui viennent dans une autre forme de société prédéterminée. Si une fée m’investissait de pouvoirs discrétionnaires, je lui dirais que je n’en ai pas envie. Effectivement, je suis bien persuadé que ce que je pourrais faire, ce ne serait guère autre chose que de mettre encore plus de mess, de bordel, que celui qui y est déjà. En fait, je suis entièrement convaincu que absolument personne n’est capable, disons, de programmer, de prévoir les changements qui vont avoir lieu. Je pense que la complexité des problèmes planétaires est si grande qu’elle défie absolument les capacités d’analyse mathématique ou expérimentale. Nous sommes dans une situation où les méthodes des sciences expérimentales ne nous servent pratiquement à rien. Parce que, finalement, une planète Terre, il y en a une seule et une situation comme une situation de crise où nous sommes maintenant n’a lieu qu’une seule fois dans l’histoire de l’évolution. Nous n’avons donc pas là une expérience que nous puissions répéter à volonté pour voir qu’elles vont être les conséquences de telle ou telle opération, de façon à ensuite optimiser nos modes opérationnels. Il n’est absolument pas question de ceci. Il s’agit d’une situation unique, d’une complexité qui dépasse infiniment nos possibilités d’analyse et de prédiction détaillée.
Tout ce que nous pouvons faire, j’en suis persuadé, c’est que, chacun dans notre propre sphère d’activités, dans notre propre milieu, nous essayions d’être un ferment de transformation dans la direction qui, au jugé, intuitivement, nous semble la plus indiquée, en commençant par les rapports humains avec nos proches, les membres de notre famille, nos enfants, notre femme, nos amis, également nos collègues de travail. Je suis persuadé que c’est une première transformation qui a l’avantage d’être communicative, de se communiquer des uns aux autres.
Parmi les transformations à effectuer, il y a plus particulièrement : le dépassement de l’attitude de compétitivité entre personnes, le dépassement de l’attitude ou du désir de domination des uns par rapport aux autres qui engendre d’autre part le désir de soumission à l’autorité — on a d’ailleurs là deux aspects de la même tendance — et surtout l’établissement de la communication entre les personnes qui est devenue extrêmement pauvre dans notre civilisation. J’ai fait, assez récemment, le bilan de ma propre vie et des relations humaines que j’ai eues, et j’ai été frappé de constater à quel point la véritable communication était pauvre. Par exemple, en milieu mathématique, entre collègues, les conversations roulent essentiellement sur des sujets techniques concernant la mathématique. J’ai eu un certain nombre de relations amoureuses dans ma vie, comme sans doute la plupart d’entre vous, et, là également, je me suis aperçu à quel point la communication véritable, la connaissance l’un de l’autre était pauvre. Je suis tout-à-fait convaincu qu’il ne s’agit pas d’une particularité liée à ma personne parce que je serais personnellement moins doué pour la communication que d’autres. En fait, il s’agit là d’un phénomène général dans notre culture et effectivement en parlant avec beaucoup d’autres personnes, j’ai fait des constatations tout-à-fait analogues. Pour ma part, par exemple, j’ai pris cette décision générale de ne poursuivre des relations amoureuses avec une femme que dans la mesure où elles me sembleraient être un moyen pour établir une communication plus profonde. Si vous voulez, c’est juste un exemple particulier d’une façon dans laquelle chacun de nous peut dans l’immédiat transformer la façon dont il aborde les autres. De même, je peux vous dire que mes relations avec de mes enfants ont changés ; dans le sens où j’ai compris que, dans beaucoup d’occasions, j’ai exercé sur eux une autorité assez arbitraire disons, sur des choses qui, en bonne conscience, étaient de leur propre ressort. Ce sont donc là des choses qu’on peut modifier.
On peut se demander, à première vue, en quoi ce type de changement est-il lié, disons, aux problèmes globaux de la survie. J’en suis convaincu, mais je ne peux pas le prouver parce que rien d’important ne peut être prouvé ; on peut simplement le ressentir, le deviner. Mais je suis convaincu qu’effectivement ces changements dans les relations humaines vont être un facteur tout-à-fait déterminant, peut-être le plus important, dans les changements qui vont se faire d’un mode de civilisation vers un autre. Encore une fois, il est maintenant devenu tout-à-fait clair pour moi que ces changements ne se feront pas par la vertu d’innovations techniques, de changements de structures. Le changement véritablement profond qui va se faire, c’est un changement dans les mentalités et les relations humaines.
Question :
— Je voudrais revenir à la recherche scientifique. Vous parlez, en fait, des déviations de la recherche scientifique. Je suis en partie d’accord avec certains de vos diagnostics : le fait que nous recherchons trop la gloire personnelle, l’asservissement à la mode, les prétentions abusives de certains scientifiques, etc. Mais ceci est-il inhérent à la science ? La science, à mon avis, voudrait construire une nouvelle vision du monde. Quel but donneriez-vous à une autre pratique scientifique ?
Réponse :
— Quand on dit inhérent à la science, inhérent à quelle science ? Je pense que c’est inhérent à la science telle qu’elle est définie par la pratique des derniers siècles, telle qu’elle s’est développée depuis le début des sciences exactes. Je pense qu’elle est inhérente à la méthode même de ces sciences. Parmi les traits distinctifs de cette pratique scientifique, il y a un premier point qui est la séparation stricte de nos facultés rationnelles et des autres modes de connaissance. Donc une méfiance instinctive de tout ce qui est, disons émotivité, de tout ce qui est connaissance philosophique, religieuse, de tout ce qui est considération éthique, de tout ce qui est ressenti, sensoriel, direct. En ce sens nous avons plus confiance dans les indications d’une aiguille sur un cadran, qu’en ce que nous ressentons immédiatement, directement.
L’exemple suivant mesure très bien cette méfiance vis-à-vis du vécu immédiat ; je pourrais en citer bien d’autres, mais celui-ci me semble particulièrement frappant. C’est le cas de parents qui vont voir avec leur enfant un médecin en lui disant : « Nous sommes bien malheureux, notre enfant devient de plus en plus impossible en classe, il est kleptomane, il se bagarre avec tout le monde, chez nous il reste à bouder des journées entières, il fait pipi au lit, etc. » Et ils posent la question : « Est-ce que notre enfant est malade ? » On demande donc au spécialiste, à la personne qui sait, de prononcer une formule rituelle : « Votre enfant est malade » ou « Votre enfant n’est pas malade ». Dans le cas « Votre enfant est malade », on s’attend à ce qu’il prescrive un médicament, une méthode de traitement, quelque chose qui le fera revenir dans l’autre état, le cas « Votre enfant n’est pas malade » et un point ce sera tout. Mais si, par hasard, il dit : « Votre enfant n’est pas malade », les parents, un peu consolés, s’en iront chez eux et auront l’impression qu’il n’y a pas de problème qui se pose réellement. C’est, je crois, une des façons d’illustrer cet état d’esprit dans la science, de vouloir faire abstraction du vécu et tout énoncer en termes de normes purement rationnelles qui s’expriment, qui sont incarnées par des spécialistes.
Nous en arrivons ainsi au deuxième point, au deuxième vice de méthode, qui est inhérent à la méthode scientifique. C’est l’attitude analytique qui, bien entendu — je le sais bien — a été nécessaire pour le développement de ce type de connaissance. Le fait de diviser chaque parcelle de la réalité, chaque problème en des composantes simples pour mieux les résoudre et cette tendance à la spécialisation, comme on sait, est devenue de plus en plus grande. Chacun de nous ne saisit qu’une parcelle infime de la réalité. Ce qui fait que chacun de nous est parfaitement impuissant pour saisir, pour comprendre et pour prendre des options dans n’importe qu’elle question importante de sa vie, de la vie de la communauté ou de la vie du monde. Parce que n’importe quelle question importante a une infinité d’aspects différents, son découpage en petites tranches de spécialités est parfaitement arbitraire, et ce qu’un spécialiste tout seul ne peut pas faire, un colloque de cent spécialistes de spécialités différentes n’y parviendra pas non plus.
Finalement, de par sa propre logique interne, par l’évolution de la méthode analytique, on est arrivé à un point où, je crois qu’indépendamment de la question de la crise écologique, il y a une crise de la connaissance. En ce sens je crois que, s’il n’y avait pas eu la crise écologique, d’ici dix ou vingt ans on se serait tous aperçu qu’il y a une profonde crise de la connaissance, même au sens de la connaissance scientifique. En ce sens qu’on arrive plus à intégrer en une image cohérente une vision du monde — puisque après tout c’est à cela que nous voulons arriver — , à une vision de la réalité qui nous permette d’interagir de façon favorable avec elle à partir de nos petites tranches de spécialités. C’est un deuxième aspect qui me semble être devenu néfaste.
Il y en a un troisième lié à celui-ci. C’est que les spécialités s’ordonnent spontanément les unes par rapport aux autres, d’après des critères objectifs de subordination des unes aux autres ; de telle façon que nous voyons apparaître une stratification de la société en commençant, disons par une stratification de la science, d’après des soi-disant critères objectifs de subordination des spécialités les unes aux autres. En ce sens, la science, dans sa pratique actuelle telle qu’elle s’est développée depuis trois cent ou quatre cent ans, me semble être le principal support idéologique de la stratification de la société avec toutes les aliénations que cela implique. Je crois que, en ce sens, la communauté scientifique est une sorte de microcosme qui reflète assez fidèlement les tendances à l’intérieur de la société globale.
En outre, quatrième point, c’est la séparation dans la science entre connaissance d’une part et désirs et besoins d’autres part. La connaissance scientifique se développe d’après, soi-disant, une logique interne à la connaissance, d’après, soi-disant, des critères objectifs pour la poursuite de la connaissance. Mais en fait, en s’éloignant de plus en plus de nos besoins et de nos désirs véritables. La chose la plus frappante à cet égard me semble être l’état de stagnation relative dans laquelle se trouve l’agriculture, depuis quatre cent ans que les sciences exactes se développent, quand on la compare avec des branches en plein essor comme les mathématiques, la physique, la chimie ou plus récemment la biologie. L’agriculture après tout, est la base de nos sociétés dites civilisées depuis dix mille ans. C’est véritablement l’activité de base de la société, c’est de là que nous tirons l’essentiel des ressources pour satisfaire nos besoins matériels. On aurait pu penser qu’avec le développement de méthodes de connaissance nouvelle, elles seraient appliquées en priorité à l’agriculture pour nous permettre de nous libérer, dans une certaine mesure, de cette obligation d’un travail démesuré pour satisfaire nos besoins élémentaires. Il n’en a rien été. Encore actuellement, je crois que pour la plupart d’entre-nous, l’agriculture n’est pas considérée comme une science. Cela semblerait indigne d’un esprit brillant de s’occuper d’agriculture. Or, précisément, avec des techniques scientifiques nouvelles, la première chose à se demander c’est : « à quoi peut servir la science, le contenu de la science que nous développons ? » Je pense que parmi les thèmes les plus importants qui seront étudiés par une science nouvelle, il y aura précisément le développement de techniques agricoles nouvelles beaucoup plus efficientes et surtout beaucoup plus viables à longue échéance que les techniques qui ont été utilisés jusqu’à présent.
Voici donc quelques critiques de la pratique scientifique actuellement. D’après ce que j’ai entendu dire de certaines tentatives dans un sens novateur, je suis convaincu qu’on peut surmonter ces limitations de la science actuelle, qu’on peut donc développer une science qui soit directement et constamment subordonnée à nos besoins et nos désirs ; dans laquelle il n’y ait plus de séparation arbitraire entre l’activité scientifique et l’ensemble de nos modes de connaissance, où il n’y aurait plus de séparation arbitraire entre la science et notre vie. Du même coup aussi, les relations humaines qui sont promues par l’activité scientifique changeraient du tout au tout. La science ne serait plus la propriété d’une caste de scientifiques, la science serait la science de tous. Elle se ferait non pas dans des laboratoires par certaines personnes hautement considérées à l’exclusion de l’immense majorité de la population, elle se ferait dans les champs, dans les jardins, au chevet des malades, par tous ceux qui participent à la production dans la société, c’est-à-dire à la satisfaction de nos besoins véritables, c’est-à-dire en fait par tout le monde.
Donc, la science devient véritablement la science de tous. Pour les Nouveaux Alchimistes, ce groupe auquel j’ai déjà fait allusion, c’est même une nécessité du point de vue technique. En effet, leur intention, leur thème de départ, c’était de développer des biotechniques qui permettent, avec des moyens extrêmement rudimentaires ne faisant pas appel à l’hyperstructure industrielle et technologique, de créer des écosystèmes artificiels très productifs en nourriture. Les moyens technologiques au sens ordinaire, par exemple l’introduction d’une source continue d’énergie (l’électricité), ou l’approvisionnement en aliments par des industries chimiques (les engrais ou les aliments qu’on donnerait au bétail, aux poissons), peuvent être remplacés par une connaissance sophistiquée et globale des phénomènes naturels à l’intérieur de ces écosystèmes artificiels. Pour ce faire, ils se sont convaincus qu’il n’était pas pensable de la faire à l’intérieur des structures académiques existantes ; en fait, ce n’était pas possible même de le faire à l’intérieur de laboratoires fermés ; on ne pouvait le faire que sur le terrain, parce qu’il fallait tenir compte dans le développement de ces techniques de facteurs écologiques subtils qui varient énormément d’un microsystème écologique à un autre — et il y en a des milliers et des dizaines de milliers dans un pays tels que les États-Unis où il poursuivent leurs activités.
Donc, pour arriver à développer ces méthodes, c’est sur le terrain qu’il faut les développer et que tous doivent s’y associer virtuellement. Les Nouveaux Alchimistes sont en relation avec des millions d’américains intéressés par l’agrobiologie, « Organic gardening and farming », l’agriculture et le jardinage biologique, par l’intermédiaire de leur magazine Organic gardening and farming magazine. Parmi ceux-ci, il y a déjà des milliers de petites gens, de petits paysans, de petits jardiniers, qui leur ont écrit pour s’associer à leurs recherches concernant le développement de tels écosystèmes. Donc, actuellement, il ne s’agit pas seulement d’idées dans l’air, mais de choses qui sont en train d’être faites dans un pays aussi radicalement opposé à ce genre d’esprit que les états-Unis. Encore une fois, par des détails concrets dont m’as parlé John Todd, l’un des fondateurs des Nouveaux Alchimistes, il n’est absolument pas possible de promouvoir ce genre de recherches à l’intérieur des structures académiques existantes. Ils ont essayé, mais c’est impossible.
Question :
— Bien que 99% de la population n’ait pas accès à la science, il faut remarquer qu’elle a un respect plus grand de la science que vous et c’est basé sur un fait qui n’est pas simplement dû à son ignorance. Par exemple, on peut se poser la question : « combien de gens dans cette salle doivent la vie au fait qu’il y a eu cette science que vous décriez ? » Qu’il y a eu des retombées en médecine, par exemple, qui ne sont pas l’acuponcture, qui ne sont pas le remontée des matrices, mais qui sont simplement la pénicilline et un certain nombre de choses décisives qui ont fait que la population du globe a augmenté. Un certain nombre d’entre-nous, nous vivons, votre groupe s’appelle “vivre”, nous vivons parce qu’il y a eu cette science maudite.
Il est vrai que nous risquons la destruction et il est naturel qu’il y ait une réflexion sur ce qu’est la science aujourd’hui entre les mains de types qui semblent surgir du fond des âges, parce que ce sont des barbares qui sont prêts à l’utiliser pour détruire l’humanité. C’est vrai. Mais je trouve chez vous qu’une partie de cette réflexion est détruite par l’espèce de nihilisme absolu, de négation absolue, que vous professez à l’égard de la science.
J’ai relevé dans votre exposé un certain nombre d’affirmations péremptoires qui enlèvent une partie du poids à votre position :
• Vous avez émis le doute, il est basé sur les relations que vous avez avec certaines gens du CERN, que la recherche que nous pouvons faire, nous par exemple, n’a pas d’application militaire. C’est quelque chose que l’on peut parfaitement mettre en doute. On doit être, peut-être, tous complètement idiots [2], mais je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas que des collègues prendraient le moindre risque à venir nous dire : « En quoi ce que nous faisons risque d’avoir des applications militaires ? » Et ça me fait venir à quelque chose qui me paraît essentiel.
• Nous avons posé la question : « à quoi servent les mathématiques ? » Il faut continuer : à quoi sert la musique ? à quoi servent un certain nombre d’activités que les gens font simplement pour leur plaisir ?
• Enfin quel est votre conception de l’homme ? Il est vrai qu’un certain nombre de gens ont des activités auxquelles la masse n’a pas accès, mais je ne pense pas que c’est en décidant que M. Einstein ne doit pas faire de la recherche ou que M. Evariste Gallois ne doit pas faire de la recherche que vous arriverez à enrichir la vie des gens qui ne sont ni Gallois ni Einstein. Il y a des problèmes qui sont posés pour des gens qui ne sont ni Gallois ni Einstein et qui sont dans des grandes institutions dans lesquelles l’organisation de la recherche de façon industrielle pose des problèmes considérables, des angoisses considérables.
Mais je trouve qu’avec votre façon de rejeter totalement la science vous rejoignez Planète, vous rejoignez un certain nombre de…, vous voyez à quoi je pense…, vous rejoignez un certain nombre d’obscurantistes. Je m’excuse, comme je vous reçois dans l’estomac pour la première fois, je ne peux pas critiquer vos positions, mais il y a beaucoup de choses chez vous qui mériteraient un débat.
Réponse :
— Si vous me permettez, je vais dire quelques mots à propos de votre intervention.
Donc, vous me reprochez un nihilisme anti-science. En fait, c’est vrai que dans la mesure où par science on entend l’activité scientifique telle qu’elle est exercée actuellement, je suis arrivé à la conclusion que, par beaucoup d’aspects, c’est une des principales forces négatives à l’œuvre dans la société actuelle. Ce n’était sans doute pas le cas il y a deux cent ans et peut-être même pas le cas il y a cent ans. Actuellement je crois que la situation à beaucoup changé. Mais encore une fois, comme je l’ai dit tout à l’heure, je pense que l’activité scientifique actuelle est susceptible de se modifier très très profondément ; je pense que ceci ne se fera pas sans que la plupart des secteurs scientifiques actuels dépérissent purement et simplement. Je suis tout à fait convaincu que les recherches actuelles où l’on se met à cataloguer des particules élémentaires correspondant à tels ou tels opérateurs dans l’espace de Hilbert, ou les recherches mathématiques dans lesquelles j’ai été impliqué jusqu’à maintenant vont dépérir, non pas par un décret autoritaire de moi ou de personne d’autre, mais spontanément. Et ce lorsque les structures actuelles de la société vont s’écrouler, lorsque les rouages ne marcheront plus, parce que les mécanismes de la société industrielle, par son fonctionnement normal même, sont autodestructeur ; ils détruisent l’environnement et heureusement pour nous je dirais. De telle sorte qu’ils ne peuvent pas continuer à fonctionner indéfiniment, ils mettent en marche des processus irréversibles. Alors il y aura écroulement de nos modes de vie actuels. Lorsque nos cités, par exemple, s’écrouleront, lorsque personne ne payera plus les salaires qui nous permettent, grâce à une activité scientifique ésotérique, d’aller acheter les provisions dont nous avons besoin dans les magasins, d’acheter des habits, de payer nos loyers, etc. — et alors même que nous aurions l’argent, cet argent ne nous servirait à rien parce que la nourriture, il nous faudra l’arracher de la terre par nos propres moyens, parce qu’il n’y en aura plus assez — , à ce moment là, les motivations pour étudier les particules élémentaires disparaîtront entièrement.
J’étais moi-même assez fanatique, si l’on peut dire, de la recherche. J’étais vraiment très captivé, il y a de nobles passions. Mais à supposer même qu’il reste de physiciens — malgré une pression extrêmement forte des nécessités matérielles pour la survie — qui rêveraient de continuer la recherche, il ne faut pas oublier quand même qu’un accélérateur de particules ne se fabrique pas avec quelques morceaux de bois ; c’est quelque chose qui implique un effort social considérable et je doute fort que les autres membres de la société soient disposés à distraire des activités véritablement nécessaires pour établir un monde viable, digne d’être vécu, pour rebâtir des accélérateurs de particules et des choses analogues. En tout cas, je crois que, pour les accélérateurs et autres engins de ce genre, le large public n’a jamais été consulté. D’ailleurs, j’ajoute que s’il l’avait été, probablement qu’il l’aurait été de telle façon qu’il aurait dit « Amen ! ».
Après les leçons que chacun de nous qui survivra pourra tirer des événements qui accompagneront l’écroulement de la société industrielle, je pense que les mentalités auront très profondément changées. C’est pour cette raison que la recherche scientifique cessera, ce ne sera pas parce que tel ou tel aura décidé autoritairement que nous ne feront plus de recherches scientifiques à partir d’aujourd’hui. Elle cessera simplement, comme quelque chose qui, d’après un consensus général, sera devenu entièrement inintéressant. On n’aura plus envie, simplement, j’en suis persuadé, d’en faire. ça ne signifie pas que l’on aura plus envie de faire de la recherche tout court. La recherche, nos activités créatrices, se dirigeront dans des directions tout à fait différentes.
Je pense, par exemple, au genre de recherche que sont en train de poursuivre les Nouveaux Alchimistes avec des milliers de petites gens qui n’ont pas de formation universitaire. Ce sont des choses fascinantes qui mettront en jeu la créativité de chacun de nous de façon aussi profonde et peut-être aussi satisfaisante qu’actuellement les travaux ultra-spécialisés en laboratoire.
Nous avons été élevés dans une certaine culture ambiante, dans un certain système de référence. Pour beaucoup d’entre nous, d’après les conditionnements reçus dès l’école primaire en fait, nous considérons que la société telle que nous la connaissons est l’aboutissement ultime de l’évolution, le nec plus ultra. Enfin, c’est le cas pour la majorité des scientifiques. Mais nous oublions qu’il y a eu des centaines et des milliers de civilisations avant la nôtre, avec des cultures différentes, qui sont nées, qui ont vécu, qui ont fleuri et qui se sont éteintes. Notre civilisation, ou la civilisation industrielle — parce que je ne la considère plus comme la mienne —, n’y fera pas exception.
Une chose qui va au delà de cette remarque, à mon sens, c’est de réaliser qu’il s’agit d’un processus qui est vraiment devant nous, dans lequel nous sommes déjà engagés maintenant. En fait, la crise écologique, la crise de civilisation, ce n’est pas quelque chose pour dans dix ans ou dans vingt ans : nous somme en plein dedans. Je crois même qu’il y a de plus en plus de personnes qui s’en aperçoivent ; c’est une chose qui me frappe de plus en plus tout au long de ces derniers mois et de ces dernières semaines, à quel point des gens chez qui on s’y attendait le moins commencent à le ressentir. On gratte un tout petit peu en-dessous des choses superficielles qu’ils disent et on s’aperçoit qu’il y a un véritable désarroi concernant, disons, le sens global de la culture ambiante.
Voici donc concernant l’accusation de nihilisme. Donc, il y a du vrai dedans si on l’applique à une certaine forme d’activité scientifique. J’ai quelque peu oublié les autres objections que vous faisiez ?
Question :
— On doit la vie à la science !
Réponse :
— Je crois qu’il y a des choses utiles à dire à ce sujet. A supposer que certains ici doivent la vie à la science, on peut dire qu’il y a des centaines de milliers de gens au Viêt-Nam qui doivent également leur mort, et leur mort sous des conditions atroces, à cette même science. C’est là un argument un peu facile parce qu’il y a beaucoup de gens qui disent : « La science a été mal employée, le remède est de faire toujours la même espèce de science, mais de la mettre maintenant entre les mains de gens qui vont l’employer bien. » On nous dira, par exemple, que la médecine, les recherches biologiques, etc., c’est le type de science qui est utilisée surtout de façon bénéfique. Alors, là encore, il y a une façon facile d’y répondre en disant : le même genre de recherche fondamentale en biologie qui par un travail d’engineering va, par exemple, servir à développer des vaccins anti-poliomyélite ou contre d’autres maladies, ce même genre de recherche fondamentale, par un autre travail d’engineering, va servir à produire des souches de microbes très pathogènes, très résistants à tous les agents anti-biotiques et qui seront utilisés pour la guerre bactériologique. Donc, finalement, la recherche n’a pas d’odeur et quelles que soient les intentions de celui qui promeut un certain type de recherches — tout au moins le type de recherches qui est actuellement promu à l’intérieur de notre science traditionnelle — l’expérience a montré qu’elle est toujours détournable et détournée.
Comme j’ai donné ici l’exemple de la guerre bactériologique, on pourrait dire que les deux exemples sont un peu de même type. En ce sens qu’on peut les considérer comme liés à un accident, à savoir : l’existence d’appareils militaires, l’existence de nations antagonistes. Mais supposons que ces difficultés soient éliminées, que le rêve des citoyens du monde soit réalisé, qu’il y ait un gouvernement mondial. Ou bien supposons que les États-Unis, la Russie ou la Chine, au choix, ait absorbé l’ensemble de la planète, qu’il n’y ait plus qu’un seul pays. Ou supposons que la planète soit plus petite qu’elle n’est et qu’elle ne soit constituée que par les États-Unis, ou bien supposons que les États-Unis, par une politique isolationniste extrême arrivent à vivre en vase clos, et regardons ce qui se passe là-bas. Je prétends qu’en fait les problèmes sont plus profonds que cela, que les problèmes essentiels se posent encore dès lors même qu’il n’y aurait plus de problèmes militaires.
Prenons par exemple, les antibiotiques dont vous avez parlé, précisément parce qu’ils sauvent effectivement des vies humaines. Que voyons-nous, pour l’usage des antibiotiques ? Nous voyons que, lorsque nous avons le moindre rhume, n’importe quelle affection quelle qu’elle soit, nous allons au médecin. Qu’est-ce qu’il nous prescrit ? Il nous prescrit des antibiotiques. En fait, pour une simple fatigue, très souvent, il nous prescrit des antibiotiques. Il semble être pris sous une sorte de pression sociale. à savoir, son client attend de lui qu’il prescrive à chaque fois le remède qui est susceptible, le plus rapidement possible d’apporter une amélioration. Ceci sans préjudice de ce qui va se passer à longue échéance. Or, n’importe quel biologiste vous le dira, il n’y a pas besoin d’être un grand génie pour ça et même moi je le sais bien que je ne soit pas biologiste, le fait d’utiliser à titre routinier des antibiotiques est un véritable contresens. En effet, par cette pratique, nous contribuons à la formation de souches de microbes dans notre organisme qui vont développer une résistance, précisément aux antibiotiques que nous prenons. De sorte que, dans les cas véritablement graves où une intervention urgente par antibiotiques serait susceptible de nous sauver la vie, nous risquons de rester sur le carreau [NdE : L’augmentation des résistances est seulement maintenant reconnue par les pouvoirs publics, campagne publicitaire “les antibiotiques, c’est pas automatique” fin 2004]. Maintenant, nous sommes dans une situation où il est malaisé d’évaluer les bénéfices ou les avantages qu’il y a eu dans l’emploi des antibiotiques. Qu’est-ce qui l’emporte sur l’autre : est-ce que les dizaines de milliers de vies qui ont été sauvées par l’emploi des antibiotiques pèsent plus lourd dans la balance que, disons, les millions d’organismes qui ont été affaiblis dans leur résistance naturelle aux agents microbiens par l’usage inconsidéré des antibiotiques ?
Je ne trancherai pas ce problème, mais je dirais simplement qu’ici la question n’est pas une question technologique, ce n’est pas une question de connaissances. Il est bien clair que les biologistes ont les connaissances nécessaires pour décider, dès maintenant, que l’usage qu’en font les médecins, en clinique et dans leur pratique journalière, est insensé. C’est une question de mode de vie. C’est une question de civilisation. En fait, je ne dis pas qu’il faut bannir nécessairement les antibiotiques dans une société idéale future. Les antibiotiques sont des champignons qui peuvent être produits avec des moyens extrêmement rudimentaires, sans utiliser les grandes hyperstructures de l’industrie lourde. On peut donc fort bien utiliser les antibiotiques dans une société très décentralisée dans laquelle des communes de quelques centaines ou quelques milliers d’habitants vivraient en autarcie relative. Il est tout-à-fait possible et probable que les antibiotiques continueront à être utilisés dans des sociétés post-industrielles, dans certaines du moins. Ce n’est pas parce qu’ils ont été produits dans notre culture scientifique occidentale actuelle qu’il faudrait mettre l’interdit général contre ce genre de procédé. Je crois qu’il y a lieu de juger sur pièces et que ce n’est pas un travail théorique à faire maintenant, à savoir : de séparer le bon grain de l’ivraie dans l’ensemble de nos connaissances scientifiques et des techniques actuellement disponibles. C’est, je crois, un travail qui se fera au jour le jour, suivant les nécessités de l’heure. C’est-à-dire que c’est un travail qui ne se fera pas par quelques spécialistes, biologistes, médecins, psychiatres, physiciens, etc. Il se fera par tout le monde au fur et à mesure des besoins. On verra bien de quoi on a besoin dans le grand amas de connaissances scientifiques dont je suis convaincu que la plus grande partie est parfaitement inutilisable et va dépérir complètement.
Question :
— Qu’en est-il des relations entre le CERN et les militaires ?
Réponse :
— Je n’ai pas d’informations secrètes à ce sujet. Je ne prétendais pas parler, disons, de relations réelles, officielles ou occultes, entre le CERN et les appareils militaires. Je n’ai pas connaissance de telles choses. Je voulais parler de l’image que le nom du CERN a sur une large partie du public plus ou moins cultivé, par exemple moi-même. Le nom déjà : Centre Européen de Recherches Nucléaires. Le fait qu’il soit un organisme qui regroupe un certain nombre de pays, le prestige qui lui est attaché et que vous ne nierez sans doute pas ; le fait également qu’il s’agisse de recherches concernant tout au moins l’atome, même si ce ne sont pas des « recherches nucléaires » et ceci, lié à la préoccupation, aux soucis grandissants dans le public vis-à-vis, précisément, de l’atome, y compris de l’atome pacifique, tout ceci crée une certaine résonance concernant le CERN qu’on ne peut pas nier. A cela près que, en ce qui me concerne, de toute façon, le genre de recherches, le genre de pratique scientifique qui est poursuivi dans le CERN, comme dans n’importe qu’elle autre institution scientifique actuelle — mais encore plus à cause, malgré tout, des connotations générales de la recherche atomique avec les périls liés à notre survie —, tout ceci a comme effet de créer une gêne, je crois, chez beaucoup et chez moi en particulier.
Question :
— Et Evariste Galois ?
Réponse :
— Il est mort le pauvre.
Question :
— Vous avez signalé de nombreuses choses mauvaises et je suis d’accord avec vous, elles devraient être changées. La question est : « Quel est le rapport avec la science ? » Vous signalez que de nombreux scientifiques sont cupides, recherchent les honneurs, sont imbus de hiérarchie, etc. Est-ce vraiment différent parmi les artistes, les fermiers, les politiciens et d’autres ? De même, vous signalez de nombreuses choses déplorables sur le plan humain : des gens se suicident ou vont se suicider, ont des dépressions nerveuses. Ici aussi, en est-il autrement parmi les politiciens, les hommes d’affaires, etc., et la science est-elle responsable de ces malheurs ? Est-ce seulement la science qui rend les gens cupides ou suicidaires ?
Et, pour prendre un exemple, il a existé des poètes qui ont écrit de très belles choses sans avoir aucune communication, disons, avec leur femme. Pensez-vous que là encore la science est vraiment responsable de ce manque de communication ? Je crois que c’est plutôt propre à la nature humaine et que c’est mauvais. Nous devons lutter contre cela, mais cela n’a rien à voir avec la science.
Et enfin, à propos des guerres, à propos du Viêt-Nam. Nous sommes tous d’accord que c’est une tragédie. Mais la science en est-elle responsable ? Je veux dire, il y a trois mille ans, pensez-vous que cela était fondamentalement différent ? Merci.
Réponse :
— Je suis tout à fait d’accord avec vous pour constater que la plupart des aspects de la pratique scientifique que j’ai mis en avant — un certain nombre du moins — ne sont pas spécifiques aux milieux de la recherche scientifique. Je ne pense pas qu’il y ait nécessairement plus de suicides, disons, parmi les mathématiciens que dans les autres professions. Pourquoi est-ce que j’en ai parlé ? Simplement, c’est parce qu’on parle mieux, malgré tout, du milieux que l’on connaît : on en parle de première main. Et j’en ai parlé parce que, finalement, il y a un certain mythe qui veut que les choses soient mieux dans la communauté scientifique ; qui veut, par exemple, que l’activité scientifique soit nécessairement source de satisfaction, source de plaisir, de joie. Alors que, dans un certain nombre de cas, on peut montrer que c’est précisément l’activité scientifique qui est source de contraintes, de répressions et de drames. Je connais d’autres cas, disons moins extrêmes que celui-là, dans ma pratique personnelle. Mais c’est pour aller à l’encontre de certains mythes que j’ai parlé de ces cas-là. Autrement, je suis tout-à-fait d’accord avec votre objection. Donc, finalement, je crois qu’il y a un malentendu, ce n’est pas vraiment une différence de vision importante.
En ce qui concerne l’autre question, je ne pense pas que la science soit la seule cause de la situation assez catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. J’avais dit dès le début que c’est une des causes. En tout cas, si cette cause n’existait pas, les problèmes liés, disons, à la survie de l’homme ne se poseraient pas actuellement. Ils se poseraient peut-être dans quelques siècles, mais ils ne se poseraient pas à l’heure actuelle. Bien entendu des guerres comme celle du Viêt-Nam pourraient fort bien avoir lieu et ont eu lieu sans que la science ait le développement actuel. Ce qui est frappant, je crois, pour un scientifique, c’est de constater à quel point les techniques les plus modernes trouvent leur application dans cette guerre. Je suis allé au Viêt-Nam du Nord et j’ai pu discuter sur place avec les intéressés sur les différents perfectionnements des bombes à billes, par exemple. Les billes ont un mouvement de rotation très rapide afin de mieux déchiqueter les chairs et de manière aussi à ce qu’elles puissent pénétrer à l’intérieur des abris anti-aérien qui sont creusés un peu partout le long des rues et le long des routes, pour peut que l’on ait pas pris soin de les fermer. Et enfin, elles éclatent en l’air pour mieux frapper les populations civiles. D’ailleurs, malgré les consignes, la plupart des vietnamiens, comme ils ont envie de voir ce qui se passe, ne ferment pas les trous. Ainsi, lorsque les bombes explosent, ceci rend ces abris à peu près illusoires. De même, les billes de métal ont été remplacées par des billes en plastique pour que leur détection par des moyens de radiographie soit impossible. Il faut donc développer des techniques nouvelles pour arriver à extraire ces billes des chairs déchiquetées. La technologie militaire employée au Viêt-Nam est orientée plus vers une mutilation de la population que vers son extermination directe, parce qu’une personne mutilée demande des soins de beaucoup d’autres gens pour la maintenir en vie, tandis qu’une personne tuée en demande très peu. Il y a donc un certain nombre d’aspects assez atroces de la technologie liées véritablement à une recherche, à l’état actuel de la science.
Par ailleurs, il y a une chose dont je ne me rendais pas compte au moment où j’ai commencé à réfléchir sur ces questions, c’est que pratiquement toutes les grandes firmes commerciales américaines sont directement impliquées dans la fabrication des armements. C’est vrai dans une moindre mesure pour les firmes françaises ; je ne sais pas ce qu’il en est pour les firmes suisses. Au moment où j’ai quitté l’institut où je travaillais à cause de la présence de 5% du budget qui était d’origine militaire, je ne voyais rien à redire au fait que la plupart des fonds provenaient de firmes telles que Esso, Saint-Gobain et autres. Mais depuis lors, j’ai découvert que ces firmes sont très directement impliquées également dans ces fabrications d’armement, elles ont toutes d’important contrats avec l’armée. De telle façon que, finalement, il devient impossible de distinguer entre la recherche militaire et la recherche tout court, et même entre, disons, les firmes d’usage courant et les firmes liées à la prolifération des appareils militaires. Finalement, j’ai fini par m’apercevoir que tout était inextricablement lié.
Au fait, je m’aperçois qu’il y a une question à laquelle je n’ai pas répondu, qui était peut-être liée à Galois. C’était l’affirmation qu’il était bon de poursuivre la recherche scientifique pour elle-même, pour le plaisir de la connaissance, au même titre que l’on poursuit une activité artistique. Alors là, il y a peut-être une ou deux choses à dire.
Une première chose est que pour arriver à comprendre et à apprécier le genre de mathématiques que je faisais, par exemple, il y a trois ans encore. à supposer même que l’on court-circuite les canaux habituels dans l’enseignement, que l’on aille directement au fait, à l’essentiel, il faut compter quelque chose comme une formation spécialisée de cinq à dix ans. Or, il est clair qu’une telle formation sera dans l’état actuel des choses l’apanage d’une infime minorité de la population. D’autre part des centaines d’autres mathématiciens font des choses tout aussi ésotériques dans leur coin. De telle façon que finalement, ceux qui arrivent à comprendre le genre de chose que je faisais, une chose à laquelle je me livrais intensément depuis quelques années, sont — que sais-je — peut-être cinq, dix quinze, vingt personnes au monde, quelque chose dans ce goût-là. Alors, l’importance que peut avoir du point de vue artistique, disons, l’activité mathématique est très différente de l’importance que peut avoir, par exemple, la musique. Pour ressentir la musique, nous n’avons pas besoin d’une longue formation. En fait, nous n’avons pas même besoin d’être encore né, parce que même un embryon, dans le ventre de sa mère, réagit déjà aux stimuli musicaux. Je crois que pas mal de personnes ont dû en faire l’expérience, en tous cas ma femme l’a faite : lorsqu’il y avait une musique de jazz, alors qu’elle était enceinte depuis cinq ou six mois, le bébé dansait dans son ventre. Bien entendu, quand je parle d’art ici, je parle de l’art élémentaire, de l’art que nous pouvons apprécier, et même que nous pouvons faire chacun de nous : de la musique, du dessin, de la poterie, des choses comme cela, qui demandent une formation relativement minime.
Mais il est vrai que dans les arts, comme dans les sciences, comme dans pratiquement toute activité humaine, également dans l’activité physique, dans les sports, l’aspect de compétition prend de plus en plus d’importance. Actuellement, chez presque tous, quand on dit art, le réflexe est de penser à des gens comme Rubinstein, Gieseking ou Heifetz, ou bien comme Picasso, etc. C’est-à-dire de penser immédiatement aux grands virtuoses de l’art, ceux qui sont arrivés à une position de prestige extraordinaire. Finalement, l’art devient l’apanage d’un tout petit nombre de gens qui font de l’art pour nous, par procuration, parce que là il n’est absolument plus question que chacun de nous en fasse autant dans sa propre vie.
Or, c’est encore une des choses qu’on pourrait dire à propos de la question de ce que l’on entend par une vie qui vaut la peine d’être vécue : C’est une vie qui, précisément, contienne sa part de créativité, y compris sa part de créativité artistique. Il est beaucoup plus important que chacun de nous soit capable d’être artiste dans son propre domaine et à son propre niveau, à produire de la musique, à en exécuter, disons, sur un harmonica, sur un piano ou sur une guitare et à en retirer un plaisir direct. Ce plaisir, je crois, sera infiniment plus profond que le plaisir qu’il pourra avoir à écouter un disque de Heifetz ou de Gieseking. Il est d’une autre nature, en tous cas, il se place à un autre niveau. Peut-être que l’un n’empêche pas l’autre, ce n’est d’ailleurs pas clair. J’ai l’impression que le genre de mentalité qui règne parmi les grands virtuoses — qui leur fait exécuter, par exemple, cinq heures de gammes par jour, jour après jour — finit par tuer une grande part de la joie qu’ils ressentent à faire de la musique. Et ceci est nécessaire pour arriver à tenir le coup dans la compétition très forte qui s’exerce entre virtuoses. Je crois qu’elle est à peu près du même type que la compétition, parfois inconsciente, qu’il y a entre scientifiques. Compétition qui fait que des gens que je connais, y compris moi-même parfois, passent quinze heures de leur journée, jour après jour, pendant longtemps, à essayer de développer des théorèmes mathématiques de plus en plus sophistiqués, de plus en plus ésotériques. J’ai l’impression que ce type de mentalité disparaîtra dans les générations qui viennent.
Question :
— Ne pensez-vous pas qu’il y a quelque chose de beaucoup plus — quel que soit le mode de la civilisation et qui est propre à l’homme : cette liberté troublante de se poser des questions, de se demander « Pourquoi, par exemple, les planètes tournent de cette façon autour du soleil ? » ; « Pourquoi sommes-nous malheureux ? ». Cette grande liberté me paraît un peu, elle aussi, être condamnée vis à vis de la science. Parce que, en fait, nous avons aussi cette liberté de dire que la science est un malheur. En nous faisant prendre conscience que la science actuelle est mauvaise, vous supprimerez peut-être à l’avenir toute la liberté aux autres. Peut-être un jour la science pourrait apparaître bonne. En quelque sorte, comme un pendule, l’homme est à la fois cohabité par l’ange et le démon. Vous voudriez simplement qu’il soit habité par l’ange. J’en sera ravi, mais l’histoire humaine à montré souvent, n’est-ce pas, qu’il oscille entre le mauvais et le bien. Vous prévoyez peut-être que le pendule ira cette fois-ci du bon côté. J’espère avec vous, mais je ne sais pas si ce pendule sera arrêté à l’avenir à cette position.
Réponse :
— Une de vos questions est de savoir si en tournant le dos à la science telle qu’elle se fait actuellement et, éventuellement, en retirant aux gens la liberté de se poser le genre de questions que se pose la science actuelle, on ne va pas supprimer en même temps la liberté ou une partie appréciable de la liberté.
Je voudrais dire à ce propos que moi-même et mes amis de Survivre et Vivre ne recommandons nullement de prendre des mesures coercitives qui empêcheraient qui que ce soit de faire de la science. La question n’est pas là. Si je prévois que la science, telle qu’elle est pratiquée actuellement, va dépérir, que par exemple la mathématique toute entière, à peu de choses près, va disparaître dans les générations qui viennent, c’est qu’il s’agira d’un dépérissement tout naturel parce que les gens ne se sentiront plus incités à en faire. Ainsi, pour faire un parallèle à une échelle moindre, je crois que c’était dans le premier siècle de notre ère, la science des sections hyperplanes, des sections coniques et des faisceaux de coniques était arrivée à un degré de complexité tel que les mathématiciens de cette époque pensaient que c’était la fin de la mathématique, parce que de toute façon, en allant plus loin, les choses deviendraient d’une complexité telle qu’il serait impossible à l’esprit humain de s’y reconnaître. Or il est arrivé que, purement et simplement, on a complètement laissé tomber ce genre de spéculations et la mathématique a continué dans des voies entièrement différentes et on s’aperçoit bien que la mathématique n’a pas cessé de produire du neuf jusqu’à aujourd’hui. Dans le même ordre d’idées, je pense que la direction de recherches qui s’est développé depuis 400 ans, disons, dans un certain esprit, va dépérir de la même façon et que l’esprit humain prendra des avenues très différentes. Non pas de façon coercitive, simplement parce que ce ne sera plus pratiqué. Il y aura d’autres impératifs liés à nos besoins véritables.
Je pense que l’agriculture, l’élevage, la production d’énergie décentralisée, une certaine espèce de médecine très différente de la médecine qui prévaut actuellement, vont être à l’avant plan. Il est impossible de dire quelle sera la part de joie purement créatrice dans ces développements nouveaux. J’espère que ce sera un développement créateur où il n’y aura pas de différences essentielles entre activités conceptuelles et activités physiques manuelles. Quand les hommes deviendront suffisamment maîtres de leurs besoins pour qu’une part appréciable de leur créativité reste libre — et ceci prendra un temps qu’on ne peut pas prévoir, ce sera peut-être une génération, peut-être dix, nul ne sait — à ce moment-là, n’importe qui, pas seulement une certaine élite scientifique, sera en mesure de dédier une partie importante de son temps à des recherches purement créatrices, purement spéculatives, purement ludiques. Même si on reprend certaines directions de recherches qui auraient été abandonnées entre temps, par exemple certaines directions de la mathématique actuelle ou même de la physique — si la société est prête à les prendre en charge, parce que la physique actuelle ne se fait pas simplement par la tête, elle se fait avec une instrumentation sérieuse, avec des mises de fonds, implique la mobilisation d’une énergie collective importante — , à ce moment-là, je n’y vois pas d’inconvénient ; mais je crois qu’il est absolument impossible de le prévoir maintenant. En tout cas, je suis d’accord avec vous que la liberté est véritablement un critère essentiel pour les directions à prendre ; enfin, pour moi elle l’est certainement. Je pense que rien de nouveau se créera en dehors de la liberté et même, encore une fois, que le dépérissement de la science actuelle augmentera notre liberté, et ce ne sera pas aux dépends de la liberté de qui que ce soit.
à propos de votre image de l’homme ange et démon, je ne crois pas à cette dichotomie du bien et du mal. Je ne partage pas cette façon de voir ; il y a plutôt un mélange complexe de deux principes opposés. Si vous le permettez, je vais faire une petite digression philosophique concernant le mode de pensée mathématique et son influence sur la pensée générale. Une chose m’avait déjà frappé avant d’en arriver à une critique d’ensemble de la science depuis près de deux ans : c’est la grossièreté, disons, du mode de raisonnement mathématique quand on le confronte avec les phénomènes de la vie, avec les phénomènes naturels. Les modèles que nous fournit la mathématique, y compris les modèles logiques, sont une sorte de lit de Procuse pour la réalité. Une chose toute particulière aux mathématiques, c’est que chaque proposition, si l’on met à part les subtilités logiques, est ou bien vraie ou bien fausse ; il n’y a pas de milieu entre les deux, la dichotomie est totale. En fait, cela ne correspond absolument pas à la nature des choses. Dans la nature, dans la vie, il n’y a pas de propositions qui soient absolument vraie ou absolument fausses. Il y a même lieu souvent, pour bien appréhender la réalité, de prendre en ligne de compte des aspects en apparence contradictoires, en tout cas, des aspects complémentaires, et tous les deux sont importants. D’un point de vue plus élémentaire, aucune porte n’est jamais entièrement fermée ou entièrement ouverte, ça n’a pas de sens. Cette dichotomie qui provient peut-être de la mathématique, de la logique aristotélicienne, a vraiment imprégné le mode de pensée, y compris dans la vie de tous les jours et dans n’importe quel débat d’idées ou même de vie personnelle. C’est une chose que j’ai souvent remarquée en discutant avec des personnes, que ce soit en privé ou en public. En général, les personnes voient deux alternatives extrêmes et ne voient pas de milieu entre les deux. Si mon interlocuteur a choisi une certaine alternative et que j’aie une vision qui se situe au-delà de celle qu’il considère comme bonne, tout aussitôt, il m’accusera d’avoir choisi l’alternative extrême opposée, parce qu’il ne voit pas le milieu.
Je crois qu’il y a là un vice de pensée inhérent au mode de pensée mathématique et j’ai l’impression qu’il se reflète également dans cette vision manichéenne de la nature humaine. Il y a d’une part le bon, d’autre part le mauvais et dans le meilleur des cas on les voit cohabiter. J’ai l’impression que ce que nous appelons mauvais n’est qu’une réaction naturelle à une certain nombre de répressions que nous subissons depuis notre naissance ; en un sens ce sont des réactions tout aussi naturelles, tout aussi nécessaires que, par exemple, l’apparition de la fièvre — signe que notre corps est en train de réagir douloureusement et positivement à une invasion microbienne. La tâche du médecin n’est pas d’éliminer la fièvre, mais d’essayer de combattre l’invasion microbienne par des médicaments. Ceci est tout au moins la thèse officielle. Peut-être la tâche du médecin de l’avenir sera-t-elle surtout de comprendre la cause psychosomatique de la prolifération microbienne à ce moment plutôt qu’à un autre, alors qu’il y a toujours des microbes dans l’environnement et alors que nous y sommes exposés tout le temps : quelles sont les causes véritables, quelles sont les tensions auxquelles nous avons été soumises et qui nous rendent vulnérables. Mais ceci est une autre paire de manches. Donc, j’ai l’impression que la vision manichéenne n’est pas très bonne. Elle fait partie de l’air que nous respirons avec la culture ambiante et je crois que cette vision va encore se modifier.
Question :
— Vous pensez que cette vue du juste et du faux, c’est de l’air que nous respirons et qui vient de la mathématique. Moi, je crois plutôt le contraire. La mathématique moderne est plus jeune que toute notre philosophie médiévale ou même que la théologie. Parce que cette pensée qu’il y a le bon Dieu et le Diable, les deux adversaires, elle est très ancienne. Il se peut que les mathématiciens médiévaux du XVe et du XVIe siècle étaient tellement imprégnés de cette idée qu’il était naturel de penser comme cela. à propos de l’autre exemple, je pense qu’avant que la médecine n’arrive au point actuel, on essayait aussi d’expulser les mauvais esprits, le Diable. Donc, c’était la même idée. Je voulais juste émettre un doute, je le vois juste à l’envers. Je ne dirai pas que c’est un vice qui est dû à la mathématique seulement, mais je dirai qu’elle à peut-être hérité cela du passé.
Réponse :
— Bourbaki n’est pas à l’origine de la mathématique ; dans ses notes historiques, Bourbaki la fait remonter aux mathématiciens Grecs, disons à partir de Pythagore. C’est donc déjà une tradition très ancienne. Prenons par exemple Euclide qui a développé cet esprit systématique de façon absolument parfaite, de telle sorte qu’il a été enseigné jusqu’à il n’y a pas tellement longtemps encore. Il est donc possible que la mathématique soit pour quelque chose dans cet état d’esprit ; même s’il n’y a pas — je ne peux pas en jurer — un effet de causalité. Enfin, le fait que les deux choses aillent dans le même sens, la dichotomie mathématique et le manichéisme ou cette tendance à ne voir toujours que les deux extrêmes d’une alternative, ça ne peut guère être le hasard ; il y a certainement corrélation entre les deux. Ce sont des choses liées dans la culture dominante. Cette culture dominante, de toute façon, ne date pas d’hier, je pense qu’elle s’est développée depuis plus de deux mille ans. Je ne suis pas très ferré en histoire mais, par exemple des gens comme Jacques Ellul ou Lewis Mumford ont étudié précisément les tenants et les aboutissants idéologiques de la science et de la technologie depuis les origines ; en ce qui concerne Mumford, il me semble qu’il les situe déjà du temps de pharaons, des grands travaux de l’Egypte. Donc, je crois que nos ancêtres, à ce sujet, remontent assez loin. Mais il y avait une autre question je crois ?
Question :
— ………DÉBUT DE LA QUESTION INAUDIBLE……… de démystification ou de dénonciation du rôle de la science et surtout la motivation du scientifique, même si cela est peut-être incomplet. Je crois par exemple qu’on pourrait discuter longtemps et noter les rôles importants qu’a, à mon avis, la science dans la conservation même des structures sociales de notre société. J’ai trouvé un peu préoccupante la sorte d’interprétation qui pouvait découler de votre exposé sur la solution qui peut être trouvée à cette difficulté. La solution de se retirer, disons, du travail qui finalement est la raison pour laquelle la société vous paye est une solution de luxe qui ne peut être accessible qu’à très peu de gens et qui ne peut pas être érigée en solution. Matériellement, un ouvrier ne peut pas se retirer du travail pour développer sa sensibilité. à mon avis, si un ouvrier ne se cultive pas, ce n’est pas parce qu’il n’en a pas envie, ou ne comprend pas quels sont les vrais problèmes ; c’est parce que le poids écrasant de la société et des rythmes de travail, des conditions de vie auxquelles il est soumis ne lui offrent aucune autre possibilité. à mon avis, ce n’est pas les symptômes qu’il faut soigner, c’est la maladie. La maladie est entièrement basée dans la structure sociale. à mon avis, c’est seulement en participant à ces changements de structure qu’on pourrait un jour envisager de trouver un rôle nouveau soit dans la sensibilité de chacun, soit un rôle nouveau de la science elle-même. Ce n’est pas en faisant un peu de théorie — ici, sur quel est le rôle de la science —, qu’on pourra trouver notre place. Je crois que la participation à cette lutte est difficile pour un scientifique parce que justement la parcellisation des activités sociales la rend difficile. Je crois que la participation à cette lutte ne peut se faire qu’à partir de son poste de travail parce que le poste de travail est l’arme de tout le monde et je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour un scientifique.
Réponse :
— Je pense qu’il y a un malentendu en ce sens que vous croyez que je préconise telle ou telle solution. Or, effectivement, j’ai parlé de mon expérience personnelle, de ma pratique personnelle, à titre d’illustration d’un type d’action, de conclusions qu’on peut tirer lorsqu’on est confronté avec certaines contradictions. Toutefois, ce n’est absolument pas dans l’intention de me poser en modèle pour qui que ce soit. Je réalise bien que les conditions dans lesquelles sont placés les uns et les autres sont extrêmement différentes. D’une part les conditions dites objectives et ensuite les conditions subjectives, disons, l’état de préparation nécessaire pour prendre des décisions assez draconiennes ; comme celles que j’ai prises en quittant l’Institut dans lequel je travaillais et un peu plus tard en décidant d’arrêter la recherche scientifique. Ce qui n’empêche pas d’ailleurs, que je suis encore payé pour enseigner, l’année dernière et cette année-ci, la science très ésotérique au Collège de France et que l’an prochain je serai ou bien enseignant à la Faculté des Sciences ou bien directeur de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). C’est-à-dire que je n’aurai pas échappé à la contradiction de mon état scientifique.
Finalement, ce qui compte pour moi, ce n’est pas tellement d’atteindre la position de pureté morale qui est parfaitement impossible à l’intérieur de cette société — c’est une des nombreuses choses que j’ai apprises au cours de ces deux dernières années —, ce qui compte c’est que nous soyons un ferment de transformations, un facteur de transformations là où nous nous trouvons. Bien entendu, si nous nous trouvons dans un certain milieu professionnel, il ne s’impose pas nécessairement que nous quittions ce milieu professionnel. Mais ce dont je suis convaincu, c’est que cette transformation ne se fera pas par la vertu magique d’adhérer à un certain parti ou, de temps en temps, de distribuer des tracts, ou encore d’adhérer à certains syndicats ou de déposer des bulletins de vote. Je suis entièrement persuadé que ce genre de transformation se fera, pour commencer, au niveau des relations personnelles. Dans la mesure où ces relations personnelles ne changeront pas profondément, rien ne changera. Si l’on pense que les relations personnelles ne peuvent changer qu’après le changement des structures — cela signifie qu’on renvoie tout au grand jour J de la révolution — la révolution ne viendra jamais ou la révolution qui viendra ne changera rien. C’est-à-dire qu’elle mettra une équipe dirigeante technocratique à la place d’une autre équipe technocratique et la société industrielle ira son chemin comme par devant.
Comme exemple de relations qui devront changer de façon radicale, je pense par exemple aux relations entre les enseignants et les étudiants. Je serais probablement confronté dès cet automne à cette situation. C’est la première fois de ma vie d’ailleurs que je serais dans un amphithéâtre avec des étudiants auxquels je devrais pour de bon enseigner les mathématiques qui vont les préparer à certains examens, leur procurer certains diplômes, dont je suis convaincu qu’ils ne servent à rien. D’une part, ils ne servent à rien pour la société dans son ensemble et d’autre part, il n’est même pas clair qu’ils servent à quelque chose à ceux qui auront ce diplôme, parce qu’il n’est absolument pas clair que cela leur permettra d’avoir un métier par la suite. Aujourd’hui encore, la plupart des scientifiques ou bien se refusent à voir le problème ou bien, s’ils le voient, posent un voile pudique par dessus dans leurs relations avec les étudiants. Les relations entre les étudiants et eux sont donc des relations traditionnelles de professeur à étudiant ; c’est-à-dire qu’ils font un cours technique, celui qu’on leur demande, un point c’est tout. Lorsque, exceptionnellement, les étudiants posent des questions techniques, on répond à ces questions techniques du mieux que l’on peut et c’est tout. En ce qui me concerne, j’ai décidé de ne pas m’en tenir à ce type de relations et de ne plus séparer l’enseignement mathématique d’une discussion cartes sur table avec des étudiants ou tous ceux qui voudront venir assister à la discussion pour essayer de faire le point : « Pourquoi est-ce que nous sommes là ? » ; « Qu’est-ce que nous allons apprendre ensemble ? » ; « Pourquoi ? » ; « Que signifie l’examen qui est au bout du programme de cette année ? » ; « Quel est son sens ? » ; « Quel est notre rôle mutuel, moi professeur et vous étudiants ? ». Et enfin, décider ensemble de ce que l’on fera. Sans doute, dans les premières années, à moins que la situation ne mûrisse encore plus vite que je ne le prévois, il est probable que les étudiants, dans leur majorité, insisteront pour que, une fois ces discussions terminées, on suive plus ou moins le programme traditionnel et qu’on fasse le rituel d’usage des examens. Il est possible aussi qu’ils en décident autrement, auquel cas je me plierai à leur avis. De toute façon, il y a là la possibilité d’un échange dynamique, d’un mûrissement de l’atmosphère générale.
En fait, j’ai commencé à mettre ces idées en pratique cette année même au Collège de France où j’avais annoncé, comme première partie au cours de mathématique prévu, une discussion sur le même thème que notre discussion d’aujourd’hui. Cette proposition a donné lieu à un débat assez vif parmi mes collègues du Collège de France. Pour la grande majorité d’entre-eux, c’était une chose absolument impensable qu’un cours de mathématique puisse être partiellement et officiellement consacré à une question de ce type. En fait, le titre était plus long : « Sciences et techniques dans la crise évolutionniste actuelle, Allons-nous continuer la recherche scientifique ? ». Je posais donc la question de la crise de civilisation qui me semble être la question urgente à débattre actuellement. Or, peut-être pour la première fois ou une des rares fois que dans cette auguste institution on pose une question véritablement brûlante pour la civilisation dans laquelle nous sommes et qu’on se propose de la discuter publiquement et en profondeur, c’est pratiquement la seule fois où le corps professoral réuni refuse de donner son approbation à ce sujet de cours. En effet, le vote a donné quelque chose comme trente cinq voix contre et neuf voix pour et j’ai été moi-même surpris de trouver neuf collègues pour soutenir mon initiative. Cette surprise était d’ailleurs, j’en suis convaincu, beaucoup plus grande chez les trente cinq autres. D’après le ton sur lequel avait lieu cette discussion, il était clair que, pour eux, c’était impensable qu’un scientifique dans son sens commun puisse ne pas être choqué par le genre de proposition que je faisais pour ce cours soi-disant de mathématiques.
Ceci, bien entendu, juste à titre d’exemple, non pas pour dire que tout le monde peut faire la même chose, mais à titre d’exemple concret de ce que, personnellement, j’essaie de faire pour tirer parti d’une situation simplement contradictoire. Au lieu d’essayer de cacher ces contradictions, j’essaie de les faire éclater le plus brutalement possible et ceci comme un moyen de faire mûrir une certaine situation.
Question :
— Vous avez fait constamment référence à la recherche scientifique, mais j’ai l’impression que vous donnez au terme une signification trop restreinte. J’ai l’impression que pour vous ce sont les mathématiques bien sûr, ensuite la physique, quelque chose comme ça, à la rigueur la recherche médicale. Mais il me semble que vous ignorez qu’il y a la recherche en sciences sociales, la recherche en sciences de l’homme. Vous parlez en termes apocalyptiques de ce qui va arriver à la société, à la civilisation, comme si c’était quelque chose qui devait arriver fatalement et de façon incontrôlable par l’homme. Je ne suis pas d’accord avec vous parce que, précisément, les sciences de l’homme permettent de contrôler cette évolution. On peut déjà observer le travail concret des agences publicitaires pour ne pas parler de choses beaucoup plus graves que la consommation du Coca-Cola. Vous parlez en termes apocalyptiques de choses qui doivent arriver comme des choses incontrôlables pour l’homme et là je crois que vous avez tort parce que si vous voulez modifier la société dans un sens — et je suis tout à fait d’accord avec vous qu’il faut la modifier, même si je ne suis pas tout à fait certain que ce soit dans le même sens, mais en tout cas on est d’accord sur la principe — , je crois au contraire qu’il faut faire cette science maudite, comme le disait le monsieur, pour pouvoir nous aussi contrôler cette évolution que vous présentez dans les caractéristiques de fatalisme. D’autre part, lorsque vous dites que vous allez discuter avec les étudiants de quels seront vos rapports avec eux, vous allez faire une science de l’homme que l’on appelle la communication pédagogique. Ce n’est pas les mathématiques, mais c’est de la science. Je crains que fatalement vous retombiez soit dans la religion, soit dans la science parce que ou bien vous faites des prophéties apocalyptiques ou bien vous essayez de faire avec vos étudiants, de réinventer des sciences qui sont déjà faites.
Réponse :
— Vous parlez d’une vision apocalyptique de la civilisation et c’est un terme qui revient souvent quand on parle de la civilisation. C’est toujours ce même conditionnement qui nous fait concevoir qu’il y a une civilisation, comme s’il n’y en avait pas eu des centaines et comme s’il ne va pas y en avoir des centaines d’autres. Donc, déjà, un premier point que je voudrais remettre en place dans ma vision tout au moins : c’est qu’il s’agit d’une certaine civilisation, qu’on peut fort bien récuser d’ailleurs et dont on peut fort bien prévoir qu’elle va disparaître comme bien d’autres civilisations ont disparu. Lorsqu’il y a près de deux ans, j’envisageai la disparition de la civilisation, j’étais encore trop prisonnier de ses conditionnements : j’identifiais la civilisation, la seule que je connaissais, avec l’humanité. La destruction de cette civilisation m’apparaissait effectivement sous une image apocalyptique de fin de l’espèce humaine. Or, voici une demi-heure ou une heure, j’ai expliqué que cette vision a entièrement changé maintenant. L’écroulement de cette civilisation n’est pas une vision apocalyptique ; c’est, disons, quelque chose qui me semble hautement souhaitable. Je considère même que c’est notre grande chance qu’il existe, disons, une base biologique de la société humaine qui se refuse à suivre la voie de la civilisation industrielle dominante. Finalement, c’est la crise écologique qui va nous forcer, que nous le voulions ou non, à modifier notre cours et à développer des modes de vie et des modes de production qui soient radicalement différents de ceux en cours dans la civilisation industrielle.
D’autre part, vous parlez du rôle des sciences humaines en disant qu’il n’y a pas que les sciences dites exactes, les sciences physiques, et je le sais bien. Vous savez aussi comme moi d’ailleurs, et ça c’est une critique très sérieuse qu’on peut faire aux sciences humaines, qu’elles essaient de plus en plus de se mouler sur le modèle des sciences dites exactes, les sciences mathématiques en particulier. De telle façon que, dans la mesure où les sciences humaines veulent accéder au véritable statut scientifique — puisque seule la science d’après des normes universellement admises est considérée comme sérieuse —, on enferme ces sciences humaines de plus en plus dans un jargon souvent mathématique. On connaît l’influence des tests numériques, des méthodes quantitatives, dans la psychologie par exemple. On pourrait souligner aussi que pas mal de traités d’économie, des gros traités, commencent, pour les deux tiers du livre, par l’exposé de pesants formalismes mathématiques qui ont comme seul but de les rendre incompréhensibles au commun des mortels. Un professeur d’économie de Bordeaux a dit textuellement à un de mes amis que le but de ce formalisme mathématique dans un livre de sa composition était de cacher le fait que le contenu scientifique véritable pouvait être compris par n’importe quelle personne ayant le niveau d’instruction du Certificat d’études. Ainsi, on peut faire un reproche très sérieux aux sciences humaines dans cette direction.
D’autre part les sciences humaines sont l’objet de détournements et à ce titre elles sont soumises aux mêmes critiques que les autres sciences. Par exemple, dans l’avant dernier numéro de Survivre, on donne pas mal de détails sur l’utilisation de l’anthropologie dans la guerre du Sud-Ouest Asiatique. En fait, la science anthropologique américaine est en grande partie au service des militaires : pour arriver à quadriller les populations indigènes en Asie du Sud-Ouest, pour étudier par ordinateur l’impact que pourrait avoir telle politique ou telle autre, comme de brûler les récoltes par exemple, afin de savoir si les retombées seront plus bénéfiques vis à vis de l’implantation américaine ou si, au contraire, le ressentiment pourrait l’emporter. Il y a donc des études comme celles-ci qui sont faites sur le terrain par des anthropologistes.
Finalement, je crois qu’il n’y a pas tellement de différences à faire du point de vue du rôle pratique et idéologique entre les sciences humaines et les sciences dites exactes, les sciences naturelles disons.
Question :
— Je voudrais vous demander quels sont les buts du mouvement Survivre et quels sont les contacts que vous avez avec les mouvements existants dans la région comme le Comité Bugey-Cobaye.
Réponse :
— Les buts du mouvement Survivre ? Au début notre vision était apocalyptique et nous avions pris pour but de lutter pour la survie de l’espèce humaine menacée par les dangers des conflits militaires et par la crise écologique provenant de la pollution et de l’épuisement des ressources naturelles. Mais au cours d’un an et demi d’existence, nous avons pas mal évolué et je pense que l’on pourrait formuler ainsi la façon dont la plupart d’entre nous voient notre but : aider à préparer le passage d’un type de civilisation à un autre par des transformations qui puissent s’effectuer dans l’immédiat. Jusqu’à maintenant, notre travail a été surtout un travail critique. Néanmoins, cela fait longtemps, plus de six mois, que nous voyons assez clairement qu’il faut arriver à dépasser le travail critique pour arriver à faire quelque chose dans une direction constructive. Par exemple, disséminer de l’information sur le mouvement communautaire, sur le développement des techniques de technologie légère, de biotechnologie, dans le sens des Nouveaux Alchimistes ; disséminer de l’information sur les expériences d’écoles nouvelles du type Summerhill et des choses dans ce genre là. Mais, entre l’intention de le faire et, disons, la préparation du point de vue de l’expérience, du point de vue du contact, etc. il y a encore un pas. Je pense que cette transformation, dans le contenu du journal et notre action, se fera progressivement, au cours de l’année ou des années qui viennent. J’espère que d’ici une année par exemple, au moins une moitié des publications que nous sortirons, que ce soit journal ou autre chose, vont être dans cette direction constructive au lieu d’être purement critiques.
En ce qui concerne nos relations avec le Comité Bugey-Cobaye, eh bien nous sommes en bonnes relations avec eux ! Cinq membres de Survivre ont participé à la grande fête-manifestation de Bugey-Cobaye du mois de juin dernier. Nous sommes en relations assez suivies avec eux. On a même eu quelqu’un à la permanence devant la centrale nucléaire de Bugey pendant un mois ou deux en automne dernier. C’était un adhérent de l’Hérault, un rédacteur du Courpatier, un petit journal écologique régional de la Provence.
Du point de vue pratique, une des choses utiles que nous pouvons faire, disons, comme action spécifique, en particulier parce que nous sommes beaucoup de scientifiques à l’intérieur de Survivre et que nous sommes donc mieux placés que beaucoup d’autres, c’est de contribuer à dénoncer un certain nombre de mythes de la science et nous allons commencer vigoureusement dans ce sens à partir du n°9 de Survivre. Son éditorial est consacré à une description critique de l’idéologie scientiste, avec pour titre « La Nouvelle église Universelle ».
D’autre part, nous pensons qu’un phénomène très important est en train de se passer. A savoir le nombre de plus en plus grand de personnes isolées dans leur coin ou dans leur milieu familial ou professionnel qui commencent à être conscientes de l’existence d’une véritable crise de civilisation. Elles se sentent donc isolées et de ce fait paralysées, et nous voulons contribuer à créer un réseau des connaissances entre ces gens là. En fait, ce réseau est en train de se constituer par l’intermédiaire de toutes sortes de facteurs ; je crois que, par exemple, les articles de Fournier dans Charlie-Hebdo y contribuent et je pense que l’existence de notre groupe y contribue également. D’ailleurs, ce phénomène de création d’un réseau de liens entre des entités d’abord isolées ne concerne pas seulement les personnes mais aussi les groupes. Par exemple, pendant un bon moment, le groupe Survivre croyait être le seul de son espèce à faire une analyse critique de la science. Or nous nous sommes aperçus depuis que, un peu partout, il y a des groupes analogues qui sont en train de surgir. Nous connaissons particulièrement bien le groupe Lacitoc et un autre groupe aux États-Unis Science for the People. Il y a d’autres groupes qui se sont créés plus ou moins simultanément avec nous et sous le même nom Survival aux états-Unis. Ces groupes, qui sont partis chacun d’un aspect spécifique de la crise de civilisation, élargissent peu à peu leur point de départ avec toutes sortes d’autres groupes qui parfois sont partis de points très différents. J’ai l’impression que ce processus extrêmement rapide va probablement être achevé dans l’année qui vient. C’est-à-dire qu’à partir de ce moment-là, n’importe qui dans la société occidentale, tout au moins celui qui commence à sentir assez clairement que quelque chose ne va pas du point de vue de la civilisation, qui commence à être étreint par un sentiment d’incohérence dans sa propre vie — mais une incohérence qui ait une signification globale —, d’emblée il lui sera impossible d’être isolé, il trouvera immédiatement à se placer dans ce réseau. C’est un processus auquel un groupe comme le nôtre peut très bien contribuer. Ce sont des choses assez modestes, disons, chacun le fait dans sa propre sphère d’activités, mais comme il y a beaucoup de personnes et de groupes qui le font, l’effet global n’est absolument pas négligeable.
Retranscription de la conférence-débat donnée à l’amphithéâtre du CERN le 27 janvier 1972.
(Transcrit de l’enregistrement magnétique par Jacqueline Picard)
La nouvelle église universelle
Science et scientisme
La méthode expérimentale et déductive, depuis quatre cents ans de succès spectaculaires, augmente sans cesse son impact sur la vie sociale et quotidienne, et par suite, jusqu’à une date récente, son prestige.
En même temps, à travers un processus « d’annexion impérialiste » qui devrait être analysé de façon plus serrée, la science a créé son idéologie propre, ayant plusieurs des caractéristiques d’une nouvelle religion, que nous pouvons appeler le scientisme. Ce pouvoir, principalement pour le grand public, tient au prestige de la science, lui-même dû à ses succès. Le scientisme est maintenant fermement enraciné dans tous les pays du monde, qu’ils soient capitalistes ou dits socialistes, développés ou en voie de développement (à d’importantes restrictions près pour la Chine (1)). Il a de loin, supplanté toutes les religions traditionnelles. Il s’est insinué dans l’éducation à tous des niveaux, de l’école élémentaire à l’université, tout comme dans la vie professionnelle post-scolaire. Avec des nuances et une intensité variables, il prédomine dans toutes les classes de la société ; il est plus fort dans les pays les plus développés et parmi les professions intellectuelles ; il est le plus fort dans les domaines les plus ésotériques (2).
Les gens en général, bien qu’on leur enseigne certains des plus grossiers et des plus anciens résultats de la science, ont toujours eu peu ou pas de compréhension de ce qu’est réellement la science en tant que méthode. Cette ignorance a été perpétuée par tout l’enseignement primaire, secondaire, et même par l’importante partie de l’enseignement universitaire qui ne constitue pas une préparation à la recherche : la science y est enseignée dogmatiquement, comme une vérité révélée. Aussi, le pouvoir du mot « science » sur l’esprit du grand public est-il d’essence quasi-mystique et certainement irrationnelle. La science est, pour le grand public et même pour beaucoup de scientifiques, comme une magie noire, et son autorité est à la fois indiscutable et incompréhensible. Ceci rend compte de certaines des caractéristiques du scientisme comme religion. En tant que telle, il est tout aussi irrationnel et émotionnel dans ses motivations, et intolérant dans sa pratique journalière, que n’importe laquelle des religions traditionnelles qu’il a supplantées (3). Bien plus, il ne se borne pas à prétendre que seul ses propres mythes soient vrais ; il est la seule religion qui ait poussé l’arrogance jusqu’à prétendre n’être basée sur aucun mythe quel qu’il soit, mais sur la Raison seule, et jusqu’à présenter comme « tolérance » ce mélange particulier d’intolérance et d’amoralité qu’il produit.
Aux yeux du grand public, les prêtres et les grands prêtres de cette religion sont les scientifiques, au sens large, plus généralement les technologues les technocrates, les experts. Même la langue de cette religion sera pour toujours incompréhensible au peuple, d’autant que ce n’est pas même une seule langue, mais des milliers de langues différentes, chacune n’étant que le jargon technique particulier d’une spécialité donnée.
L’immense majorité des scientifiques est tout à fait prête à accepter ce rôle de prêtres et de grands prêtres de la religion dominante d’aujourd’hui. Plus que n’importe qui, ils en sont imbus, et cela d’autant plus qu’ils sont plus haut situés dans la hiérarchie scientifique. Ils réagiront à toute attaque contre cette religion, ou l’un de ses dogmes, ou l’un de ses sous-produits, avec toute la violence émotionnelle d’une élite régnante aux privilèges menacés (4). Ils font partie intégrante des pouvoirs en place quels qu’ils soient, auxquels ils s’identifient intimement et qui tous s’appuient fortement sur leurs compétences technologiques et technocratiques.
Il n’existe pas de dogme écrit explicite du scientisme auquel nous puissions nous référer (5). Cependant, bien qu’il ne soit formulé explicitement, un tel dogme existe implicitement et il est tout à fait précis, tout particulièrement parmi les scientifiques. Nous allons faire un essai de formulation de ce qu’on peut appeler le credo du scientisme, compris comme une collection de mythes principaux. Nous ne voulons pas dire que tous les scientifiques, même ceux à penchant franchement scientiste, seront en accord sans réserve avec la substance de chacun ni même d’aucun d’eux. Pour plus de clarté, les mythes ont été délibérément formulés sous leur forme la plus extrême, que beaucoup de scientifiques hésiteraient à cautionner, même s’ils agissent comme s’ils y adhéraient sans réserve. Cependant, nous soutenons que ce credo, dans son ensemble, exprime effectivement certaines tendances principales, ou tout au moins leurs états limites, réalisés sous une forme plus ou moins forte et plus ou moins pure chez presque tous les scientifiques.
Le crédo du scientisme
Mythe 1
Seule la connaissance scientifique est une connaissance véritable et réelle, c’est-à-dire, seul ce qui peut être exprimé quantitativement ou être formalisé, ou être répété à volonté sous des conditions de laboratoire, peut être le contenu d’une connaissance véritable. La connaissance « véritable » ou « réelle », parfois aussi appelée connaissance « objective », peut être définie comme une connaissance universelle, valable en tout temps, tout lieu, et pour tous, au-delà des sociétés et des formes de cultures particulières.
Commentaires :
Les sensations et expériences comme l’amour, l’émotion, la beauté, l’accomplissement, ou même l’expérience primaire du plaisir et de la douleur sont rayés du royaume de la connaissance valable, pour mitant du moins qu’elles ne sont pas englobées dans une théorie scientifique. Ni Jésus ni Sapho ne savaient rien de l’amour ! Ceci restreint la « connaissance véritable » aux quelques millions de scientifiques de la planète. Les bébés et les enfants n’ont aucune connaissance digne de ce nom, pas plus que quiconque est sans formation scientifique. La connaissance véritable commence avec les derniers semestres de l’éducation universitaire. Une autre conséquence de ce mythe est que, la morale étant objet de connaissance, elle doit être approchée avec la méthodologie scientifique ; ceci conduit à ce que la science devienne le fondement de la morale. Ce qui suit constitue une réciproque du mythe 1.
Mythe 2
Tout ce qui peut être exprimé de façon cohérente en termes quantitatifs, ou peut être répété sous des conditions de laboratoire, est objet de connaissance scientifique et, par là même, valable et acceptable. En d’autres termes, la vérité (avec son contenu de valeur traditionnel) est identique à la connaissance, c’est-à-dire identique à la connaissance scientifique.
Commentaires :
La guerre et nombre de ses aspects peuvent être insérés dans des théories scientifiques diverses : économie, stratégie (en tant que chapitre de la théorie des probabilités ou de l’optimisation), psychiatrie, médecine, sociologie… Une nouvelle science, la polémologie ou science de la guerre, a même été créée par des pacifistes bien intentionnés. Donc la guerre est acceptable, étant un objet d’investigations scientifiques. D’autant plus qu’on lui assigne une importante fonction régulatrice pour les processus démographiques et économiques, et stimulatrice pour la science et la technologie. Ce qu’une telle guerre peut signifier, pour ceux qui la supportent ou ceux qui la font, est hors de propos car subjectif – sauf comme objet d’enquêtes “scientifiques”, à buts souvent manipulatoires, ayant comme but de réduire le vécu à des statistiques.
Mythe 3
Conception « mécaniste », ou « formaliste », ou « analytique » de la nature : le rêve de la science. Atomes et molécules et leurs combinaisons peuvent être entièrement décrits selon les lois mathématiques de la physique des particules élémentaires ; la vie de la cellule en termes de molécules ; les organismes pluricellulaires en termes de populations cellulaires ; la pensée de l’esprit (comprenant toutes les sortes d’expérience psychique) en termes de circuits de neurones, les sociétés animales et humaines, les cultures humaines, en termes des individus qui les composent. En dernière analyse, toute la réalité, comprenant l’expérience et les relations humaines, les événements et les forces sociales et politiques, est exprimable en langage mathématique en termes de systèmes de particules élémentaires, et sera effectivement exprimée ainsi dès que la science sera assez avancée. A la limite, le monde n’est qu’une structure particulière au sein des mathématiques.
Commentaires :
Dans une telle conception du monde, la notion de but, bien sûr, ne peut exister. N’importe quelle allusion à une explication finaliste des phénomènes naturels est écartée avec mépris, tout au moins dans les sciences naturelles. Le fait que les principales lois physiques soient exprimées aujourd’hui sous forme statistique permet à la conception mécaniste de dépasser la vision strictement déterministe de la nature, et de réincorporer en principe la notion de libre arbitre (6).
Mythe 4
Le rôle de l’expert : la connaissance, tant par son développement que pour sa transmission par l’enseignement, doit être coupée en de nombreuses tranches ou spécialités : d’abord en larges champs tels que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie la sociologie, la psychologie, etc. qui sont encore subdivisés ad libitum, à mesure que la science avance. Pour n’importe quelle question appartenant à un domaine donné, seule l’opinion des experts de ce domaine particulier est pertinente ; si plusieurs domaines sont concernés, seule l’opinion collective des experts de tous ces domaines l’est.
Commentaires :
Exceptionnellement, une personne peut être un expert dans plus d’un domaine, mais personne ne peut, l’être dans de nombreux domaines. N’importe quelle question touchant à la réalité concrète, pour être réellement comprise, implique une analyse de nombreux aspects, intimement imbriqués, appartenant à de nombreux champs différents de la science. En la réduisant à un seul de ces aspects, ou à un petit nombre, ou en les maintenant séparés, on mutile grossièrement la réalité (7). Par conséquent, dans une situation complexe, une personne seule ne peut être tenue comme compétente pour la comprendre, ni tenue pour responsable de sa compréhension ou de son manque de compréhension. Le mythe 4 pose les fondements du pouvoir de l’expert, issu de son incompréhensibilité pour tous ceux situés hors de son champ d’expertise. Il fournit aussi le fondement de la conséquence suivante (rarement formulée) : nul ne peut prétendre à lui seul à une connaissance valable d’aucune partie complexe de la réalité. Pour compenser cela, le pouvoir collectif de la technocratie est établi dans le mythe suivant, d’apparence anodine, du credo scientiste
Mythe 5
La science et la technologie issue de la science peuvent résoudre les problèmes de l’homme, et elles seules. Ceci s’applique également aux problèmes humains, notamment aux problèmes psychologiques, moraux, sociaux, et politiques.
Commentaires : Ceci conduit logiquement au…
Mythe 6
Seuls les experts sont qualifiés pour prendre part aux décisions, car seuls les experts savent.
Commentaires :
Dans la sphère des décisions sociales et politiques, la réalité est bien trop complexe pour qu’un expert unique soit réellement compétent. Cette difficulté est résolue en pratique par l’introduction d’une autre sorte d’expert : « l’expert ès décisions », qui peut être un fonctionnaire, un directeur de société ou un militaire haut gradé. Son rôle est d’écouter derrière des portes closes les avis des experts dans les différentes spécialités impliquées dans les décisions à prendre, et de prendre la décision.
Combattre le scientisme
En eux-mêmes, au niveau purement intellectuel ces mythes principaux du scientisme exercent un certain attrait puissant, qui explique en partie leur extraordinaire succès. Ils introduisent des simplifications énormes dans la complexité fluctuante des phénomènes naturels et de l’expérience humaine. Ainsi qui, parmi les scientifiques, quand enfant il apprenait la loi de Newton de l’attraction universelle n’a pas été confondu par l’excitant défi de rendre vraie l’intuition hardie de Pythagore : « tout est nombre », et de construire une description entièrement mécaniste du monde (8).
D’ailleurs, comme tous les mythes, ceux du scientisme contiennent quelques solides éléments de vérité ; le fait qu’ils prétendent fondés sur la seule Raison leur a donné un pouvoir supplémentaire. Il est advenu, en effet, pendant les siècles précédents, que s’est affirmée avec une intransigeance croissante la suprématie de la raison ou de l’intellect sur tous les autres aspects de l’expérience et des capacités humaines, y compris les aspects sensuel, émotionnel et éthique. Et, pis encore, un seul outil particulier de l’intellect de l’homme, à savoir la méthode scientifique expérimentale et déductive, qui ne s’est développée qu’au cours des derniers siècles, excité par ses grands succès dans certains domaines limités, de l’investigation et des réalisations de l’homme, a été amené à assumer un rôle impérialiste croissant, et finalement à s’identifier à la Raison elle-même, rejetant tons ce qu’il ne pouvait assumer, comme étant « irrationnel », « émotionnel », « instinctif », « non humain », etc. (9).
Nous tenons tous ces mythes principaux du scientisme pour des erreurs. Sur l’expert, qui se sent parmi les principaux bénéficiaires de ces mythes destinés à affermir son pouvoir collectif, ils ont un effet estropiant, à la fois spirituellement et intellectuellement, l’éloignant toujours plus du concert des êtres vivants, pour l’apparenter à un simple mécanisme cérébral cybernétisé toujours plus spécialisé. Sur les experts comme sur les profanes, ils ont un effet paralysant – paralysant, en ce qui concerne le désir naturel d’en savoir plus sur la nature, la vie et nous-mêmes, qu’un seul jargon particulier ne peut exprimer ; et en conséquence, paralysant en termes d’engagement moral et de responsabilité personnelle dans tous les domaines impliquant la société comme un tout, car il contribue à creuser le fossé s’élargissant sans cesse entre ces trois pôles de l’expérience humaine : la pensée, l’émotion et l’action. En termes socio-politiques, le scientisme justifie la hiérarchisation rigide existante de la société, et tend à l’accroître toujours plus, poussant au sommet une technocratie fortement hiérarchisée qui prend les décisions – y compris celles qui, maintenant, peuvent affecter de façon vitale la destinée de toute vie, sur terre pour des millions d’années à venir.
Dans la plupart sinon tous les pays du monde, sous différents déguisements, le scientisme s’est établi comme l’idéologie dominante. Comme tel, il fournit la justification principale et des rationalisations multiples à la course insensée au soi-disant “progrès”, vu exclusivement comme un progrès scientifique et technique (en accord avec le dogme du scientisme). Ceci, à son tour, est une des principales forces motrices pour la religion de la production et de la croissance pour eux-mêmes. Cette course et cette croissance insensées nous ont conduits à la crise écologique actuelle, dont nous n’assistons qu’aux premiers stades, et à une crise majeure dans notre civilisation. Le scientisme, qui a été une force décisive pour engendrer ces deux crises, est totalement incapable de les surmonter. Il est même incapable de reconnaître l’existence d’une crise de civilisation, car ceci reviendrait à mettre en question l’idéologie scientiste elle-même.
Pour toutes ces raisons, nous tenons que l’idéologie la plus dangereuse et la plus puissante aujourd’hui est le scientisme, bien qu’elle n’ait généralement pas été reconnue comme une puissante idéologie par elle même. Elle peut être considérée comme un solide fond commun à l’idéologie capitaliste et à l’idéologie communiste sous la forme en vigueur dans la plupart des pays dits socialistes. Nous pensons que de plus en plus la principale ligne de partage politique se trouvera moins dans la distinction traditionnelle entre la « gauche » et la « droite » que dans l’opposition entre les scientistes, tenants du « progrès technologique à tout prix » et leurs adversaires, c’est-à-dire, grosso-modo, ceux pour lesquels l’épanouissement de la Vie, dans toute sa richesse et sa variété, et non le progrès technique, est une priorité absolue.
L’ascension vertigineuse du pouvoir de l’idéologie scientiste sur l’esprit du grand public, se poursuivant depuis plusieurs siècles, semble avoir atteint son apogée. Il y a deux ans environ, avec le premier vol spatial habité américain vers la Lune, quand elle culminait en ce qu’on pourrait appeler une hystérie collective à l’échelle mondiale. Depuis lors, on perçoit des signes clairs d’un « coup en retour », exprimant la désillusion et le scepticisme croissants concernant les « miracles » de la science et de la technologie, leur prétention d’être la clé du bonheur humain, et de savoir résoudre les problèmes qu’ils ont eux-mêmes créés. Ce coup en retour était certainement préparé par la montée mondiale d’une contre-culture marginale, qui pourrait être interprétée elle-même comme étant largement une réaction à l’idéologie scientiste (10).
Ce coup en retour est également manifeste dans la façon considérablement plus réservée avec laquelle les mass-media réagissent maintenant à de nouvelles prouesses scientifiques et technologiques, allant parfois jusqu’à la critique ouverte (11). Une opposition plus dure, souvent voilée encore sous des formes déférentes pour la Science et les Savants, provient d’un nombre croissant de groupes de défense de l’environnement qui surgissent de toutes parts, se radicalisant à mesure que leurs militants se familiarisent avec les problèmes affrontés et avec l’inertie, voire la complicité, de la « communauté scientifique » avec les puissances qui nous menacent. Tous ces signes nous semblent présager le commencement du déclin du scientisme.
Le temps est mûr maintenant de hâter ce déclin dans un combat déclaré.
Un combat de l’intérieur
Une des voies les plus efficaces pour combattre le scientisme semblerait un combat de l’intérieur, par les scientifiques devenus conscients de ses erreurs et de ses dangers. Ce combat a déjà commencé depuis quelques années, et des horizons les plus variés. Cette opposition (quoique mitigée souvent) vient en partie de certains scientifique gauchisants.
Une remise en question plus radicale vient du mouvement hippie, qui a quelques membres et sympathisants dans la « communauté scientifique ». Ce sont généralement de jeunes scientifiques, au statut académique relativement modeste. Seulement plus récemment, semble-t-il, des scientifiques établis ont rejoints la bataille.
Durant les quelques dernières années se sont créés des groupes scientifiques qui se sont engagés dans une critique plus ou moins radicale du scientisme. Il y a maintenant certainement plus d’une centaine de tels groupes répartis dans divers pays, et de nouveaux groupes surgissent constamment. Survivre est justement un de ces groupes ; parmi les autres avec lesquels nous sommes en contact, citons Science for the People (principalement nord américain), Lasitoc (membres de pays divers, comprenant Angleterre et Suède), B.S.S.R.S. (British Society for Social Responsability in Science), etc.
Pour beaucoup la motivation de cette révolte « de l’intérieur » contre le scientisme semble être une répulsion intellectuelle ou morale en face de ses limitations internes ou de ses implications externes.
Quoiqu’il en soit, un nombre considérablement plus grand d’opposants va vraisemblablement surgir dans les années à venir, dans le monde occidental au moins en raison du nombre considérable de scientifiques entrainés et de techniciens qui vont être en chômage, ou employés dans une profession pour laquelle ils n’ont pas été formés, ou avec un statut et un salaire considérablement inférieur à ceux auxquels ils pensent avoir droit en raison de leur compétence scientifique. Ici, nous voyons apparaître ce que les marxistes appelleraient sans doute une « contradiction interne de classe » dans la caste scientifique, donnant naissance à ce que l’on pourrait appeler un « prolétariat scientifique ». N’ayant plus d’intérêts de classe puissants comme enjeu, ces prolétaires seront très probablement un facteur supplémentaire de désintégration de l’idéologie scientiste.
La rédaction de Survivre
Notes :
1. Toutes les indications semblent notamment concorder pour établir que le mythe de l’expert est systématiquement battu en brèche en Chine.
2. Ésotérique : inaccessible au profane.
3. Parmi les innombrables exemples de cette intolérance signalons l’excommunication par la médecine officielle de toutes les techniques et théories médicales marginales (y compris, en son temps, celles de Pasteur lui-même !). Pour une attitude typique d’intolérance idéologique se réclamant sans vergogne de la “tolérance”, voir l’article de Rabinovitch cité dans la note suivante.
4. Cf. l’article d’Eugène Rabinovitch, « The mounting tide of unreason » (La vague montante de la déraison) paru dans le Bulletin of the Atomic Scientist, mai 1971.
5. Le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, éd. du Seuil, 1970, s’il n’est pas un dogme complet du scientisme, en est cependant une illustration particulièrement frappante.
6. C’est le « hasard » de Jacques Monod.
7. On se souviendra à ce propos de l’enquête parue dans France-Soir en 1962 sur l’image que se font les Français de la femme idéale. Les personnes interrogées avaient eu à choisir un front, un menton, un œil, une chevelure, une forme de visage parmi un grand nombre. Les journalistes avaient alors reconstitué la beauté de rêve de la majorité des Français… qui s’est révélée être un laideron glaçant. La beauté n’avait pu être approchée par une méthode analytique.
8. Signalons ici que Newton lui-même était trop subtil pour croire à la validité d’une telle description.
9. Voir encore l’inépuisable article de Rabinovitch cité en note 4.
10. Cette réaction conduit souvent à mettre l’accent sur l’aspect mystique, magique ou religieux de l’expérience humaine de la nature. Ainsi paradoxalement la science, qui était censée extirper ces aspects, par les excès même de l’idéologie scientiste, a au contraire contribué a au contraire contribué à leur renouveau.
11. l’exemple de l’abandon de l’avion supersonique américain est à cet égard symptomatique.
Qui était Alexandre Grothendieck ?
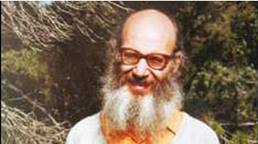

Messages
1. Le mathématicien Grothendieck est mort, 14 novembre 2014, 22:43
« J’ai dégagé la notion de “motif” associé à une variété algébrique. Par ce terme, j’entends suggérer qu’il s’agit du “motif commun” (ou de la “raison commune”) sous-jacent à cette multitude d’invariants cohomologiques différents associés à la variété, à l’aide de la multitude des toutes les théories cohomologiques possibles à priori. Ces différentes théories cohomologiques seraient comme autant de développements thématiques différents, chacun dans le “tempo”, dans la “clef” et dans le “mode” (“majeur” ou “mineur”) qui lui est propre, d’un même “motif de base” (appelé “théorie cohomologique motivique”), lequel serait en même temps la plus fondamentale, ou la plus “fine”, de toutes ces “incarnations” thématiques différentes (c’est-à-dire, de toutes ces théories cohomologiques possibles). Ainsi, le motif associé à une variété algébrique constituerait l’invariant cohomologique “ultime”, “par excellence”, dont tous les autres (associés aux différentes théories cohomologiques possibles) se déduiraient, comme autant d’“incarnations” musicales, ou de “réalisations” différentes. Toutes les propriétés essentielles de “la cohomologie” de la variété se “liraient” (ou s’“entendraient”) déjà sur le motif correspondant, de sorte que les propriétés et structures familières sur les invariants cohomologiques particularisés (ℓ-adique ou cristallins, par exemple), seraient simplement le fidèle reflet des propriétés et structures internes au motif. C’est là, exprimé dans le langage non technique d’une métaphore musicale, la quintessence d’une idée d’une simplicité enfantine encore, délicate et audacieuse à la fois. »
Alexandre Grothendieck
2. Le mathématicien Grothendieck est mort, 16 novembre 2014, 09:06
Un homme coupé du monde des hommes ?
Non ! Un homme engagé !
Fin 1977 Alexandre Grothendieck passe au Tribunal Correctionnel de Montpellier pour le délit d’avoir « gratuitement hébergé et nourri un étranger en situation irrégulière ».
3. Le mathématicien Grothendieck est mort, 16 novembre 2014, 09:13
En vue d’une action sur le plan national, j’avais écrit à cinq « personnalités » du monde scientifique, particulièrement connues (dont un mathématicien), pour les mettre au courant de cette loi, qui aujourd’hui encore me paraît toujours aussi incroyable qu’au jour où je fus cité. Dans ma lettre je proposais une action commune pour manifester notre opposition à une loi scélérate, qui équivalait à mettre hors la loi des centaines de milliers d’étrangers résidant en France, et de désigner à la méfiance de la population, tels des lépreux, des millions d’autres étrangers, qui du coup devenaient des suspects, susceptibles d’attirer les pires ennuis aux français qui ne se tiendraient pas sur leurs gardes.
Chose étonnante, complètement inattendue pour moi, je n’ai reçu de réponse de la part d’aucune de ces cinq « personnalités ». Décidément, j’avais des choses à apprendre …
C’est alors que je me suis décidé d’aller à Paris, à l’occasion du Séminaire Bourbaki où je ne manquerais pas de rencontrer de nombreux anciens amis, pour mobiliser tout d’abord l’opinion dans le milieu mathématique, qui m’était le plus familier. Ce milieu, il me semblait, serait particulièrement sensible à la cause des étrangers, alors que tous mes collègues mathématiciens, tout comme moi-même, ont à côtoyer quotidiennement des collègues, des élèves et des étudiants étrangers, dont la plupart sinon tous ont eu des moments de difficulté avec leurs papiers de séjour, et ont eu à affronter l’arbitraire et souvent le mépris dans les couloirs et les bureaux des préfectures de police. Laurent Schwartz, que j’avais mis au courant de mon projet, m’avait dit qu’on me laisserait la parole, à la fin des exposés du premier jour du Séminaire, pour soumettre la situation aux collègues présents.
C’est ainsi que j’ai débarqué ce jour-là, un volumineux paquet de tracts dans ma valisette, à l’intention de mes collègues. Alain Lascoux m’a secondé pour les distribuer dans le couloir de l’Institut Henri Poincarê, avant la première séance et à « l’entr’acte » entre les deux exposés. Si je me rappelle bien, il avait même fait un petit tract de son côté – il fait partie des quelques deux ou trois collègues qui, ayant eu écho de l’affaire, s’étaient émus et m’avaient contacté dès avant mon voyage à Paris, pour me proposer leur aide. Roger Godement fait partie aussi du nombre, il a même fait un tract qui titrait « Un Prix Nobel en Prison ? ». C’était chic à lui, mais décidément on n’était pas branchés sur la même longueur d’onde : comme si le scandale était de s’en prendre à un « Prix Nobel », plutôt qu’au premier lampiste venu !
Il y avait foule en effet en ce premier jour de Séminaire Bourbaki, et énormément de gens que j’avais connus de plus ou moins près, y compris les amis et compagnons d’antan de Bourbaki ; je crois que la plupart devaient bien y être. Plusieurs de mes anciens élèves aussi. Ça devait bien faire dix ans bientôt que je n’avais pas vus tous ces gens, et j’étais content en venant de cette occasion de les revoir, même que ça en fasse beaucoup à la fois ! Mais on finirait bien par se retrouver en plus petit nombre …
Les retrouvailles pourtant « n’étaient pas ça », c’était assez clair dès le début. De nombreuses mains tendues et serrées, c’est sûr, et de nombreuses questions « tiens, toi ici, quel vent t’amène ? », oui – mais il y avait comme un air de gêne indéfinissable derrière les tons enjoués. Etait-ce parce que la cause qui m’amenait ne les intéressait pas au fond, alors qu’ils étaient venus pour une certaine cérémonie mathématique tri-annuelle, qui demandait toute leur attention ? Ou indépendamment de ce qui m’amenait, est-ce ma personne elle-même qui inspirait cette gêne-là, un peu comme la gêne qu’inspirerait un curé défroqué parmi des séminaristes bon teint ? Je ne saurais le dire – peut-être y avait-il des deux. De mon côté, je ne pouvais m’empêcher de constater la transformation qui s’était opérée dans certains visages qui avaient été familiers, voire amis. Ils s’étaient figés, aurait-on dit, ou affaissés. Une mobilité que j’y avais connue semblait disparue, comme si elle n’avait jamais été. Je me trouvais comme devant des étrangers, comme si rien jamais ne m’avait lié à eux.
Obscurément, je sentais que nous ne vivions pas dans le même monde. J’avais crû retrouver des frères en cette occasion exceptionnelle qui m’amenait, et je me trouvais devant des étrangers. Bien élevés, il faut le reconnaître, je ne me rappelle pas de commentaire aigre-doux, ni de tracts qui auraient traîné par terre. En fait, tous les tracts distribués (ou presque) ont dû être lus, la curiosité aidant.
Ce n’est pas pour autant que la loi scélérate s’est vue mise en péril ! J’ai eu mes cinq minutes, peut-être en ai-je pris même dix, pour parler de la situation de ceux qui pour moi étaient des frères, appelés « étrangers ».
Il y avait là un amphithéâtre bondé de collègues, plus silencieux que si j’avais fait un exposé mathématique. Peut-être la conviction pour leur parler déjà n’y était plus. Il n’y avait plus, comme jadis, courant de sympathie et d’intérêt. Il doit y avoir des gens pressés dans le nombre, j’ai dû me dire, j’ai écourté, proposant de nous retrouver sur le champ, avec les collègues qui se sentaient concernés, pour se concerter de façon plus circonstanciée sur ce qui pourrait être fait …
Quand la séance a été déclarée levée, ça a été une ruée générale vers les sorties – visiblement, tout le monde avait un train ou un métro sur le point de partir, qu’il ne fallait louper à aucun prix !
4. Le mathématicien Grothendieck est mort, 16 novembre 2014, 14:04, par Robert Paris
Lire ici son autobiographique "Récoltes et semailles" : cliquer ici
5. Le mathématicien Grothendieck est mort, 29 novembre 2014, 15:06, par max
Je crois qu’il y a déjà un malentendu de base. Je n’ai pas dit qu’il faut que qui que ce soit, de particulier, ou quelqu’un d’autre, moi par exemple, transforme la société industrielle, comme ça, dans les dix, vingt ou trente années qui viennent dans une autre forme de société prédéterminée. Si une fée m’investissait de pouvoirs discrétionnaires, je lui dirais que je n’en ai pas envie. Effectivement, je suis bien persuadé que ce que je pourrais faire, ce ne serait guère autre chose que de mettre encore plus de mess, de bordel, que celui qui y est déjà.
A.Grothendieck
6. Le mathématicien Grothendieck est mort, 29 novembre 2014, 15:12, par CAN84
Disparition d’Alexandre Grothendieck : un scientifique antinucléaire de la première heure
Grothendiec, scientifique antinucléaire a connu dans sa jeunesse plusieurs camps d’internement tandis que son père, anarchiste juif et russe, mourait à Auschwitz après avoir participé avec sa mère à la guerre d’Espagne au sein des Brigades internationales. Pacifiste et précurseur en France de l’engagement intellectuel et de terrain d’opposition au crime nucléaire civil et militaire, il demeura convaincu que seul la conscience dans l’action pouvait permettre de contrer l’hydre démoniaque de la prédation atomique. Saluons un homme, un scientifique de conviction qui a toujours refusé de mettre son savoir et ses compétences au service de la domination des peuples et de la barbarie.
La suite a lire ici sur le site de la coordination anti-nucléaire du sud est.
7. Le mathématicien Grothendieck est mort, 25 mai 2015, 11:54, par F. Kletz
La production scientifique, comme n’importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est considérée comme un impératif en soi.
Dans tout ceci, la chose remarquable est que, finalement, le contenu de la recherche passe entièrement au second plan.
Il s’agit de produire un certain nombre de “papiers”. Dans les cas extrêmes, on va jusqu’à mesurer la productivité des scientifiques au nombre de pages publiées.
Dans ces conditions, pour un grand nombre de scientifiques, certainement pour l’écrasante majorité, à l’exception véritablement de quelques uns qui ont la chance d’avoir, disons, un don exceptionnel ou d’être dans une position sociale et une disposition d’esprit qui leur permette de s’affranchir de ces sentiments de contrainte, pour la plupart la recherche scientifique est une véritable contrainte qui tue le plaisir que l’on peut avoir à l’effectuer.
8. Le mathématicien Grothendieck est mort, 25 mai 2015, 12:00, par F. Kletz
« concernant le plaisir que nous prenons à faire de la recherche scientifique. Je crois qu’il peut y avoir plaisir, mais je suis arrivé à la conclusion que le plaisir des uns, le plaisir des gens haut placés, le plaisir des brillants, se fait aux dépends d’une répression véritable vis-à-vis du scientifique moyen. »