Accueil > 02 - Livre Deux : SCIENCES > Formation et filiation de l’homme > Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?
Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?
jeudi 11 mai 2017, par
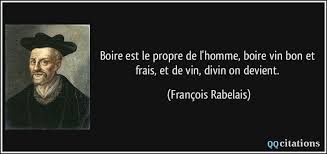
Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?
On l’a bien cherché, « le propre de l’homme », et la vérité nécessite de dire qu’on ne l’a trouvé nulle part. Des auteurs qui avaient affirmé l’avoir trouvé ont été contredits par les recherches scientifiques ultérieures et aucun critère simple n’a pu être dégagé. Ni le rire, ni le langage, ni les outils, ni la station debout, ni l’organisation sociale, ni la capacité de chasser de manière organisée et planifiée, ni le gros cerveau, ni la capacité de calculer, ni la conscience, ni l’éducation des enfants, ni la raison, ni l’affectivité, ni l’intelligence, ni les émotions, ni la souffrance pour soi et pour les êtres aimés, ni le rêve, ni la capacité de faire des projets, ni les maîtrise des outils, ni la culture, ni le travail, ni le goût, ni … même les gènes ! Et même pas la violence, la capacité de destruction, les guerres...
Ce qui signifie que la question est philosophiquement mal posée. Différencier d’un côté l’homme en général et de l’autre l’animal en général n’a pas de sens matériel concret. Il est certain que l’humanité a eu une histoire mais tous les êtres qui y ont participé ne sont pas des étapes d’une évolution linéaire ni séparée de celles des autres espèces vivantes.
Le terme « animal », au singulier, est rejeté par le philosophe français Jacques Derrida dans sa généralité, – parce qu’il est une « simplification conceptuelle » vue comme un premier geste de « répression violente » à l’égard des animaux de la part des hommes, et qui consiste à faire une césure totale entre l’humanité et l’animalité, et un regroupement tout aussi injustifié entre des animaux qui demeurent des vivants radicalement différents les uns des autres, d’une espèce à une autre :
« Chaque fois que « on » dit « L’Animal », chaque fois que le philosophe, ou n’importe qui, dit au singulier et sans plus « L’Animal », en prétendant désigner ainsi tout vivant qui ne serait pas l’homme (...), eh bien, chaque fois, le sujet de cette phrase, ce « on », ce « je » dit une bêtise. Il avoue sans avouer, il déclare, comme un mal se déclare à travers un symptôme, il donne à diagnostiquer un « je dis une bêtise ». Et ce « je dis une bêtise » devrait confirmer non seulement l’animalité qu’il dénie mais sa participation engagée, continuée, organisée à une véritable guerre des espèces. »
« L’Animal que donc je suis », Jacques Derrida.
Ainsi, dans son dernier ouvrage, L’Animal que donc je suis, le philosophe français Jacques Derrida conçoit la question de l’« animal » comme une réponse à la question du « propre de l’« homme » », et a mis en doute la capacité à ce dernier d’être en droit de se faire valoir toujours aux dépens de l’« animal », alors qu’il semble bien que ce réflexe conceptuel soit, par essence, un préjugé, et non le fruit d’un raisonnement philosophique garant de ce droit :
« Il ne s’agit pas seulement de demander si on a le droit de refuser tel ou tel pouvoir à l’animal (parole, raison, expérience de la mort, deuil, culture, institution, technique, vêtement, mensonge, feinte de la feinte, effacement de la trace, don, rire, pleur, respect, etc. – la liste est nécessairement indéfinie, et la plus puissante tradition philosophique dans laquelle nous vivons a refusé tout cela à l’« animal »), il s’agit aussi de se demander si ce qui s’appelle l’homme a le droit d’attribuer en toute rigueur à l’homme, de s’attribuer, donc, ce qu’il refuse à l’animal, et s’il en a jamais le concept pur, rigoureux, indivisible, en tant que tel. »
« L’Animal que donc je suis », Jacques Derrida.
Ce que les singes nous apprennent sur la "nature humaine"....
La conscience est-elle le propre de l’homme ?
La science n’a pas trouvé le propre de l’homme
L’intelligence abstraite est-elle le propre de l’homme ?

Messages
1. Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?, 30 août 2017, 16:15
La condition première de toute histoire humaine est naturellement l’existence d’êtres humains vivants. Le premier acte historique de ces individus, par lequel ils se distinguent des animaux, n’est pas qu’ils pensent, mais qu’ils se mettent à produire leurs moyens d’existence. Le premier état de fait à constater est donc la complexion corporelle de ces individus et les rapports qu’elle leur crée avec le reste de la nature. Nous ne pouvons naturellement pas faire ici une étude approfondie de la constitution physique de l’homme elle-même, ni des conditions naturelles que les hommes ont trouvées toutes prêtes, conditions géologiques, orographiques, hydrographiques, climatiques et autres. Or cet état de choses ne conditionne pas seulement l’organisation qui émane de la nature ; l’organisation primitive des hommes, leurs différences de race notamment ; il conditionne également tout leur développement ou non développement ultérieur jusqu’à l’époque actuelle. Toute histoire doit partir de ces bases naturelles et de leur modification par l’action des hommes au cours de l’histoire.
On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce que l’on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu’ils commencent à produire leurs moyens d’existence, pas en avant qui est la conséquence même de leur organisation corporelle. En produisant leurs moyens d’existence, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle elle-même.
La façon dont les hommes produisent leurs moyens d’existence, dépend d’abord de la nature des moyens d’existence déjà donnés et qu’il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de production de ce seul point de vue, à savoir qu’il est la reproduction de l’existence physique des individus. Il représente au contraire déjà un mode déterminé de l’activité de ces individus, une façon déterminée de manifester leur vie, un mode de vie déterminé. La façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu’ils sont. Ce qu’ils sont coïncide donc avec leur production, aussi bien avec ce qu’ils produisent qu’avec la façon dont ils le produisent. Ce que sont les individus dépend donc des conditions matérielles de leur production.
Karl Marx, "L’Idéologie allemande"
2. Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?, 28 octobre 2017, 16:32, par Sergio
De mon point de vue, ce qui distingue clairement l’homme de ses congénère animaux, c’est sa fabuleuse faculté d’autodestruction.
Celle-ci a déjà été brillamment demontrée par les dizaines de millions de morts des guerres, famines et épidémies engendrées pour des "idées" toutes plus stupides les unes que les autres.
Notre capacité d’autodestruction atteint aujourd’hui des sommets puisque nous allons droit dans le mur avec nos "humanicides" (j’englobe sous ce terme tous les -cides), notre malbouffe, nos pernicieux additifs alimentaires, les "retombées" de notre glorieuse industrie nucléaire, le réchauffement climatique, la destruction des océans, des montagnes, des forêts, des terres arables, des nappes phréatiques ...
Là réside bien le propre de l’homme car aucun animal, même parmi ceux que nous qualifions stupidement de "nuisibles" ou de "sauvages", n’est capable d’exercer une telle prédation de masse, ni sur les autres espèces ni, encore moins, sur la sienne "propre".
3. Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?, 4 octobre 2019, 04:33, par un lecteur
Le propre de l’homme est-il une capacité de mentir ?
Le mensonge et la manipulation sont, chez l’homme, des activités intellectuelles de très haut niveau qui impliquent le cortex préfrontal. C’est ce qu’a montré Maxim Kireev et son équipe de l’université de Saint-Pétersbourg en 2017 en trouvant un mécanisme qui se met en place en met en relation, dans l’hémisphère gauche, à la fois le gyrus frontal médian, le gyrus frontal inférieur et la jonction temporo-pariétale droite. La situation de mensonge active également un réseau d’aires dans les deux hémisphères : le gyrus temporal supérieur droit, l’insula droite, le lobule pariétal gauche et le gyrus frontal supérieur droit.
4. Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?, 4 octobre 2019, 09:48, par JFP/Jean-François POULIQUEN.
JFP¦¦04102019¦¦Nous pensons avoir trouvé ce qu’est le propre de l’homme et cela est relativement très simple¦¦Les animaux ne portent pas de vêtement, et les hommes possèdent des vêtements et même de rechange. Ceci parait simplet et pourtant c’est une très grosse différence entre le monde animal et l’homme. Même les primitifs que sont nos ancêtres portaient quelque chose sur eux et fonction des saisons et donc portaient déjà des choses différentes. Si le poil et donc la fourrure de certains animaux changent fonction des saisons, la peau de l’homme, elle, ne change pas, et pour s’acclimater l’homme portent des vêtements. Certaines espèces d’animaux migrent fonction des saisons, et certaines espèces se sont acclimatés selon les saisons et restent dans une même région, mais pas l’homme, car l’homme par son adaptation se vêt et de plus ne reste pas dans une région précise où un certain climat pourrait lui être favorable, car l’homme migre constamment sur toute la planète, et ce n’est pas la nourriture ou le climat qu’il recherche, car dans quelque temps il migrera dans l’espace. Nous ne connaissons aucun animal qui puisse se vêtir, nous ne connaissons aucun animal qui parcours la planète ‼‼ Si certain animaux parcours de très grandes distances, c’est pour chercher de la nourriture et un climat favorable saisonnier, et cela peut aller très loin, car les animaux vivant dans l’eau peuvent parcourir de très grandes distances, mais ce n’est pas une recherche et des déplacements au hasard mais cycliques. Pour l’homme, pas de migration, mais une recherche constante à trouver d’autres endroits à conquérir, et pour se faire l’homme s’habille car le climat change et non lui et c’est cela son adaptation que sont ses vêtements. Donc l’homme utilise l’outil, mais les outils aussi pour se vêtir. Pour sourire un peu¦¦Le propre de l’homme est son slip même si il est sale ‼‼ C’est drôle et en même temps vrai, car déjà petit il faut voir le nombre de couches utilisés pour que l’enfant soit propre et au sec, et fini les langes à laver tous les jours ‼‼ On peut même se poser la question comment nos premiers ancêtres faisaient pour garder leur petit au sec. Pour le redire le propre de l’homme est son slip ‼‼
▬Oui Monsieur l’inconnu, le propre de l’homme est aussi cette faculté à mentir et donc cela est aussi sale que son slip. Le propre de l’homme est donc du sale et peu importe où se trouve dans son cerveau cette saleté, donc à occulter, à mentir, à tricher, à resquiller, à maquiller, à frauder, à dissimuler, à filouter, à tromper, à berner, à truander, à écornifler, à grappiller, à escroquer... Mais tout ceci est aussi une forme d’intelligence malheureusement. Nous connaissons un animal qui est un vrai tricheur sur la vie, qui est ce coucou voleur de nid, ce petit coucou à peine éclos sans même voir, rejettera les autres œufs hors du nid pour qu’il soit le seul à rester et être nourri gratuitement par de faux parents. Le monde animal a aussi sa perversité, car pour le cas du coucou, la femelle pond dans un nid qui ne lui appartient pas, et le ou les petits une fois éclos ont cet instinct de rejeter les autres œufs ou autres oisillons. C’est fou la saleté ‼‼
▬A toi aussi Monsieur Sergio, car effectivement le propre de l’homme est aussi de tuer les autres hommes, non pas pour se nourrir mais pour conquérir et s’entre-tuer commandé toujours par quelques individus, qui sont des chefs ‼‼ Nos ancêtres rassemblés en tribus faisaient de même, car on pourrait croire que ces ancêtres étaient passifs, mais ils ne l’étaient pas. Donc ce propre de l’homme est encore et toujours du sale ‼‼ Si certains animaux se réservent un droit de domaine, un territoire, l’homme lui veut la totalité de tous les territoires, et donc l’homme est un envahisseur sans raison quelconque, car c’est un besoin de conquête, un besoin de puissance. Même si tous les hommes n’ont pas ce besoin de conquérir, ils élisent portant celui qui sera l’envahisseur et donc ils élisent et suivent leur chef tueur. Pour être chef il faut forcément être sale, car il n’existe pas de chef vraiment propre, car d’être chef c’est d’être malin et surtout profiteur et écraser les autres qui dérange. D’être chef c’est d’être futé, roublard, rusé, astucieux, malicieux, débrouillard, finaud, dégourdi et ces qualificatifs donnent une forme plus grande d’intelligence, mais aussi...
▬Le conflit que l’homme a avec lui-même est que l’homme veut être seul et indépendant, mais il ne peu pas le faire, car il a toujours besoin des autres. L’homme vit donc en peuple, en tribus, en famille, en couple, mais jamais seul, et c’est cette contrainte qui le fait être différent des animaux, car les animaux acceptent cette contrainte de vivre à plusieurs, mais l’homme est toujours conflictuel, et ne sait pas vivre en communauté paisible, car il y a toujours des tensions pour le faire basculer à ne pas vivre en paix. L’homme est toujours dominant et son domaine n’a pas de limite, car l’homme est conquérant, et non pas par les besoins, mais d’instinct comme si il était un envahisseur sur tout ce qui existe, ce qui fait que l’homme ne se satisfait jamais, car il a ce besoin d’aller toujours plus loin, sans savoir où il va d’ailleurs. C’est aussi cela le propre de l’homme à ne jamais être rassasier, et aller toujours plus loin dans l’inconnu et sans retour arrière possible, même si il veut aller dans le futur, mais aussi dans le passé ‼‼ Les singes sont donc sans rapport avec ce qu’est l’homme, même si il y a des similitudes, car l’homme est à lui seul un espèce à complètement à part, et ce n’est pas son intelligence qui le différencie des animaux, car les animaux sont aussi intelligents, mais ne l’exprime pas de la même façon que celle des hommes. L’homme enregistre tout, et c’est donc son savoir qui fait la différence avec le reste du monde vivant, car aucun organisme vivant ne sait stocker de l’information et de la transmettre aux descendants.
▬Amicalement. Les jumeaux JFP/Jean-François POULIQUEN
5. Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?, 5 octobre 2019, 00:24, par JFP/Jean-François POULIQUEN.
JFP¦¦05102019¦¦Nous dirions aussi que le propre de l’homme est d’occulter, de filtrer, de sélectionner, d’intercepter, de masquer, de voiler, de cacher, de noyer, de murer, d’éclipser, de capter, de suspendre, de dissimuler, de camoufler, de déguiser, de refouler, d’arbitrer, de fausser, de truquer, de violer, d’altérer, d’escamoter, de refouler, de maquiller, de déformer, de dénaturer, d’altérer, d’épurer, d’opter, de choisir, de trier, d’écrémer, de calibrer, de cribler de séparer, de supplanter, d’effacer, de supprimer, de rayer, de biffer, d’ôter, d’enlever, de retirer, de débarrasser, dépouiller, de soustraire, d’extraire, d’exclure, d’écarter, de proscrire, d’expulser, d’exiler, de retrancher, d’éloigner, d’interdire, de repousser, d’éliminer, de chasser, de rejeter, de balayer, d’éjecter, de refuser, de renvoyer, d’ajourner, d’ombrer, d’embrumer, d’amputer, d’extirper, de soustraire, de tricher et mentir CE QUE NE SAVENT PAS FAIRE LES ANIMAUX.
▬Amicalement. Les jumeaux JFP/Jean-François POULIQUEN
1. Qu’est-ce qui est le propre de l’homme ?, 6 octobre 2019, 08:35, par Robert Paris
Parlerais-tu comme R.P. ? L’homme ou l’espèce fabulatrice ?