Accueil > 24- COMMENTAIRES DE LIVRES > L’espèce fabulatrice, Nancy Huston
L’espèce fabulatrice, Nancy Huston
jeudi 31 décembre 2009, par
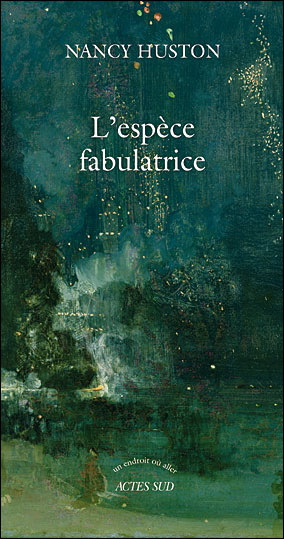
Nancy Huston développe l’idée d’une fonction cérébrale spécifiquement humaine : la "capacité fabulatrice" ! Comme elle l’écrit dans "L’espèce fabulatrice", « Aucun groupement humain n’a jamais été découvert circulant tranquillement dans le réel à la manière des autres animaux : sans religion, sans tabou, sans rituel, sans généalogie, sans contes, sans magie, sans histoires, sans recours à l’imaginaire, c’est-à-dire sans fictions.(...) C’est ainsi que nous, humains, voyons le monde : en l’interprétant, c’est-à-dire en l’inventant, car nous sommes fragiles, nettement plus fragiles que les autres grands primates.(...) Notre imagination supplée à notre fragilité. Sans elle - sans l’imagination qui confère au réel un Sens qu’il ne possède pas en lui-même - nous aurions déjà disparu. »
"Notre cerveau nous raconte des bobards. Un exemple : les saccades. Plusieurs fois par seconde, nos yeux "sautent", interrompant brièvement leur captage du monde pour que notre cerveau puisse en construire une image continue. Quand nous marchons dans la rue, par exemple, notre tête change constamment de hauteur ; sans saccades nous verrions ce que l’on voit à l’écran pendant les scènes de "caméra à l’épaule" !"
Dans L’Espèce fabulatrice, Nancy Huston explique que sans être fictives, nos identités sont des fictions. C’est parce que nous percevons nos vies comme des romans que nous avons besoin de littérature.
Voir : Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser aux rapports que nous entretenons à la fiction ? Comment avez-vous découvert que nous sommes, au fond, une "espèce fabulatrice" ?
Nancy Huston : "Déjà, Lignes de faille parlait de la construction de l’identité, c’était donc visiblement quelque chose qui me travaillait, à cause de ma propre trajectoire. Et puis, il y a eu une série d’événements récents : la maladie de mon père avec ces étranges symptômes d’hyper-mémoire qui lui donnaient l’impression de vivre un perpétuel déjà-vu, une question sur l’utilité de la littérature que m’a posée une femme alors que j’animais un atelier dans une prison. Tout ça m’a poussée à écrire ce livre. J’ai découvert à quel point le cerveau pouvait nous raconter des bobards. Que c’est même une partie de sa fonction de base."
Vous avez donc étudié la mécanique du cerveau ?
"Oui, j’ai beaucoup lu sur le cerveau mais je n’ai pas voulu alourdir mon essai en rentrant dans des détails scientifiques. Un livre en particulier, Le Nouvel Inconscient de Lionel Naccache, un neurologue à Paris, m’a beaucoup marquée. Naccache s’intéresse à la constitution de fictions par le cerveau. J’ai beaucoup aimé son emploi du mot "fiction" pour des choses qui ne sont pas du tout des fictions littéraires mais plutôt des façons d’interpréter le monde qui nous entoure. Je me suis rendu compte qu’il y avait là une notion centrale pour moi. Ça m’a poussée à me demander en quoi la fiction littéraire est différente de nos autres fictions."
Ces autres fictions sont ce que vous appelez des arché-textes, des fictions sociales, en bref les croyances et les discours qui nous unissent. Il y a quelque chose d’angoissant à penser que tout ce qui nous définit est, en quelque sorte, inventé.
"Les non-lecteurs sont des gens qui ont des certitudes, qui sont certains d’être dans le réel, d’être "qui ils sont". En lisant, on peut se rendre compte que la plupart de ces certitudes que nous avons sont des fictions. Personnellement, je ressens cette angoisse même si je ne suis pas à la recherche de mon identité. Je la reconnais comme multiple. J’ai la chance de maîtriser quatre ou cinq mini-cultures dans la culture occidentale mais je n’ai pas du tout la prétention de comprendre comment fonctionnent les êtres humains en Chine ou en Afrique."
Si les fictions sont nos ciments, que pensez-vous des romans qui, au lieu de s’attaquer aux arché-textes, renforcent plutôt la culture dominante ?
"Les discours religieux et politiques suffisent pour ça ! Nous n’avons pas besoin d’un roman pour enfoncer cette porte ouverte."
Vous dites qu’au fond, nous élevons nos enfants un peu comme un auteur construit ses personnages...
"Les mamans singes ne suivent pas la destinée de leur progéniture toute leur vie, elles ne planifient pas leur avenir. Alors que nous, êtres humains, sommes des êtres de fiction qui voient leurs vies comme des trajectoires. C’est pourquoi nous nous soucions tant du parcours de nos enfants. Ils injectent une grosse dose de sens à nos vies. Je suis certaine que c’est pour ça qu’on les aime."
Et créer des personnages, est-ce alors un peu comme avoir des enfants ?
"Créer des personnages, je dirais que c’est, pour moi, la possibilité d’avoir plus d’une existence, de ne pas me contenter de la donne qui se trouve être la mienne. Oui, créer des personnages, c’est un peu comme faire des enfants. Je suis prête à tout pour enrichir leur vie à eux. Je suis prête à passer des heures en bibliothèque, à voyager pour enrichir leur biographie. Je trouve souvent leur vie plus intéressante que la mienne."
Si nous sommes des fictions, comment alors savoir qui l’on est vraiment ?
""Qui on est vraiment", c’est une phrase que je ne prononce jamais, parce que nous ne sommes jamais qu’une seule chose. Nous sommes tout ce que nous avons absorbé. J’aime beaucoup la phrase d’Amin Maalouf à ce sujet : "Je suis mon chemin." On ne naît pas tout constitué. On a beaucoup de mal à se débarrasser de cette notion judéo-chrétienne qu’on est une âme placée dans un corps. En réalité, c’est tout le contraire."
Lire un roman, c’est donc s’ouvrir aux autres ?
"Le roman nous introduit dans l’intériorité de l’autre, nous laisse suivre ses pensées, connaître son passé. Comparativement, les autres arts restent à la surface. Le théâtre, le cinéma, c’est vécu collectivement. On le reçoit dans un temps donné (même si on ne peut pas vraiment dire que Shakespeare, c’est du superficiel !). Alors que le roman nous donne le temps de réfléchir, de relire, de laisser mijoter et retentir les propos de l’auteur. Sur le plan éthique, ça peut apporter beaucoup."
L’Espèce fabulatrice
de Nancy Huston
Éd. Leméac, 2008, 208 p.
Nancy Huston écrit dans « L’espèce fabulatrice » :
« Dans son état normal, notre cerveau se livre (à notre insu) à des activités tout à fait étranges et étonnantes.
Dans ce domaine comme dans bien d’autres, c’est l’anormal qui nous éclaire sur le normal.
Chez certains patients atteints d’épilepsie grave, avant le développement de médicaments pour empêcher la transmission des crises d’une moitié du cerveau à l’autre, l’on intervenait chirurgicalement pour sectionner le corpus calleum qui les reliait ; du coup, les deux hémisphères ne pouvaient plus communiquer entre eux. Or l’on sait que, chez les droitiers (et nombre de gauchers aussi), seul l’hémisphère gauche peut constituer les informations en savoir verbal.
Dans les années 1980, le psychologue Michael Gazzaniga a réalisé des expériences fascinantes avec ces patients dits « calleux » ou « callotomisés ». En voici un exemple : on montre au patient un écran et on lui demande d’en fixer le centre. Ensuite, sur la partie gauche de l’écran apparaît fugitivement le mot « Marchez ». Seul l’œil gauche capte ce message ; il le transmet à l’hémisphère droit, qui en comprend le sens mais ne peut l’enregistrer consciemment. Aussitôt, le patient se lève et se dirige vers la porte. « Où allez-vous ? » demande le médecin. « J’ai soif, répond le patient sans la moindre hésitation, je vais chercher quelque chose à boire. »
Puisqu’il s’est dirigé vers la porte, il devait bien avoir une motivation pour le faire ; la soif est une motivation plausible ; le cerveau gauche lui a fourni spontanément cette réponse, qu’il a reçue et traitée comme une vérité.
Il ne mentait pas, car il croyait fermement à ce qu’il venait de dire. Il fabulait.
Tous, nous fabulons ainsi, en toute bonne foi, sans le savoir.
Si l’on y prête attention, on peut pour ainsi dire « surprendre » notre cerveau en train de nous raconter des bobards. (…) Je vois une femme accroupie (…) Elle a eu besoin de s’accroupir, me dis-je, pour fouiller dans son sac à la recherche d’une clef. L’important ici, c’est que mon cerveau n’a pas d’abord constaté la posture inhabituelle de ma voisine pour spéculer ensuite quant aux raisons pouvant l’expliquer. (…) Nous sommes incapables, nous autres humains, de ne pas chercher du Sens. C’est plus fort que nous. (…)
Un exemple flagrant : les saccades. Plusieurs fois par seconde, nos yeux « sautent », interrompant brièvement leur captage du monde pour que notre cerveau puisse en recevoir une image continue. Quand nous marchons dans la rue, par exemple, notre tête change constamment de hauteur ; sans saccades, nous verrions ce qu’on voit à l’écran pendant les scènes de « caméra à l’épaule » !
Mais les bobards du cerveau normal n’attirent pas l’attention, car ils sont précisément conçus pour donner le change et passer inaperçus. (…)
C’est ainsi que nous, humains, voyons le monde : en l’interprétant, c’est-à-dire en l’inventant, car nous sommes fragiles, nettement plus fragiles que les autres grands primates. Notre imagination supplée à notre fragilité. Sans elle – sans l’imagination qui confère au réel un Sens qu’il ne possède pas en lui-même – nous aurions déjà disparu, comme ont disparu les dinosaures. »

Messages
1. L’espèce fabulatrice, Nancy Huston, 31 décembre 2009, 10:09, par Robert Paris
Personnellement je ne fais aucune confiance en la vérité ; il n’y a que les mensonges qui m’intéressent. Les miens, en particulier. Même enfant, j’aimais mentir ; et depuis que j’écris, le mensonge est devenu ma passion dominante.
Instruments des ténèbres, Nancy Huston
2. L’espèce fabulatrice, Nancy Huston, 8 mars 2010, 19:25, par Robert Paris
« Science et vie » de juin 2008, on peut lire que les fabulations sont une forme de faux souvenirs qui n’apparaissent que dans des situations pathologiques. Elles sont fréquemment observées chez des patients amnésiques mais peuvent l’être également chez les schizophrènes ou les malades d’Alzheimer par exemple. S’ils fabulent, c’est que ces patients ont perdu un des processus fondamentaux qui accompagne normalement la récupération des souvenirs. Selon Martin Conway, quand nous reconstruisons un souvenir, nous suivons deux impératifs : la cohérence de soi, mais aussi le principe de réalité. Ces deux principes agissent de manière contradictoire mais aussi combinée. Ils produisent une mémoire qui n’est pas une simple conservation mais une construction permanente et dynamique. Sous son action, le passé perçu par notre mémoire change sans cesse, est reconstruit en fonction du présent et du futur. Il permet de concevoir un futur. Ce dernier nous est indispensable car nous sommes un être qui a besoin de se projeter dans l’avenir. La « cohérence de soi », c’est celle des multiples récits possibles inventés par notre imaginaire. Dès qu’un fait nouveau se produit, l’automatisme de notre cerveau, en particulier le cingula, produit immédiatement un « pourquoi ». Ces divers « pourquoi » peuvent être cohérents sans correspondre à la réalité vécue. C’est là que se niche le « principe de réalité » qui écarte les versions trop étranges. La contradiction entre logique interne et informations externes produit donc une dialectique dynamique. Ce n’est pas un simple dialogue mais une contradiction permanente dans laquelle l’essentiel des thèses produites par notre cerveau sont détruites et rejetées, ou au moins sont inhibées ou encore cachées et abandonnées momentanément. Lorsque nous ne sommes plus capables de mener ce combat permanent, nous sommes livrés aux versions internes et à leur logique fermée. Pascale Piolino explique que « les patients fabulateurs n’ont plus ce principe de réalité et acceptent tout ce qui leur vient de leur esprit. » De là vient, aussi, le caractère obsessionnel de la maladie des paranoïaques. Ces malades sont parfaitement logiques de leur point de vue. Tous les événements de leur vie ont une logique : on leur en veut. La réalité ne peut plus mener son combat dialectique. En effet, la contradiction n’est pas destructrice mais dialectique. Elle sélectionne parmi les multiples produits approximatifs et imaginaires du cingula ceux qui se conforment à l’observation. En somme, la contradiction entre « principe de réalité » et « cohérence de soi » n’est pas pathologique. C’est son absence qui l’est. La fabulation provient du fait que l’influence externe est inhibée par la crainte. Les fabulations sont des versions inventées en interne sur des soi disant faits externes. Par contre, dans le fonctionnement normal, la cohérence interne, la conservation interne, n’est pas un objectif sensé fonctionner seul mais de manière contradictoire avec les informations liées à l’environnement.
D’autre part, ces études nous apprennent que l’imaginaire, le mensonger éventuellement, n’est pas remise en cause de l’individu mais, au contraire, il vient rassurer, conforter l’individu. Il est aussi nécessaire que la réalité. Son absence serait tout aussi pathologique. L’imaginaire, la construction et même l’invention du passé, est indispensable à la construction de l’identité individuelle qui est très loin de ne se fonder que sur des faits réels. Nos souvenirs sont systématiquement (par automatisme cérébral) infectés par des interprétations et des introductions de faux souvenirs ou de fausses explications qui ont un rôle, celui de donner une cohérence d’ensemble. La continuité n’a rien de réelle. Elle est un produit imaginaire. Elle rempli les trous. Non seulement ceux de la mémoire des faits réels mais aussi les trous de la compréhension des événements. Nous bâtissons une logique continue du passé, là où nous ne percevons que des bribes dont les liens ne nous apparaissent pas. « Notre mémoire autobiographique – nos souvenirs, infidèles au réel, imprégnés de fiction – est tout aussi essentielle à notre « moi de demain ». C’est ce qu’a démontré l’utilisation de l’imagerie cérébrale complétant la psychologie cognitive. L’imagerie cérébrale le montre sans appel : la mémoire est le laboratoire où s’invente notre futur. Cela va à l’encontre de l’image de réservoir figé que nous en avions. C’est le même système neuro-cognitif qui sous-tendrait le voyage dans le temps, vers le passé et vers le futur, comme l’a montré l’équipe de Lilianne Manning. L’imagerie cérébrale montre que ce sont les mêmes zones qui sont activées par des exercices d’évocation du passé et par des exercices d’imagination portée vers des actions futures. Ces expériences montrent que « sans notre répertoire de souvenirs construits et reconstruits nous ne pouvons pas nous projeter dans l’avenir.
Pour nous le passé n’est pas seulement du passé, quelque chose sur lequel on ne peut plus revenir, qu’on ne peut plus modifier, qui est figé et condamné à se perdre progressivement. C’est une construction tournée vers l’avenir. Il n’y pas de succession linéaire du passé vers le futur en passant par le présent mais une interpénétration contradictoire du passé et de l’avenir sans laquelle le présent n’aurait plus de sens. Le souvenir permet de réactualiser un événement du passé que nous faisons semblant de revivre pour nous en approprier les apports. Mais il ne s’agit pas d’une simple évocation gratuite. C’est un besoin nécessité par les questions présentes et à venir que pose notre cerveau. Le caractère dynamique du fonctionnement cérébral, fondé sur le virtuel, sans cesse en construction, sans cesse en contradiction est donc général. Le passé n’agit pas comme un substrat inerte, inchangé et inchangeable. Nous pouvons agir sur notre passé afin de donner un sens au présent et de préparer l’avenir, et nous ne cessons pas de le faire. Nos pertes de mémoire liées à l’âge peuvent parfaitement n’avoir rien de purement physiologique. Elles peuvent découler du fait que l’individu ne se projette plus dans l’avenir, n’a plus de projets. Du coup, il cesse partiellement de faire appel à ses souvenirs en vue d’actions futures. La mémoire qui n’est plus reconstruite perd de plus d’éléments. On conçoit ainsi qu’elle ne ressemble en rien à une simple conservation.
En cas d’amnésie sévère, ce n’est pas seulement le passé qui est affecté : c’est le présent et le futur. L’individu malade ne dispose plus des références indispensables Non seulement il peut ne plus reconnaître des individus, des situations mais il peut ne plus reconnaître des comportements simples et devenir indifférent à son entourage. Ce n’est pas seulement une connaissance du passé qui lui fait défaut. C’est la possibilité d’actionner le mécanisme par lequel la mémoire construit des fictions à partir d’évocations du passé afin de réaliser des projets. Et sans cette possibilité de modifier le passé pas de possibilité de construire un avenir. Les anciens ne perdent pas le passé, ils le conservent et, en le conservant, ils se ferment la possibilité de se projeter vers le futur. C’est ce qu’a démontré notamment l’équipe de Lilianne Manning de neuropsychologie de Strasbourg, la psychologue canadienne Endel Tulving, le professeur Martin Conway de Leeds (Angleterre), Eleanore Maguire de Londres, Aikaterini Potopoulou de Londres, Pascale Piolino de Paris, le professeur Daniel Schacter de Harvard, les neuropsychologues américains Randy Buckner et Daniel Caroll, le professeur Martial Van Der Linden de Genève et le professeur Arnaud D’Argembeau de Liège.
Citons les :
« La possibilité d’utiliser des événements du passé pour se projeter dans l’avenir est un fonction cruciale du cerveau. » dit Lilianne Manning.
« Tout le monde ne fabrique pas des faux souvenirs. Cela dépend notamment des capacités d’imagerie mentale de chacun. Les individus chez qui elles sont importantes ont plus de mal à faire la part des choses entre ce qu’ils ont imaginé et ce qu’ils ont vécu. » affirme Martial Van Der Linden.
« Nous extrayons des éléments d’expériences vécues et les recombinons pour simuler, imaginer notre futur. » explique Arnaud d’Argembeau.
On sait dorénavant que le réaménagement à chaque moment de notre passé, de l’ensemble de nos connaissances et de nos expériences mémorisées (c’est-à-dire qui ont été réévoquées dans un passé pas trop ancien) est un élément déterminant de notre personnalité. Une personne qui déprécie sa propre valeur du fait d’une dépression va se souvenir de tous les faits du passé qui confirment sa mauvaise appréciation d’elle-même. Pascale Piolino explique que « Nous complétons nos souvenirs vagues en nous appuyant sur des choses que nous savons de nous-mêmes, le but étant que le tout soit cohérent. »
Des spécialistes ont pu utiliser l’imagerie cérébrale dans les expériences de psychologie cognitive pour mettre en évidence des circuits concernés dans ce type de fonctionnement. Ils ont montré que le même type de circuit est concerné par l’évocation du passé que par celle du futur : un circuit passant par le cortex préfrontal antéro-médian et l’hippocampe.
J’ai cité également Rita Carter.
Rita Carter raconte, dans « Atlas du cerveau », ces histoires du cerveau que permettent nos connaissances actuelles en neurosciences : « L’immense majorité des fonctions mentales sont totalement ou partiellement latéralisées. L’origine de cette latéralisation est encore mal comprise, mais il semble qu’une fois arrivée dans le cerveau, l’information emprunte de multiples routes parallèles, et reçoit un traitement légèrement différent selon le chemin suivi (…) Chaque hémisphère choisit les tâches conformes à son style de fonctionnement, holistique ou analytique. Cette opposition de style s’expliquerait en partie par une curieuse différence physique des hémisphères. Ceux-ci sont un mélange de substance grise et de substance blanche. La substance grise correspond aux corps centraux des cellules cérébrales (…) La substance blanche (…) est composée de denses faisceaux d’axones – les prolongements émis par les corps cellulaires et transmettant l’influx nerveux. (…) Bien qu’infime, cette différence entre hémisphère droit et gauche est importante car elle signifie que les axones du cerveau droit sont plus longs et relie donc des neurones qui, en moyenne, sont plus dispersés. (…) Cela suggère que le cerveau gauche est mieux équipé que le cerveau gauche pour activer simultanément plusieurs modules cérébraux,(…) ce qui expliquerait l’inclination de cet hémisphère à produire des concepts généraux. (…) Le cerveau droit, doté d’une trame neuronale plus dense, est en revanche mieux équipé pour effectuer des tâches complexes, minutieuses, dépendant de la coopération étroite et constante de cellules pareillement spécialisées. (…) Les décisions conscientes, si elles semblent l’œuvre d’un seul partenaire dominant, reposent en fait sur les informations recueillies par les deux hémisphères. Mais ce dialogue connaît parfois des accrocs. L’hémisphère dominant peut ignorer l’information transmise par son partenaire et prendre une décision unilatérale. Cela peut se traduire par un trouble émotionnel difficile à justifier. Inversement, l’hémisphère non dominant peut passer outre au contrôle exécutif de son partenaire (…) Si quelques millièmes de secondes suffisent au corps calleux pour transmettre une énorme quantité d’informations entre les deux hémisphères, il arrive parfois qu’une information particulièrement importante pour un hémisphère s’attarde dans l’hémisphère émetteur et ne soit que faiblement enregistré par l’hémisphère récepteur. »
3. L’espèce fabulatrice, Nancy Huston, 8 mars 2010, 19:26, par Robert Paris
Lionel Naccache dans « Le nouvel inconscient » examine le cas du malade héminégligent : « Plutôt que de dresser un état objectif de la situation à partir des données du réel qu’il sait recueillir, ce patient intègre immédiatement ces données dans un scénario. (…) Le patient reste enfermé dans son scénario proclamé avec la conviction d’une évidence certaine : « Ceci n’est pas main ! » Pourtant, l’ensemble des données objectives et des connaissances nécessaires sont accessibles consciemment au patient. (…) Ceci ne l’empêche pas d’adhérer avec force à sa conviction fictive. Tout comme le patient au cerveau divisé, la « réalité psychique » dépasse le réel. La fiction structure la conscience. »
Il étudie un autre cas où se révèle cette capacité de l’homme à donner des réponses automatiques et irrationnelles : « Dans l’amnésie observée chez les patients atteints du syndrome de Korsakov, on trouve très souvent un phénomène tout aussi spectaculaire. Il révèle également la prégnance de la fiction dans la vie consciente. Ces patients, dans les formes les plus sévères, peuvent présenter une amnésie antérograde majeure, c’est-à-dire l’incapacité totale à retenir le moindre souvenir conscient du cours actuel de leur existence. Ces patients confabulent, c’est-à-dire qu’ils se mettent à vous raconter, et à se raconter à eux-mêmes, des histoires vraisemblables »
1. L’espèce fabulatrice, Nancy Huston, 17 mars 2010, 09:47, par MOSHE
Mais les bobards du cerveau normal n’attirent pas l’attention, car ils sont précisément conçus pour donner le change et passer inaperçus. (…)
C’est ainsi que nous, humains, voyons le monde : en l’interprétant, c’est-à-dire en l’inventant, car nous sommes fragiles, nettement plus fragiles que les autres grands primates. Notre imagination supplée à notre fragilité. Sans elle – sans l’imagination qui confère au réel un Sens qu’il ne possède pas en lui-même – nous aurions déjà disparu, comme ont disparu les dinosaures. »